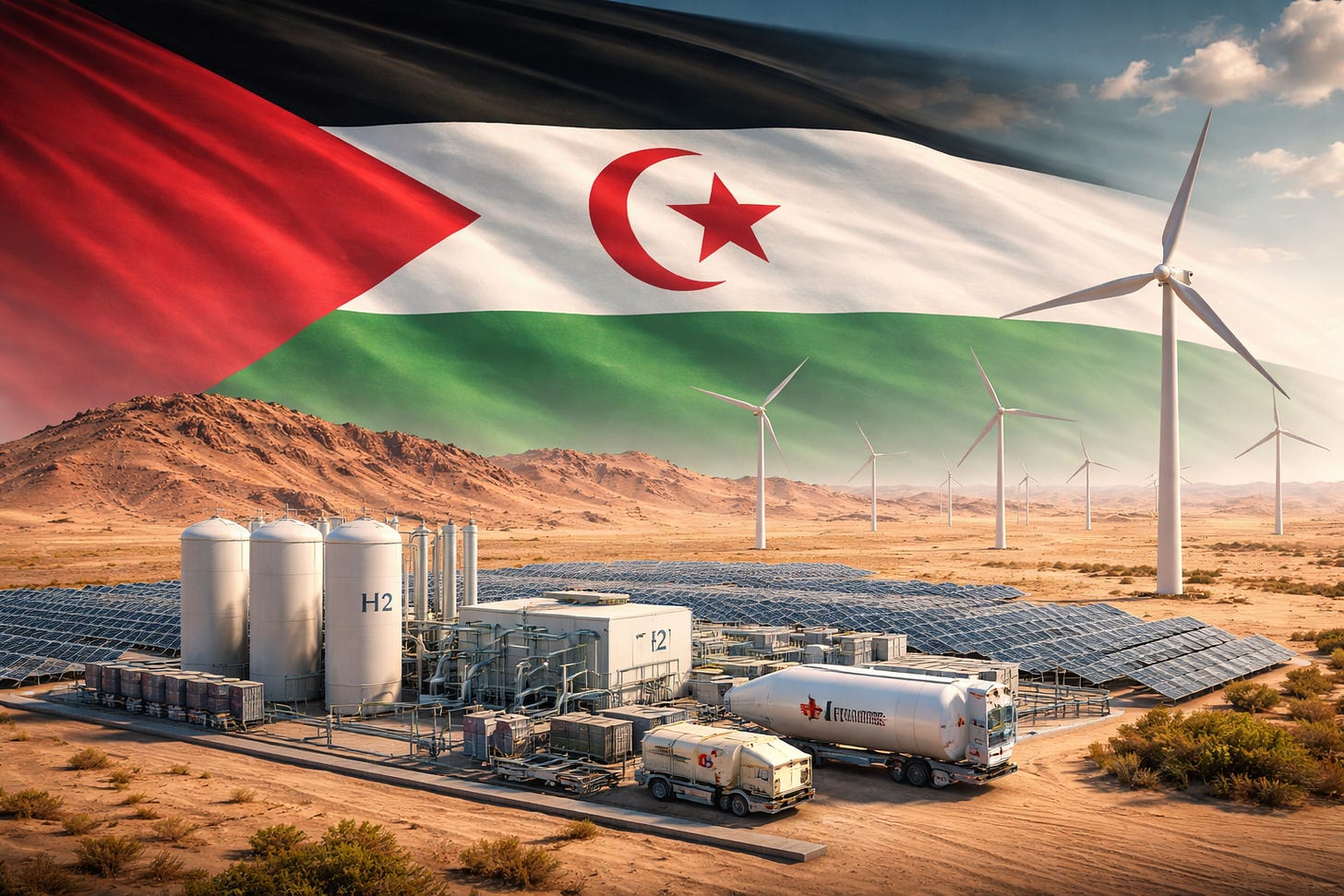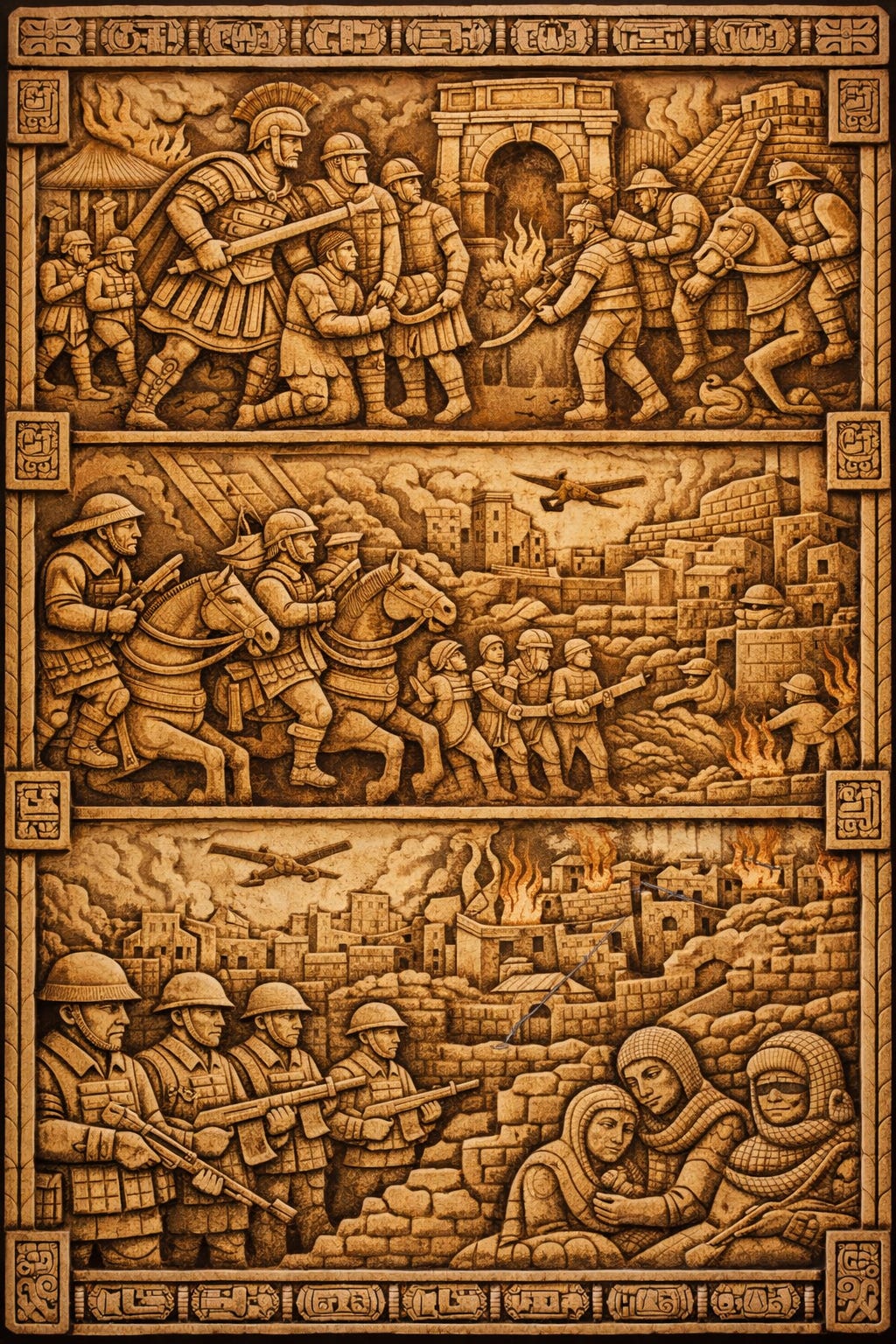Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
Amos Barshad est un journaliste indépendant israélo-usaméricain vivant à New York, auteur d’un livre sur Raspoutine
HADIYAH KAYOOF avait 12
ans lorsque ses parents l’ont retirée de l’école publique locale du petit
village israélien d’Isifiya pour l’inscrire dans une école arabe privée de la
ville voisine de Haïfa. Son père tenait un petit magasin d’accessoires
informatiques et sa mère était enseignante en maternelle. C’était une famille
patriarcale. « Je pense que ma mère était plus patriarcale que mon père »,
raconte Kayoof, aujourd’hui âgée de 27 ans, en riant au téléphone depuis
Israël, où elle travaille comme avocate d’affaires. Le foyer était
traditionnel, discrètement religieux et apolitique. Ses parents n’ont pas
cherché à provoquer un réveil en la transférant dans une nouvelle école. Ils
voulaient simplement que leur fille reçoive la meilleure éducation possible.
EN JUILLET 2018, la Knesset israélienne a adopté une loi communément
appelée « loi sur l’État-nation ». Celle-ci stipule que « la réalisation du
droit à l’autodétermination nationale dans l’État d’Israël est propre au peuple
juif », consacrant ainsi dans la loi la supériorité pratique des Juifs sur
toutes les autres communautés du pays. (Son nom officiel est « Loi fondamentale
: Israël, État-nation du peuple juif »). Naturellement, dans la période
controversée qui a précédé l’adoption du projet de loi, tous les regards
étaient tournés vers les 1,6 million de citoyens arabes d’Israël. D’une manière
ou d’une autre, les décideurs à l’origine du projet de loi n’ont pas envisagé
la possibilité que les 140 000 Druzes d’Israël, ces frères de sang réputés pour
leur loyauté, aient eux aussi leur mot à dire.
La famille de Kayoof est druze,
une communauté et une religion qui compte un peu plus d’un million de personnes
réparties principalement au Liban, en Syrie et en Israël. Le village natal de
Kayoof est majoritairement druze et, à ce titre, son éducation primaire a été
dispensée selon les directives du programme scolaire officiel du gouvernement
israélien destiné aux Druzes. « Ils nous ont enseigné le lien du sang qui unit
les Juifs et les Druzes », se souvient Kayoof. « Ils nous ont appris que dans
les années 50, les [dirigeants] druzes se sont rendus en Israël pour demander
que le service militaire soit imposé à la communauté. Ma langue maternelle est
l’arabe, comme pour la plupart des Druzes, mais on m’a appris que je n’étais
pas arabe, mais druze israélienne. » Petite, Kayoof était emmenée aux
célébrations de la fête de l’indépendance d’Israël. Elle a autant appris sur
les fêtes juives que sur les fêtes druzes.
Haïfa est une ville réputée pour
son brassage démographique. Sa minorité arabe, qui représente environ 11 % des
280 000 habitants de la ville, serait mieux intégrée et politiquement plus
forte que partout ailleurs en Israël. À l’école, Kayoof a rencontré pour la
première fois des camarades qui s’identifiaient comme Arabes israéliens,
Palestiniens musulmans et chrétiens arabes. Elle a alors réalisé qu’il existait
davantage d’options pour s’identifier qu’elle ne l’avait jamais imaginé
auparavant. Elle a commencé à se poser la question suivante : qui était-elle
exactement ?
Kayoof a commencé à lire des
ouvrages sur l’histoire du conflit israélo-palestinien et sur sa propre
communauté. Ses parents n’étaient pas enclins à remettre en cause le discours
national, mais leur bibliothèque familiale contenait justement une multitude de
textes historiques druzes qui ne correspondaient pas au programme scolaire
officiel. Certains étaient des ouvrages universitaires du professeur Kais
Firro, historien à l’université de Haïfa et, comme elle l’a découvert par la
suite, originaire d’Isifiya.
« ça a été tout un processus », explique Kayoof à propos de sa rééducation. « Et après environ six ans, j’ai eu cette grande révélation : je suis palestinienne. J’ai conclu que mon identité avait été manipulée. Et ça m’a mise très en colère. »
La réponse ne s’est pas fait
attendre. Amal As’ad, brigadier général à la retraite de l’armée israélienne
dont le propre frère est mort au combat à Gaza, a déclaré qu’Israël s’orientait
vers un « État d’apartheid » et s’en est ensuite pris au Premier ministre
Benjamin Netanyahou, lors d’une réunion tendue dont Netanyahou est sorti
en soufflant. Deux soldats druzes actifs dans les Forces de défense
israéliennes ont exprimé leur mécontentement sur Facebook et ont menacé de
quitter l’armée. « De ce pays que j’ai servi avec dévouement, détermination et
amour pour ma patrie, avec mes deux frères et mon père, qu’est-ce que nous
obtenons en fin de compte ? », a écrit l’un des soldats, le capitaine Amir
Jmall, dans un message adressé directement à Netanyahou. « Nous sommes des
citoyens de seconde zone. » Cette protestation animée et dispersée en réponse
au projet de loi sur l’État-nation a atteint son paroxysme un samedi soir à
Tel-Aviv, lorsque des dizaines de milliers de personnes – des politiciens juifs
de gauche, des chefs religieux druzes et d’autres personnes obstinément
optimistes – se sont rassemblées sur la place Rabin pour une manifestation en
faveur des Druzes.
La droite a exprimé sa confusion
et a fait marche arrière en douceur, répétant des platitudes sur « nos frères
druzes ». Il a été question de modifier la loi d’une manière ou d’une autre
pour assurer la protection des Druzes. Mais l’objectif
fondamental et illibéral de la loi n’a pas été remis en cause par la droite, et
finalement, même ces vagues ouvertures envers les Druzes semblaient timides et
hypocrites. Comme Natan Eshel, ancien chef du cabinet du Premier ministre, l’a déclaré à une chaîne d’information nationale, « Ceux
qui n’aiment pas ça – il y a une importante communauté druze en Syrie, ils sont
les bienvenus pour y établir l’État de “Druzia” ».
Mais Kayoof n’exprime ni
angoisse, ni amertume, ni peur. Elle considère plutôt l’adoption de cette loi
comme un tournant. À l’adolescence, elle avait déjà accepté une autre réalité
concernant les Druzes. Aujourd’hui, grâce à la loi sur l’État-nation, elle
espère que l’ensemble de sa communauté commencera à voir les choses comme elle,
à prendre conscience qu’elle a également été manipulée.
« J’étais heureuse qu’Israël ait
adopté cette loi », dit-elle. « Elle énonçait une évidence pour moi. Ma
réaction ? Une grande joie. »
DEMANDEZ À UN JUIF ISRAÉLIEN ce qu’il pense des Druzes, et il vous
parlera très certainement de la puissance des combattants druzes. Contrairement
aux autres citoyens arabes d’Israël et aux juifs ultra-orthodoxes, les hommes
druzes sont tenus de servir dans l’armée israélienne. Au fil des décennies et
des guerres qu’a connues Israël, ils se sont forgé une réputation de soldats
dévoués, et on estime à environ 400 le nombre de soldats druzes morts au combat
pour Israël. Comme l’explique Nadia Hamdan, militante druze, à +972 Magazine
cette année : « Nous avons grandi avec des uniformes militaires suspendus à nos
cordes à linge. »
Mais ce récit de l’unité entre
les Druzes et les Juifs, forgée au combat, a toujours présenté des failles.
Dans son livre publié en 1980, Conversations With Palestinian Women,
Ronit Lentin cite Lily Feidy (aujourd’hui universitaire palestinienne) à propos
de son mariage imminent avec un Druze :
Bien que
ses parents aient soutenu son choix, d’autres membres de sa famille s’y sont
opposés en raison de « la perception qu’ont les Arabes des Druzes, qu’ils
considèrent comme des collaborateurs des Israéliens ». Feidy m’a confié que son
futur mari n’avait pas servi dans l’armée israélienne et avait passé un an en
prison : « Beaucoup de jeunes Druzes qui refusent de servir passent du temps en
prison. Aujourd’hui, environ 300 Druzes sont incarcérés dans les prisons
israéliennes pour avoir refusé de servir... Personne n’est au courant, car
toutes ces informations sont censurées et rien n’est publié. »
Même pour les Druzes qui s’engagent
et tentent de s’intégrer, il existe des points de friction. En 2015, YNet a signalé un
incident qui s’est produit lors d’une « soirée des soldats » dans un bar du
nord d’Israël. Un groupe de clients juifs s’est mis en colère lorsqu’ils ont
entendu un soldat druze parler en arabe à son cousin. Lors de l’altercation qui
a suivi, ils ont jeté une pierre à travers la vitre de sa voiture et lui ont
cassé la mâchoire. Et pas plus tard qu’en 2015, un bataillon druze séparé
appelé Herev, ou « Épée », était actif. Comme un officier supérieur de l’armée
israélienne l’ expliqué à l’époque,
il n’a été démantelé qu’après que de jeunes soldats druzes eurent « clairement
et sans équivoque indiqué [...] qu’ils souhaitaient être intégrés dans l’armée
israélienne et ne pas faire partie d’un bataillon distinct ».
En 2014, Hadiyah Kayoof a cofondé
Urfod, une organisation qui soutient les hommes druzes qui refusent de servir
dans l’armée israélienne (contrairement aux femmes juives israéliennes, les
femmes druzes ne sont pas légalement tenues de servir). Urfod signifie « Refuse
», abréviation de « Refuse et ton peuple te protégera ». Le groupe fait partie
d’une petite avant-garde au sein de la communauté druze. Si leur point de vue
était initialement marginal, les choses ont rapidement évolué. « Beaucoup de
gens commencent à s’interroger sur leur identité », explique-t-elle. « Beaucoup
se demandent pourquoi ils devraient s’engager dans l’armée alors qu’Israël les
prive de leurs droits. »
Kayoof et Urfod citent des
universitaires tels que Kais Firro et Rabah Halabi, qui ont découvert des
communiqués officiels du gouvernement israélien datant des années 1940 et 1950
décrivant un plan visant à séparer la communauté druze du reste de la population
arabe.
« Les derniers à avoir des
raisons de se plaindre de l’État d’Israël devraient être les Druzes. Non
seulement ils n’ont pas été opprimés, mais ils ont bénéficié de droits
extraordinaires », écrivait Yehoshua Felmann, du Bureau des relations arabes,
en 1950. « Cela n’a pas été fait au hasard, mais avec un plan et une intention,
qui étaient d’approfondir et d’élargir la distance entre eux et les Arabes
parmi lesquels ils vivent. » Ou, comme le concluait en 1949 un comité
interministériel sur l’intégration des Arabes, « la meilleure façon de traiter
les minorités était de les diviser et de les subdiviser ».
En 1948, pendant la guerre qui a
donné naissance à l’État d’Israël, les recruteurs de l’armée ont créé une unité
pour les minorités. Ils ont recruté des hommes druzes, leur accordant un accès
immédiat à leurs récoltes (occupées par les Israéliens) en échange de la
promesse d’un futur service militaire. Ya’acov Shim’oni, un fonctionnaire du
ministère des Affaires étrangères, expliquait à l’époque que l’unité des
minorités n’avait guère d’importance tactique sur le champ de bataille, mais qu’elle
était utile comme « la lame acérée d’un couteau pour poignarder dans le dos l’unité
arabe ». En 1956, Israël a instauré la conscription obligatoire pour les hommes
druzes. C’est la loi du pays depuis lors.
L’État a également contribué à
définir les limites des possibilités d’emploi pour les Druzes, en les orientant
vers l’armée. Comme l’écrit Firro, « l’effondrement progressif de l’agriculture
dans les villages druzes » est « en grande partie le résultat de l’intensification,
après 1949, de la politique israélienne de confiscation des terres. En 1962,
les Druzes avaient perdu plus des deux tiers de leurs terres, et l’eau allouée
à l’agriculture dans leurs villages représentait moins de 0,05 % de l’approvisionnement
total en eau d’Israël ». Privés d’agriculture, les hommes druzes ont trouvé de
plus en plus d’emplois dans les forces armées israéliennes. « Ce qui est requis
[pour ce secteur], écrit Firro, c’est la discipline, l’adhésion aux politiques
officielles, la loyauté [...] [et] une dépendance presque totale à l’égard des
autorités israéliennes ».
Au début des années 70, une
organisation appelée Comité d’initiative druze a été créée par le Parti communiste israélien pour
lutter contre les tentatives incessantes du gouvernement israélien visant à
séparer les Druzes des Arabes. En partie en réponse à cela, le ministère
israélien de l’Éducation a introduit en 1975 un programme scolaire distinct
pour les Druzes, qui existe encore aujourd’hui. (C’est le programme scolaire
dans lequel Kayoof a été éduquée.) Une commission nationale de l’éducation a
déclaré que l’objectif de ce programme était « d’éduquer et d’inculquer aux
jeunes Druzes une conscience israélo-druze ».
La perception de la religion
druze elle-même est un autre sujet délicat : cette religion est considérée par
les Israéliens juifs comme vaguement mystérieuse. Formée vers l’an 1000 après
J.-C. comme une branche de l’islam, elle est unique à bien des égards. Le Pew
Center écrit : « Il n’y a pas de jours saints
fixes, de liturgie régulière ou d’obligations de pèlerinage, car les Druzes
sont censés être connectés à Dieu à tout moment. [...] La tradition druze
honore également plusieurs « mentors » et « prophètes », dont Jéthro de Madian
(beau-père de Moïse), Moïse, Jésus, Jean-Baptiste et le prophète Mohamed », et
tient « en haute estime » des personnages tels que « Socrate, Platon, Aristote
et Alexandre le Grand ». Il est également vrai que la foi druze est largement
hermétique : les Druzes interdisent les mariages mixtes. Mais certains Druzes
affirment que les universitaires juifs ont trop insisté sur la nature
ésotérique de la religion, créant implicitement un autre moyen de distinguer
les Druzes des Arabes d’Israël, qu’ils soient chrétiens ou musulmans.
Toutes ces multiples façons de
séparer les Druzes des Arabes ont clairement porté leurs fruits. Dans une
interview accordée à un chercheur de l’université Cornell en 2017, un
professeur d’histoire d’un lycée du grand village druze de Yarka se souvient :
« Mes élèves m’ont un jour demandé comment je me définissais. J’ai répondu que
j’étais arabe et druze. Ils m’ont alors demandé : “Pourquoi dites-vous arabe si
vous êtes druze ?” »
 KHALED FARRAG, 37 ans, est un autre cofondateur d’Urfod. Il est
également directeur à plein temps de Grassroots Jerusalem, un réseau
communautaire actif dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est. Il a grandi
dans un petit village à majorité arabe chrétienne de Haute Galilée appelé Rama,
où il a suivi le programme scolaire arabe et non druze. « Ce n’est pas aussi...
manipulateur », dit-il.
KHALED FARRAG, 37 ans, est un autre cofondateur d’Urfod. Il est
également directeur à plein temps de Grassroots Jerusalem, un réseau
communautaire actif dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est. Il a grandi
dans un petit village à majorité arabe chrétienne de Haute Galilée appelé Rama,
où il a suivi le programme scolaire arabe et non druze. « Ce n’est pas aussi...
manipulateur », dit-il.
Dès son plus jeune âge, il savait
qu’il refuserait de servir dans l’armée israélienne. Puis il a été accepté au
lycée United World College, dans l’ouest de la Norvège, et cette attitude s’est
renforcée. « J’ai rencontré des Palestiniens de Gaza, de Hébron, de Bethléem »,
raconte Farrag à propos de son séjour dans la ville glaciale de Fleke. « J’ai
pris mes distances avec cette atmosphère [du Moyen-Orient], avec cette tension,
et j’ai pu observer la situation de loin. »
Après avoir obtenu son diplôme,
il est rentré chez lui. Il avait 18 ans. À son arrivée à l’aéroport Ben Gourion
de Tel Aviv, un mandat l’appelant à servir dans l’armée israélienne l’attendait.
Comme tous ceux qui refusent de
servir à 18 ans, Farrag était déjà officiellement considéré comme un soldat de
l’armée israélienne. Lorsqu’il a déclaré son refus, il a donc été soumis à la
procédure judiciaire de l’armée. Il a d’abord été condamné à deux mois de
prison militaire, « pour me faire changer d’avis », explique-t-il. Il a ensuite
été emmené dans une base de l’armée où, pendant plusieurs mois, il a été
présenté devant des commissions chargées d’évaluer son aptitude générale et sa
santé mentale. « Le plus dur, c’est que j’ai dû me débrouiller tout seul »,
raconte-t-il. Nous étions en 1999, et il n’existait aucune organisation comme
Urfod. « Ma famille me soutenait, mais il n’y avait pas de structure, pas de
mouvement. »
Farrag a finalement obtenu son
exemption en affirmant qu’il n’était pas apte mentalement à servir. Au total,
la procédure a duré près de sept mois. On ignore combien d’autres hommes druzes
ont subi le même sort. Méfiante à l’égard des statistiques internes de l’armée
israélienne sur la question, l’Urfod n’a pas demandé de chiffres à l’armée,
mais l’organisation prévoit de soumettre prochainement une demande de décompte
précis à la Knesset. Au moment de la publication de cet article, l’Urfod
accompagnait activement huit jeunes qui refusaient de servir, dont certains
avaient déjà purgé une peine de prison.
« Je peux imaginer que, quand on
est enfant, voir son voisin ou son cousin rentrer à la maison avec un uniforme
brillant et un gros fusil rutilant, il y a quelque chose d’attrayant dans cette
force », explique Farrag. « Mais pour moi, la politique a toujours été présente
dans notre foyer. La première fois qu’on entend dire que « les Druzes ne sont
pas arabes », ça n’a aucun sens. Votre culture, votre langue, votre histoire :
tout est arabe. »
Techniquement, la mission d’Urfod
est d’ordre pratique : ils sont là pour aider les Druzes à s’opposer au service
militaire dans l’armée israélienne. Mais derrière cela se cache une volonté de
mettre au jour l’histoire radicale enfouie de leur peuple. Kayoof décrit ainsi
son organisation : « Une grande partie de notre activisme consiste à
sensibiliser le public à l’existence de mensonges et de mythes. Mais notre
vision est beaucoup plus large. Nous considérons que nous défendons une
idéologie de libération. »
Les universitaires juifs qui ont
écrit sur les Druzes ont véhiculé l’idée qu’ils étaient un peuple
historiquement enclin à se soumettre à tout pouvoir en place. Farrag propose un
récit différent : « Les Druzes ne s’allient pas au pouvoir en place pour se
protéger, comme Israël vous l’enseigne, non ! Ils combattent le colonialisme.
La révolte contre les colonialistes français en Syrie [dans les années 1920] a
commencé avec la communauté druze. Les Druzes sont des Arabes et
font partie intégrante de la lutte arabe pour la libération.
Quand il s’adresse aujourd’hui
aux jeunes Druzes, il se montre patient : « Je ne vous dis pas de devenir
Palestiniens dès maintenant. Je ne vous dis pas de ne pas vous engager dans l’armée.
Je vous dis d’apprendre votre véritable histoire, puis de vous faire votre
propre opinion. »
Mais malgré l’enthousiasme de
Farrag, une question importante plane sur la solidarité théorique entre les
Druzes et les Arabes. L’identité nationale palestinienne s’est en grande partie
formée et consolidée au cours des 70 dernières années en réponse à l’oppression
israélienne. Les Druzes peuvent-ils donc « devenir » palestiniens sans avoir
vécu la même expérience ?
Le Dr Saree Makdisi, professeur d’anglais
palestino-USaméricain à l’UCLA et auteur de Palestine Inside Out: An
Everyday Occupation, pense que la réponse est oui. « Les Palestiniens
druzes sont aussi palestiniens que n’importe quel autre Palestinien »,
affirme-t-il. « La confusion résulte d’une volonté délibérée d’Israël de
brouiller l’identité palestinienne. »
Makdisi poursuit : « Il n’est pas
facile de renoncer même aux avantages illusoires qu’un État racial vous
accorde. » Mais avec l’adoption du projet de loi sur l’État-nation, lui aussi
entrevoit un changement potentiel. « Cette chute du voile du « libéralisme »
israélien permettra-t-elle enfin aux Druzes palestiniens de prendre conscience
qu’ils ont été manipulés pour servir et rester loyaux à un État qui, en fin de
compte, les méprise en tant que Palestiniens ? On ne peut qu’espérer. »
IL EST CERTAINEMENT trop réducteur d’imaginer qu’il existe aujourd’hui
un schisme net au sein de la communauté druze entre ceux qui aspirent toujours
au statu quo et ceux qui sont impatients de continuer à dénoncer les fables qui
le sous-tendent. Mais il convient de rappeler que certains se sentent stimulés
par ces développements, tandis que d’autres s’en trouvent affaiblis. Les jeunes
Druzes comme Farrag et Kayoof, représentatifs d’une frange plus radicale de la
communauté, saluent la loi sur l’État-nation comme un réveil. Salim Brake, 53
ans, qui incarne à tous égards l’image d’un druze bien intégré, trouve cela
déchirant.
Brake, politologue enseignant à l’Université ouverte d’Israël, est originaire de Majdal Shams, dans le Golan, territoire conquis par Israël à la Syrie en 1967. Traditionnellement, les quelque 25 000 Druzes du Golan se considèrent comme des Druzes syriens et ne servent pas dans l’armée. Sous la rubrique « nationalité », les cartes d’identité israéliennes des Druzes syriens indiquent « indéfinie » [la’om lo mugdar en hébreu, NdT], ce qui est devenu une sorte de blague interne à une communauté obscure. Il y a même un bar à Majdal Shams qui s’appelle Indéfini [ouvert en 2010, il a ensuite changé de nom, devenant le “Pourquoi ?”, NdT].
Mais Brake vit désormais avec sa
famille à Carmiel, une ville majoritairement juive située à une heure et demie
au sud-ouest de Majdal Shams. « Je suis fier d’être citoyen israélien. Je veux
que cela fasse partie de ma vie », déclare-t-il.
Le fils de Brake a 15 ans ; sa
langue maternelle est l’hébreu et tous ses amis sont juifs. Mais la fille de
Brake, âgée de 9 ans, a récemment commencé à lui demander si elle serait
considérée comme différente par ses camarades juifs. « Je ne m’attendais pas à
être confronté à ces questions », confie Brake. « J’aime beaucoup le peuple
juif. C’est un phénomène très particulier. Et je suis très influencé par Freud.
Mais le comportement du gouvernement israélien au cours des 20 dernières
années... » Il s’interrompt, puis poursuit, l’émotion montant : « Je ne monte
pas les Druzes contre les Juifs. Je dis : “OK, nous traversons une mauvaise
période. Vous allez vous coucher le soir, vous vous réveillez le matin, vous
espérez que les choses changeront” ». Il marque une pause. « Je ne suis pas sûr
que ce que je dis à mes enfants soit vraiment la vérité. »
Depuis des années, certains amis
druzes et arabes de Brake l’accusent de se mentir à lui-même quant à son
sentiment d’acceptation par les Israéliens. Il a toujours rejeté cette
accusation. Mais « au fond de moi, je pensais qu’ils avaient raison ». Ces voix
dissidentes semblent plus fortes depuis l’adoption de la loi sur l’État-nation.
Avant de conclure notre
conversation, nous abordons le sujet du service militaire de son fils dans l’armée
israélienne. Lorsqu’on lui demande s’il pense que son fils s’engagera lorsqu’il
sera appelé à 18 ans, Brake répond sans hésiter oui.