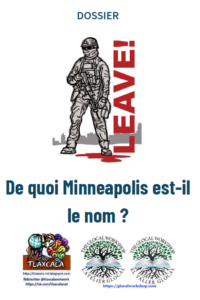NdT
Ci-dessous, traduits par Tlaxcala, deux articles d’intellectuels
afro-usaméricains sur les meurtres de Minneapolis et sur l’idéologie à l’œuvre dans
les crimes d’État trumpesques, avec un rappel historique salutaire.
Le
nationalisme « Sang et Sol »* qui a tué Alex Pretti et Renee Good
Pretti et
Good ont été étiquetés « terroristes intérieurs » par la Homeland** –
une rhétorique employée par l’administration pour justifier que l’État ôte la
vie, en associant les morts à la scélératesse nationale.
Ta-Nehisi Coates, Vanity Fair, 26/01/2026
Ta-NehisiCoates (Baltimore, 1975) est l’auteur de The Beautiful
Struggle, We Were Eight Years in Power, The Water Dancer, et Between the
World and Me, qui a remporté le National Book Award en 2015. Il est récipiendaire d’un National
Magazine Award et d’une bourse MacArthur. Il occupe actuellement la chaire
Sterling Brown au département d’anglais de l’Université Howard.
Suite au meurtre de la poète et écrivaine Renee Good, Donald Trump et ses collaborateurs ont fait tout leur possible pour la définir comme une ennemie de « la Patrie » L’administration affirme, par exemple, que Good était une « terroriste intérieure », un terme qu’elle applique désormais également à Alex Pretti, l’infirmier de réanimation tué par des agents fédéraux samedi. Cette rhétorique est employée pour justifier que l’État ôte la vie, en associant les morts à la scélératesse nationale. Mais la campagne contre Good est différente – parce que la Patrie porte un intérêt particulier et pervers aux femmes jugées insuffisamment respectueuses du foyer et de la famille. Les propagandistes de Trump nous disent que Good faisait partie d’une cabale grandissante de dames blanches insolentes devenues violentes ; qu’elle était une « agitatrice lesbienne » de connivence avec des « escrocs somaliens avec un QI de 68 » ; ou qu’elle était simplement, comme son meurtrier l’a apparemment qualifiée, une « fucking bitch » (une putain de salope). Pour ces péchés et d’autres, sa stigmatisation s’est prolongée dans l’au-delà : avec l’outil d’IA Grok d’Elon Musk, les utilisateurs ont produit en masse des deepfakes de Good avec des balles dans la tête et de son cadavre en bikini. Tout cela est approprié : en défendant les sans-papiers, Good a violé la sainteté de la Patrie, c’est-à-dire qu’elle a remis en question la promesse divine du sol américain à un peuple mythique et singulier.

American Progress de John Gast, vers 1872, que le Département de la Sécurité intérieure a récemment posté sur les réseaux sociaux. Bibliothèque du Congrès.
Car la
Patrie n’est pas « l’État » ni même « le Pays ». La Patrie
n’est pas définie par une simple géographie. Elle existe au-delà des lois et
des normes. Elle se moque des concepts usaméricains traditionnels comme « liberté »,
« libre arbitre » ou « pluralisme ». La Patrie est ce
morceau de terre providentiellement attribué au Volk. Les frontières de
la Patrie sont tracées dans un sang non souillé, sa sainteté exemplifiée par
une conduite genrée appropriée et l’accomplissement des rôles de genre. C’est
la Patrie que l’ICE vénère dans ses posts de recrutement parés de colons blancs
victorieux et d’Amérindiens écrasés. C’est la Patrie que Musk
a saluée
(deux fois) lors de l’investiture de Trump. C’est la Patrie que feu Charlie
Kirk aimait
invoquer
:
Je veux pouvoir me marier, acheter une
maison, avoir des enfants, leur permettre de faire du vélo jusqu’au coucher du
soleil, les envoyer dans une bonne école, avoir un quartier peu criminogène, ne
pas qu’on enseigne à mon enfant ces conneries lesbiennes, gays, transgenres à l’école.
Tout en n’ayant pas non plus à entendre l’appel à la prière musulman cinq fois
par jour.
On dit
souvent que la Patrie se méfie des immigrants, mais plus précisément, la Patrie
se méfie des aliens. Les demandeurs
d’asile de Gaza
fuyant un génocide n’ont pas leur place dans la Patrie ; les Afrikaners
souffrant de l’indignité de l’après-apartheid sont les bienvenus. La Patrie
convoite les Nord-Européens, mais considère les USAméricains d’origine
somalienne comme « des
déchets ».
« Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des gens de Norvège, de Suède, juste
quelques-uns ? », a
récemment déclaré Trump. « Mais nous prenons toujours des gens de Somalie, des
endroits qui sont un désastre, n’est-ce pas ? Crades, sales, dégoûtants,
infestés par la criminalité ». Les critères de ces distinctions – entre
immigrant putatif et alien indélébile – ne sont pas compliqués ; car
avant tout, la Patrie est un projet raciste.
Sécuriser la
Patrie est la caractéristique centrale de l’administration Trump. À Los Angeles
et Chicago, Trump cherche à la purifier. Avec le Groenland et le Venezuela,
Trump cherche à l’étendre et l’enrichir. Les hommes hétérosexuels sont les
défenseurs légitimes de la Patrie. Les agitatrices lesbiennes, comme Good, en
sont les ennemies jurées. Les chrétiens sont le sang vital de la Patrie. Les « stupides musulmans » en sont le cancer.
Une caractéristique de la Patrie est que ses ennemis doivent être infrahumains
– les membres de la communauté LGBTQ+ sont des « pédés », les femmes
récalcitrantes sont des truies « moches » , et les habitants de
Washington sont des « cafards”.

Portrait
de la militante usaméricaine des droits civiques Viola Liuzzo avec ses enfants. Getty
Images.
Pendant des
années, un certain type de libéraux a soit minimisé une telle rhétorique de
guerre culturelle venant de l’autre camp, soit exhorté les acteurs politiques
de tout bord à l’ignorer au profit de questions « matérielles » ou « du
quotidien » – comme si le fait que l’État considère la vie de quelqu’un
comme « des déchets » n’avait aucune conséquence tangible, comme si
les termes d’un combat pouvaient être déterminés par la personne qui reçoit les
coups. Mais Trump a clarifié un fait gênant – la guerre culturelle est une
vraie guerre. L’ICE, pleine de myrmidons de la Patrie, jouit d’un budget de 85
milliards de dollars, une somme « supérieure au budget militaire annuel de
tous les pays du monde à l’exception des USA et de la Chine », comme Caitlin
Dickerson l’a rapporté dans The Atlantic : « Immigration and
Customs Enforcement – juste une composante du Département de la Sécurité
intérieure – reçoit plus d’argent que toute autre agence d’application de la
loi en Amérique ».
Les
expulsions ont augmenté sous Trump, mais ce n’est pas le véritable but de l’ICE.
« Ils ne prennent pas au sérieux le
fait de se débarrasser du plus grand nombre de personnes possible. Ils prennent
au sérieux le fait de causer de la douleur et de la souffrance humaines »,
a déclaré un ancien responsable de l’ICE à Dickerson. « Mettre quelqu’un
en détention n’est pas une expulsion, c’est une punition ». Trente-deux personnes
sont mortes
sous la garde de l’ICE en 2025 – le nombre le plus élevé depuis 20 ans. Et comme
il sied à administration remplie de stars de la télé-réalité, une politique de
douleur et de souffrance humaines est actuellement reconditionnée comme
spectacle. Les portraits de militants arrêtés pour avoir défié la Patrie ont
été modifiés via l’IA. Des célébrités mineures, dont le statut douteux décline,
ont cherché à booster leurs perspectives en accompagnant
l’ICE
lors de raids ou même en
rejoignant ses rangs.
Kristi Noem, la chef du Département de la Sécurité intérieure, a posé devant un
groupe d’immigrants envoyés sur un site de torture au Salvador, dans un show d’excitation
sadique. En juin dernier, la superviseure du comté de Los Angeles Janice Hahn a
regardé Noem mener un raid de l’ICE à Huntington Park. « Je pouvais dire
qu’elle faisait une production complète avec équipe de tournage », a
déclaré Hahn.
« Elle se faisait coiffer et maquiller ». Noem, comme le président qu’elle
sert, a le sens du théâtral. Elle fait du cosplay [costumade] en tenue
de camouflage et gilets pare-balles. L’accent mis sur l’apparence et la valeur
de production est essentiel dans un mouvement qui cherche non seulement à
purifier l’USAmérique réelle, mais à ressusciter l’USAmérique de la légende et
du mythe. Sécuriser la Patrie, nous disent-ils, est une priorité existentielle.
C’est aussi du contenu.
De nombreux USAméricains,
horrifiés par les agents de la Patrie qui déferlent sur des communautés
entières, saisissent des enfants, emmènent en menottes des vieillards à moitié
nus, et détiennent qui bon leur semble, avec ou sans inculpation, tout en
jouissant d’une « immunité
absolue »,
se sont arrêtés sur un terme intéressant : “occupation”. Cette désignation est
aussi correcte qu’elle est peu originale – un fait dont plus d’USAméricains
feraient bien de se souvenir. L’ICE a contracté des outils de surveillance qui,
selon Joseph Cox de 404
Media, lui permettent de « suivre des téléphones sans mandat et de
suivre leurs propriétaires jusqu’à leur domicile ou leur employeur ». Ces
outils, déployés dans tout Minneapolis selon les rapports, n’ont pas été créés
en Amérique, mais en
Israël,
une autre patrie encore, qui applique « l’occupation » la plus longue
de l’histoire moderne. Ainsi, les citoyens du Minnesota ont, en tant que
contribuables usaméricains, subventionné une occupation à l’étranger qui est
effectivement un laboratoire pour la leur.
Nous ne
sommes pas tombés aveuglément dans cette ère de règne de la Patrie. Il y a près
de 25 ans, lorsque le Département de la Sécurité intérieure a été proposé pour
la première fois, il y avait des pressentiments, même parmi les partisans, que
les choses pourraient un jour en arriver là. « Homeland n’est pas
vraiment un mot américain », a
écrit Peggy Noonan
dans The Wall Street Journal en 2002. Elle soutenait la création du
département. Mais quelque chose la gênait dans le nom. « Ce n’est pas
quelque chose que nous disions ou disons maintenant. Cela a une résonance
vaguement teutonique – Ve must help ze Fuehrer protect ze Homeland! »
Le blogueur Mickey Kaus, écrivant pour Slate cette année-là, a
fait écho aux inquiétudes de Noonan, notant que le nom proposé pour le département « lie
explicitement nos sentiments à la terre, pas à nos idées ».
Russell
Feingold, qui était à l’époque le sénateur junior du Wisconsin, a vu quelque
chose de plus substantiel à l’œuvre. Feingold a vu des lacunes dans la
législation qu’un tyran en puissance pourrait facilement exploiter. Une telle
figure serait totalement dépourvue de vertu, et les collègues de Feingold ne
pouvaient imaginer que le peuple usaméricain, dans son infinie sagesse,
permettrait à un tel archi-méchant d’accéder à la présidence.
« Les
gens disaient : ‘Russ, aucun président ne ferait X, Y ou Z’ », m’a
récemment confié Feingold. « En d’autres termes, les normes sont assez
fortes pour que tu fasses figure de Cassandre." Feingold a été le seul
sénateur à voter contre le Patriot Act, et l’un des neuf seuls sénateurs à s’opposer
à la création du Département de la Sécurité intérieure. Il a observé avec
inquiétude comment, après le 11 septembre, la politique d’immigration du pays a
été absorbée par la lutte antiterroriste.

Un
portrait de Renee Nicole Good est collé à un lampadaire près du lieu de sa
fusillade. Photo prise le 8 janvier 2026 à Minneapolis, Minnesota. Stephen
Maturen/Getty Images
« Dès
que le 11 septembre s’est produit, en quelques secondes, il est devenu clair
que l’administration Bush allait cibler les Américains musulmans et arabes »,
a déclaré Feingold. En effet, sur une période de mois, le FBI a détenu 762
immigrés sans papiers, principalement de pays musulmans ou arabes, comme
personnes « d’intérêt ». Le Bureau de l’Inspecteur Général du
Département de la Justice a rapporté plus tard que la détention pouvait
résulter de quelque chose d’aussi simple que « le signalement par un
propriétaire d’activités suspectes d’un locataire arabe » ou la possession
« d’objets suspects », comme des photos du World Trade Center et d’autres
bâtiments célèbres. Ces hommes ont été détenus pendant des semaines ou des
mois, certains privés de contact avec des représentants légaux, certains
physiquement maltraités, et certains mis à l’isolement 23 heures sur 24. La
plupart ont été expulsés. Et bien qu’ayant fait l’objet d’une enquête après le
11 septembre, aucun n’a jamais été inculpé de quoi que ce soit en lien avec le
terrorisme.
En 2008,
après que Barack Obama eut remporté la primaire démocrate, Feingold a commencé
à voir émerger une autre tendance, plus ancienne, qui est fondamentale pour le
mythe de la Patrie. Alors qu’il était au Sénat, Feingold tenait à organiser des
réunions publiques dans les 72 comtés du Wisconsin. Les réunions étaient, selon
lui, « plutôt calmes », remplies de partisans et de quelques
conservateurs. « Elles étaient toujours civiles », dit Feingold. « Et
puis Obama est élu, et... je commence à aller à ces 15 dernières réunions
publiques environ, et c’était incroyable. Le gars n’avait même pas encore prêté
serment. Et tout à coup, toutes ces personnes ont commencé à venir, une sorte
de foule à l’air dur, et à huer et dire : « C’est un socialiste ; il n’est
pas né aux States ; il va faire ci, il va faire ça, et il y avait du feu dans
leurs yeux. Et c’était très étrange, parce qu’Obama avait remporté beaucoup de
ces comtés dans les zones rurales, et pourtant il y avait cette chose qui se
passait ».
Quand les
experts ont ensuite essayé d’attribuer la croissance du Tea Party, puis la
première élection de Trump, à « l’anxiété économique » et à une
classe ouvrière bafouée, Feingold était sceptique. Il y avait « toute
cette dynamique qui s’est cristallisée [en] ce sentiment que les Blancs étaient
assiégés », dit Feingold. « ça,
pour moi, c’est en quelque sorte le contexte politique qui ouvre la porte ».
Mais aussi
sceptique qu’il fût, Feingold n’a jamais vu les choses aller aussi loin. (Il a
perdu sa candidature à la réélection en 2010 face au républicain Ron Johnson,
un allié de Trump toujours en fonction et qui n’a pas encore commenté le
meurtre de Pretti.) « Je serai le premier à l’admettre, la raison pour
laquelle je l’ai fait était parce que je craignais qu’un jour il pourrait y
avoir quelqu’un qui ferait certaines de ces choses de manière abusive », dit
Feingold à propos de son vote contre le DHS, « mais je n’ai jamais imaginé
qu’il y aurait quelqu’un qui ferait toutes ces choses à chaque occasion ».
Le problème
survivra presque certainement à la présidence de Trump. Le budget de l’ICE a
régulièrement augmenté sous les administrations démocrates et républicaines. Ce
financement est allé à ce que le journaliste Radley
Balko appelle
« l’agence de police fédérale la plus voyoute, renégate, et certainement
pro-Trump ». Peu importe qui gagne les élections de mi-mandat cette année,
ou l’élection présidentielle de 2028, l’Armée de la Patrie restera, et ses
ennemis au Parti Démocrate semblent avoir peu d’envie de riposter.
Et donc, il
revient alors au peuple lui-même de le faire.
En ces
moments, je trouve du réconfort et de l’inspiration chez les ancêtres et les
martyrs. Il y a plus d’un demi-siècle, comme
l’a récemment noté l’écrivain Jelani Cobb [voir ci-dessous], la militante
Viola Liuzzo, mère au foyer de cinq enfants, a quitté sa famille à Détroit et s’est
rendue dans le Sud pour rejoindre la marche vers Montgomery, et ce faisant a
laissé derrière elle les privilèges de la condition de dame blanche. Pour avoir
transgressé contre la Patrie de cette époque – le Sud néo-confédéré – Liuzzo a
été assassinée par des suprémacistes blancs. Tout comme Good a
été diffamée par les autorités de la Patrie comme terroriste intérieure et « putain
de salope », Liuzzo a été diffamée par les dirigeants de la Patrie comme
une héroïnomane et nymphomane qui était allée dans le Sud pour cocufier son
mari.
Mais la
diffamation était, en elle-même, révélatrice, car elle démontrait les normes
perverses et exigeantes de la Patrie, son obsession de la hiérarchie, ses
frontières rigides et le prix élevé imposé à quiconque osait les franchir. Les
forces du Sud néo-confédéré « ne représentaient pas simplement une menace
pour les Afro-Américains, comme c’était la perception populaire », a écrit
Cobb. « Elles étaient un danger mortel pour quiconque n’était pas d’accord
avec elles, quels que soient sa race, son origine ou son genre ».
Peut-être
sommes-nous dans un tel moment maintenant, où une mort démontre au pays la
nature large de la menace. Mais c’est un espoir passif, et dans la vie de
Liuzzo, nous trouvons un appel à l’action plus actif. Liuzzo est née dans la
pauvreté. Son père était mineur de charbon ; son mari, un organisateur
syndical. Sa famille était du genre sel de la terre souvent célébré dans
les hymnes de la Patrie. Alors que la Patrie voit la liberté comme la seule
prérogative de sa tribu, la vision de Liuzzo s’étendait à l’humanité elle-même.
Tout en comprenant l’exploitation économique de sa famille, elle comprenait
aussi que la blanchitude l’avait enrôlée dans l’exploitation des autres.
Quand Liuzzo
a acquis cette connaissance, quand elle est devenue « éveillée » (woke),
elle a été transfigurée en traîtresse à sa race et en menace pour la Patrie.
Pour avoir été une menace, pour avoir été « éveillée », elle a été
tuée – tout comme Renee Good. (Et comme Alex Pretti.) Mais les révélations ont
aussi leurs bénédictions. En l’occurrence, une vie, aussi brève soit-elle, qui
est propre et ne dépend pas de l’oppression et de l’avilissement d’autrui. La
révélation de liens humains profonds, la croyance que nous sommes tous
également élus, a condamné Liuzzo, Good et Pretti, comme la révélation le fait
si souvent. Mais elle les a aussi immortalisés.
NdT
*« Sang et Sol » (Blut und Boden)
est un concept-clé de l’idéologie nazie, empruntant à des courants antérieurs,
qui postule un lien organique et exclusif entre une race pure et son territoire
ancestral. Utilisé pour justifier des politiques agricoles, expansionnistes et
génocidaires, il reste aujourd’hui une référence pour critiquer les formes
contemporaines d’ethnonationalisme exclusif.
**Homeland: litt. Patrie.
Désigne le Department of Homeland Security (DHS), super-ministère de l’Intérieur
fédéral créé au lendemain du 11
septembre, et employant actuellement environ 300 000 personnes, avec un budget
de plus de 103 milliards de $.
***Volk :
peuple/nation/race en allemand ; adjectif
dérivé : « völkisch »
CASSEZ-VOUS !
De Selma
à Minneapolis
En cette
journée Martin Luther King, la mort de Renee Good rappelle une autre femme
morte en protestant pour les droits d’autrui.
Jelani Cobb, The New Yorker,
19/01/2026
Jelani Cobb (New York,
1969) contribue au New Yorker depuis 2012 et est devenu membre de sa rédaction en
2015. Il écrit fréquemment sur la race, la politique, l’histoire et la culture.
Ses livres incluent "Three or More Is a Riot: Notes on How We Got Here,
2012-2025" et "The Substance of Hope: Barack Obama and the Paradox of
Progress". Il
est éditeur, avec David Remnick, de "The Matter of
Black Lives",
une anthologie d’écrits du New Yorker sur la race en Amérique. Sa thèse
de doctorat à l’Université Howard s’intitulait Antidote to Revolution: African
American Anticommunism and the Struggle for Civil Rights, 1931--1957 (Columbia
University Press, 2004). Il a remporté le prix Sidney Hillman 2015 pour le
journalisme d’opinion et d’analyse, pour ses chroniques sur la race, la police
et l’injustice. Il est doyen de la Columbia Journalism School depuis 2022.
La
voiture de Viola Liuzzo transportait d’autres militants après la marche de
Selma à Montgomery. Archives Photos / Getty
Le 16 mars
1965, une femme de trente-neuf ans nommée Viola Liuzzo est montée dans une
Oldsmobile de modèle récent et a parcouru huit cents miles depuis sa maison de
Détroit, Michigan, jusqu’à Selma, Alabama. Quelques jours plus tôt, suite aux
manifestations du Dimanche Sanglant, où des manifestants pour le droit de vote
avaient été gazés et battus, le Dr Martin Luther King, Jr., avait lancé un
appel aux personnes de conscience à travers le pays pour qu’elles viennent en
Alabama et participent à ce qui était déjà devenu l’un des théâtres les plus
importants du mouvement pour l’égalité. Liuzzo, une femme blanche née en
Pennsylvanie, avait déménagé au Michigan, où elle avait finalement épousé un
responsable des Teamsters [syndicat des camionneurs, NdT] et était
devenue active à la N.A.A.C.P. de Détroit. Elle a dit à sa famille et à ses
amis qu’elle se sentait obligée de faire quelque chose concernant la situation
en Alabama, a organisé la garde de ses cinq enfants et a roulé vers le sud.
Le 25 mars,
la troisième tentative de marche de Selma à Montgomery, la capitale de l’État,
s’est avérée réussie, et King a prononcé l’un de ses discours les moins connus
mais les plus significatifs sur la manière dont la privation du droit de vote
des électeurs noirs avait été essentielle pour démanteler la politique
progressiste interraciale dans tout le Sud. « La ségrégation raciale »,
a souligné King, « n’est pas survenue comme un résultat naturel de la
haine entre les races immédiatement après la guerre civile ». Elle avait
plutôt évolué, a-t-il soutenu, dans le cadre d’une campagne plus large visant à
détruire l’alliance naissante entre les anciens esclaves et les Blancs
dépossédés qui est apparue pendant la Reconstruction. Ensuite, Liuzzo, qui s’était
portée volontaire pour transporter des militants entre les deux villes, a roulé
vers Montgomery avec Leroy Moton, un organisateur noir de dix-neuf ans. Ils ne
sont jamais arrivés. La voiture de Liuzzo a été interceptée par une voiture
transportant quatre hommes associés au Ku Klux Klan. Des balles ont été tirées
dans la voiture de Liuzzo, la tuant. Moton, couvert du sang de Liuzzo, a fait
semblant d’être mort, puis est parti chercher de l’aide après le départ des tueurs.
Le meurtre a
envoyé des ondes de choc à travers le mouvement et à travers la nation. Les
travailleurs des droits civiques Andrew Goodman, James Chaney et Michael
Schwerner avaient été assassinés à Philadelphie, Mississippi, l’été précédent,
et en février de la même année, Jimmie Lee Jackson, un marcheur de vingt-six
ans, avait été mortellement abattu par un policier de l’État de l’Alabama après
une manifestation pour le droit de vote. Deux semaines avant que Liuzzo ne soit
attaquée, le révérend James Reeb, un ministre unitarien et membre de la
Southern Christian Leadership Conference de Boston qui était également bénévole
dans la campagne pour le droit de vote, avait été battu à mort. Néanmoins, la
mort de Liuzzo – et, spécifiquement, le fait que les antagonistes du mouvement
étaient prêts à tuer une femme blanche – pointait vers une conclusion plus
large. Les forces alignées contre le mouvement ne représentaient pas simplement
une menace pour les Afro-Américains, comme c’était la perception populaire.
Elles étaient un danger mortel pour quiconque n’était pas d’accord avec elles, quels
que soient sa race, son origine ou son genre.
Les
événements récents ont donné une pertinence renouvelée aux circonstances de la
mort de Viola Liuzzo. À Minneapolis, le 7 janvier, Renee
Good, une
poète et mère de trois enfants de trente-sept ans originaire du Colorado, a été
tuée par Jonathan Ross, un agent de l’Immigration and Customs Enforcement qui a
tiré sur sa voiture alors qu’elle tentait de s’enfuir. Good, qui venait de
déposer son plus jeune enfant à l’école, tentait de bloquer la rue dans le
cadre d’une protestation contre une vaste répression de l’ICE qui
assiège Minneapolis depuis des semaines. Superficiellement, les circonstances
des deux morts, séparées de plus de soixante ans, présentaient quelques
ressemblances : deux femmes blanches d’âge similaire, toutes deux poussées par
leur conscience à venir défendre des communautés vulnérables, toutes deux tuées
dans leurs véhicules au milieu d’un conflit sociétal beaucoup plus large se
déroulant autour d’elles.
Pourtant, il
y a des similitudes plus troublantes dans ce qui s’est passé après leurs morts,
et dans ce qu’elles ont révélé sur les crises dans lesquelles elles sont
survenues. Les funérailles de Liuzzo, à Détroit, ont attiré les leaders du
mouvement, dont King et Roy Wilkins, le secrétaire exécutif de la N.A.A.C.P.,
ainsi que des personnalités du syndicalisme organisé, comme Walter Reuther et
Jimmy Hoffa. Néanmoins, le F.B.I. de J. Edgar Hoover a immédiatement lancé une
campagne de diffamation contre Liuzzo, affirmant faussement que des preuves
physiques suggéraient qu’elle avait consommé de l’héroïne peu avant sa mort et
laissant entendre qu’elle avait été attirée en Alabama non pas par des
principes profondément ancrés mais par la perspective de relations sexuelles
avec des hommes noirs. Le Bureau tentait probablement de détourner l’attention
du public du fait que l’un des quatre hommes dans la voiture lorsque Liuzzo a
été tuée était un « agent infiltré » – un indicateur payé – qui n’avait
apparemment rien fait pour empêcher sa mort. Hoover avait peut-être décidé que
si le caractère de Liuzzo pouvait être suffisamment discrédité, alors tout
contrecoup potentiel à la connexion du Bureau avec un incident impliquant le
meurtre d’une mère de famille blanche pourrait être évité.
Compte tenu
du cynisme et de la malhonnêteté qui ont défini la seconde administration
Trump, il n’était pas surprenant de voir un schéma similaire émerger dans les
heures suivant la mort de Good. Trump a initialement affirmé que Good avait
renversé Ross avec sa voiture, l’accusant d’avoir « agi horriblement »
et laissant entendre qu’elle était responsable de sa propre mort. La Secrétaire
à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, est allée plus loin et a accusé Good de
s’être livrée à un acte de « terrorisme intérieur ». La porte-parole
de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a dénigré Good comme « une
folle dérangée ». L’objectif clair de cette campagne était de faire
paraître l’inconcevable raisonnable, et le raisonnable louable.
Pourtant,
malgré toutes les similitudes entre les préjudices subis par Liuzzo et Good, il
y a la possibilité troublante que les circonstances entourant la mort de cette
dernière soient encore plus sombres. Le lendemain du meurtre de Liuzzo, le
président Lyndon B. Johnson a déclaré qu’elle avait été « assassinée par
les ennemis de la justice qui pendant des décennies ont utilisé la corde et le
pistolet, le goudron et les plumes pour terroriser leurs voisins ». Les trois hommes inculpés pour sa mort ont été
acquittés des accusations de meurtre lors d’un procès étatique, mais reconnus
coupables d’accusations fédérales de violation des droits civiques, et ont
écopé chacun d’une décennie de prison, bien que l’un soit mort avant le début
de sa peine.
La mort de
Good est survenue dans un paysage où l’implication fédérale va au-delà de la
volonté de fournir une histoire de couverture pour les actions de Ross jusqu’au
refus du Département de la Justice d’enquêter même si la fusillade a violé les
droits civiques de Good. Le D.O.J., en fait, est allé dans la direction
opposée, poussant pour une enquête criminelle sur la veuve de Good, tout en
refusant d’enquêter sur le tireur ; six procureurs fédéraux de carrière du
Minnesota ont démissionné en réponse. (Vendredi, il a été rapporté que le
D.O.J. avait ouvert une enquête criminelle sur le gouverneur de l’État, Tim
Walz, et le maire de Minneapolis, Jacob Frey, pour conspiration présumée visant
à entraver l’application de la loi fédérale.) Même à ce stade précoce, les
implications de la mort de Good sont claires. La déclaration du vice-président
J. D. Vance selon laquelle l’ICE peut opérer avec une « immunité
absolue » clarifie le sentiment que l’agence opère comme une sorte de
police secrète pouvant agir en toute impunité, sachant que les mécanismes de
responsabilité ont été annulés par le Président à qui ils doivent leur
allégeance première. L’ICE a commencé ce chapitre en antagonisant et en
détenant des personnes qu’elle prétendait être sans papiers, mais le danger s’est
étendu bien au-delà de toute communauté unique à quiconque – à travers les
lignes de genre, d’origine ou de statut de citoyenneté – ayant la témérité de
dissentir.

MINNEAPOLICE
Protège les riches et la blanchitude depuis 1967
Nous nous souvenons de...
...et de tant d'autres