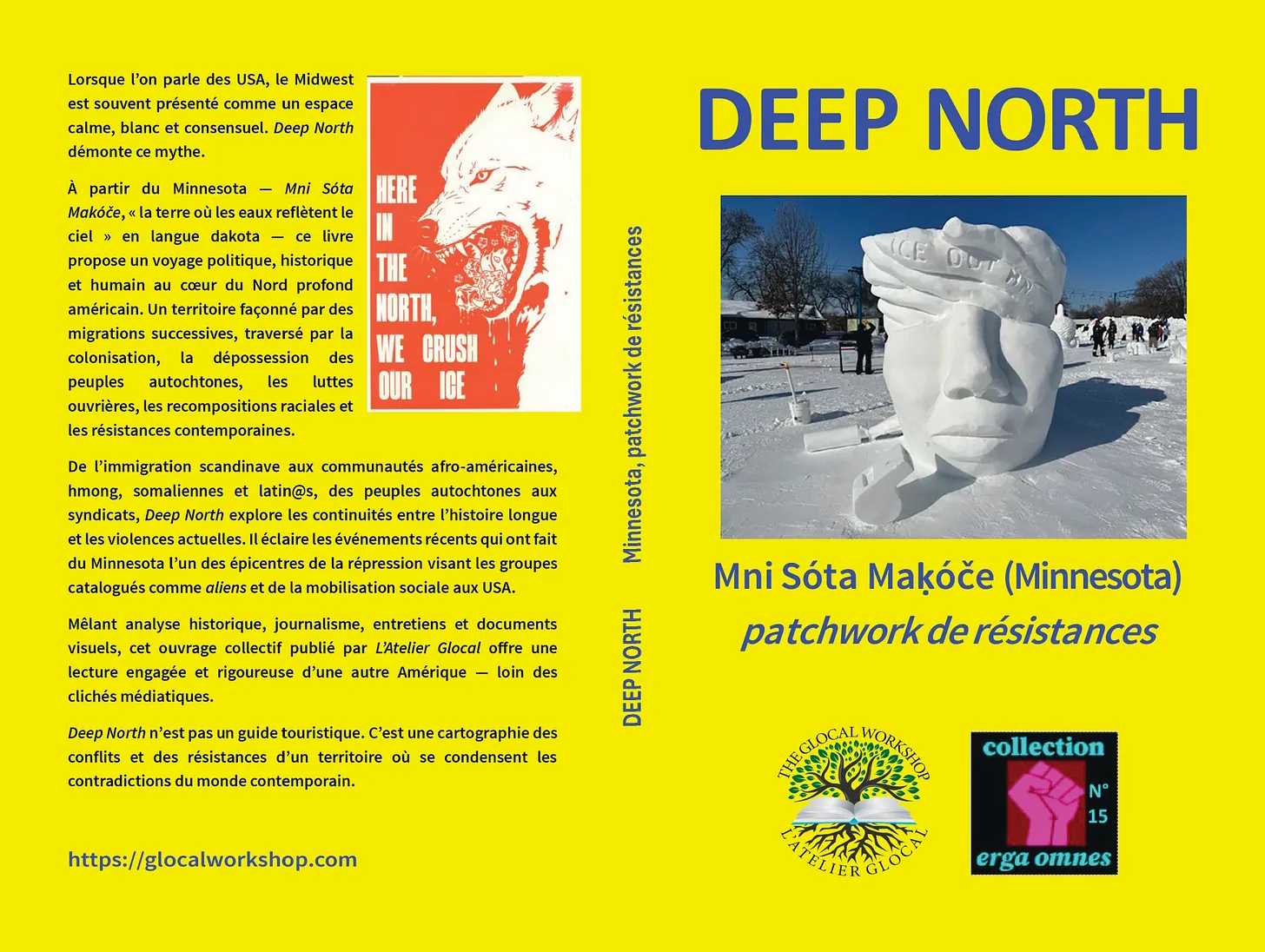Pat Bagley, Salt Lake Tribune, 25-8-2025
Tom Homan, el «zar de las fronteras» de Trump, declaró el 12 de febrero que la Operación Metro Surge, iniciada a principios de diciembre en Minnesota, había concluido.
Han sido necesarias tres muertes —Renee Nicole Good, Víctor Manuel Díaz y Alex Pretti—, varios cientos de heridos y entre 3000 y más de 4000 detenciones de extranjeros, en su mayoría calificados como «extranjeros ilegales criminales». Hasta la fecha no se ha publicado ningún balance consolidado de las expulsiones efectivas. Los datos disponibles siguen siendo fragmentarios y son objeto de controversia en cuanto a la naturaleza de las detenciones y el perfil de las personas arrestadas. La operación, llevada a cabo principalmente por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza), ha sido calificada por Washington como «la mayor operación de control migratorio jamás realizada» en el interior de los USA.
Se puede constatar que la sociedad y las autoridades de Minnesota han obtenido una victoria sobre la maquinaria federal trumpista. Su resistencia, que llegó hasta una huelga general, ha escrito una nueva página en la historia de la otra América, la de abajo, la de las «grassroots», las bases autoorganizadas ad hoc según relaciones de vecindad, afinidad, intercomunitarias, interclasistas, intergeneracionales e interconfesionales. Las ediciones The Glocal Workshop/L’Atelier Glocal publicarán la próxima semana un libro en francés [la versión española se está preparando] titulado Deep North: Mni Sóta Makóche (Minnesota), patchwork de resistencias, que reconstruye la genealogía de las sucesivas migraciones y luchas que han dado forma a Minnesota durante un siglo y medio. Mientras tanto, les ofrecemos la traducción de tres artículos.
El primero se centra en los artífices cruciales de la resistencia, l@s periodistas ciudadan@s armad@s con sus celulares; el segundo plantea la cuestión fundamental tras el Metro Surge: Washington debe rendir cuentas, el ICE y su jefa Kristi Noem deben irse. El tercer artículo presenta una iniciativa de dos estudiantes que consiste en proporcionar un mapa interactivo de las operaciones policiales contra l@s inmigrantes a escala nacional y en tiempo real. -Fausto Giudice, Tlaxcala
L@s periodistas ciudadan@s son l@s héroe·ínas
anónim@s de Minneapolis
Sin sus videos de los tiroteos de ICE, no sabríamos lo que realmente está sucediendo.
Mark Hertsgaard, The Nation,
29-1-2026
Mark Hertsgaard es el corresponsal de medio ambiente de The Nation y el director ejecutivo de Covering Climate Now [Cubriendo el Clima Ahora]. una colaboración periodística global cofundada por Columbia Journalism Review y The Nation que fortalece la cobertura de la historia climática. Su nuevo libro es Big Red’s Mercy: The Shooting of Deborah Cotton and A Story of Race in America.
Minnesotanas graban a un agente de las fuerzas del orden federales durante una patrulla en Minneapolis, el 11 de enero de 2026. Foto: Victor J. Blue / Bloomberg vía Getty Images.
El domingo 25 de enero por la tarde, el presentador de CNN, Jake
Tapper, entrevistaba a la diputada Alexandria Ocasio-Cortez horas después de
que agentes de la patrulla fronteriza mataran a Alex Pretti. De repente, CNN
interrumpió la transmisión para cubrir en vivo la conferencia de prensa de la
secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Noem declaró que Pretti había
“atacado a nuestros oficiales” mientras “blandía” una pistola y planeaba “matar
a las fuerzas del orden"” Cuando un periodista intentó hacer una pregunta
sobre su afirmación, ella lo interrumpió para decir: “Eso no es una afirmación.
Son los hechos”. Cuando otro periodista señaló que la Casa Blanca acababa de
calificar a Pretti de “terrorista doméstico”, Noem asintió enérgicamente.
Para entonces, videos de transeúntes del tiroteo
estaban apareciendo en línea y en medios de comunicación. Cuando Tapper reanudó
su entrevista con Ocasio-Cortez, la diputada dijo que Noem y la administración
Trump “le estaban pidiendo al pueblo usamericano que no crea en sus propios
ojos... que entreguen su creencia en cualquier cosa que ellos digan. No le
estoy pidiendo al pueblo usamericano que me crea a mí, o a ella, sino que se
crea a sí mismo”.
Cualquier periodista que haya estado prestando
atención sabe que el jefe de Noem, el presidente Donald Trump, a menudo no dice
la verdad. Trump lanzó su carrera política afirmando sin pruebas que el primer
presidente negro de USA no había nacido en el país, lo que habría significado
que Barack Obama estaba en el poder ilegalmente. Después de perder las
elecciones de 2020, Trump dijo que no tenía planes de dejar el cargo porque,
insistió, en realidad había ganado. Trump repite esa mentira hasta el día de
hoy, junto con su afirmación de que el ataque del 6 de enero de 2021 al
Capitolio para mantenerlo en el poder fue un día de “paz” y “amor”.
Pero al tejer su última red de mentiras, Trump y sus
ayudantes no contaron con el ingenio y el valor de los ciudadanos de Minnesota
que presenciaron a los oficiales de la patrulla fronteriza disparar a Pretti —
y a Renee Good antes que él — y grabaron los encuentros con sus teléfonos
celulares. Sin esa evidencia, la versión oficial de los hechos habría
tenecventaja en la configuración de la narrativa pública. Con esa evidencia,
sin embargo, es obvio que "Alex claramente no tiene un arma cuando es atacado",
como escribieron los "desconsolados pero también muy enojados" padres
de Pretti en un comunicado al día siguiente. "Tenía su teléfono en la mano
derecha, y su mano izquierda vacía está levantada sobre su cabeza tratando de
proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo". Del mismo modo,
los videos de transeúntes del tiroteo de Renee Good muestran que ella estaba
girando su vehículo alejándose del agente de ICE Jonathan Ross cuando él
disparó tres balas mortales a través de sus ventanas.
Lo sepan o no, los transeúntes que grabaron estos
videos son periodistas ciudadan@s. Son personas comunes, no entrenadas en el
periodismo convencional, y estaban dando testimonio de eventos de suma
importancia para su comunidad y su país. Y lo hacían en condiciones peligrosas,
como también lo ejemplificó Darnella Frazier, de 17 años, quien el 25 de mayo
de 2020 mantuvo valientemente su teléfono celular enfocado en el oficial de
policía Derek Chauvin durante los nueve minutos y 29 segundos que la rodilla de
Chauvin estaba ahogando la vida de George Floyd.
Los acontecimientos de los últimos días han demostrado
que l@s periodistas ciudadan@s, aunque no sustituyen a los profesionales,
pueden ser un complemento invaluable. Sin su presencia en la escena y su
entereza bajo presión, el público y el resto de los medios de comunicación
ignorarían un aspecto fundamental de la historia que se desarrolla en
Minneapolis. Solo escucharíamos la versión oficial de la verdad, que, dados los
antecedentes de la administración Trump de falsedades flagrantes, merece un
escepticismo extremo. Sin estos videos, es casi inconcebible que los consejos
editoriales de tres de los periódicos más influyentes de USA — The New York
Times, The Washington Post y The Wall Street Journal — estén
declarando que la narrativa de la administración desafía la credibilidad o que
la propia administración estaría tratando de retractarse de sus calumnias
iniciales contra Pretti.
Todas las partes del sistema de información moderno,
desde las salas de redacción tradicionales hasta l@s influenciador@s de las
redes sociales, pueden ahora presentar una versión más completa de lo que está
sucediendo en Minnesota y permitir que los espectadores y lectores saquen sus
propias conclusiones. Y podemos explorar preguntas urgentes planteadas por
estos videos, como: ¿A cuántas personas más podrían haber matado los agentes de
ICE cuando no había cámaras grabando? Trabajando en conjunto en este momento
crítico para la democracia usamericana, l@s periodistas ciudadan@s y
profesionales pueden cumplir la misión esencial que los fundadores de la nación
imaginaron para una prensa libre: informar al pueblo y exigir cuentas al poder.
ICE se derrite* en el invierno de Minneapolis
Ahora es el momento de abolir la agencia y destituir a Kristi Noem.
John Nichols, The Nation, 13-2-2026
John Nichols es el editor ejecutivo de The Nation. Anteriormente se desempeñó como corresponsal de asuntos nacionales y corresponsal en Washington de la revista. Nichols ha escrito, coescrito o editado más de una docena de libros sobre temas que van desde historias del socialismo usamericano y el Partido Demócrata hasta análisis de los sistemas mediáticos de USA y globales. Su último libro, coescrito con el senador Bernie Sanders, es el éxito de ventas del New York Times It’s OK to Be Angry About Capitalism.
*ICE, acrónimo de Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), también significa «hielo» en inglés, de ahí el juego de palabras que se ha vuelto habitual, especialmente en Minnesota, bajo la nieve invernal.
Los habitantes de Minneapolis alzaron sus voces en
gloriosa oposición a la ocupación federal de su ciudad con tal energía, y tal
belleza, que el mundo entero escuchó su grito de justicia. Y nunca se
rindieron. Solo días antes de que el “zar fronterizo” de Donald Trump, Tom
Homan, anunciara formalmente que la mortal arremetida del Departamento de
Seguridad Nacional, que desplegó a miles de agentes armados y enmascarados de
ICE en su ciudad, terminaría, 1600 habitantes de Minnesota habían llenado la
cavernosa Iglesia Luterana Central en el centro de Minneapolis con el coro de
su resistencia cantada:
Resiste
Resiste
Mi querida
Aquí llega el amanecer...
Cuando llegó el amanecer el jueves, después de más de
dos meses de violencia y crueldad — que incluyeron miles de arrestos,
detenciones y deportaciones, y el asesinato de la poeta y madre de tres hijos
Renee Good y del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti — el alcalde de
Minneapolis, Jacob Frey, se acercó tanto como un ciudadano de Minnesota puede a
declarar la victoria.
“Pensaron que podían quebrantarnos, pero el amor por
nuestros vecinos y la determinación de resistir pueden sobrevivir a una
ocupación. Estos patriotas de Minneapolis están demostrando que no se trata
solo de resistencia — estar al lado de nuestros vecinos es profundamente usamericano”,
dijo el alcalde, quien en enero anunció: “Al ICE, ¡lárguense de Minneapolis!”
“Esta operación ha sido catastrófica para nuestros
vecinos y negocios, y ahora es hora de un gran regreso”, dijo Frey. “Mostraremos
el mismo compromiso con nuestros residentes inmigrantes y la misma resistencia
en esta reapertura, y espero que todo el país nos acompañe mientras avanzamos”.
Frey agregó: “Las personas que merecen el crédito por
el fin de esta operación son los 435,000 residentes que llaman hogar a
Minneapolis”. Tiene razón. La resistencia pacífica a la arremetida de 3,000
agentes de ICE y la patrulla fronteriza, mal entrenados e irresponsables,
desplegados por el Departamento de Seguridad Nacional en la ciudad — con
marchas masivas, vigilancia vecinal y redes de ayuda mutua para apoyar a los
vecinos amenazados — fue tan resistente como hermosa. Y forma un modelo para la
resistencia en las ciudades que podrían ser el próximo objetivo.
Sin embargo, Frey también fue correcto al describir el
daño causado por más de dos meses de ocupación federal como “catastrófico”.
Además de los asesinatos, los arrestos y detenciones,
y las deportaciones de hombres, mujeres y niños, el impacto económico de la “Operación
Arremetida Metropolitana” de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem,
fue abrumador. El miedo que se apoderó de la ciudad era palpable. Trabajadores
y clientes tenían miedo de salir de sus hogares, dejando a restaurantes y
tiendas luchando por mantenerse abiertos. “El largo camino hacia la
recuperación comienza ahora”, dijo el jueves el gobernador de Minnesota, Tim
Walz, al anunciar un plan para proporcionar “$10 millones en ayuda directa para
ayudar a las empresas afectadas por la ‘Operación Arremetida Metropolitana’ a
estabilizarse, proteger empleos y volver a una base sólida”.
En una nación liderada por adultos responsables con un
mínimo de interés en el servicio público, esa ayuda se complementaría con
asistencia financiera federal. Pero el presidente Trump y el Congreso
republicano todavía están conspirando para darle más dinero a Noem y sus
secuaces para expandir las operaciones de ICE. Quizás han reconocido su error
al atacar Minneapolis, pero no han aprendido la lección. Y no se les ha pedido
cuentas.
“La Operación Arremetida Metropolitana termina porque
los ciudadanos de Minnesota lucharon”, dijo el fiscal general de Minnesota,
Keith Ellison, quien agregó: “Todavía merecemos transparencia, y Renee Good y
Alex Pretti merecen justicia. Continuaré exigiendo investigaciones
independientes sobre sus muertes y sobre todo uso excesivo de la fuerza por
parte de agentes federales”.
Esa es una parte vital de la ecuación de la rendición
de cuentas. Pero no se detiene ahí, como explicó la diputada Ilhan Omar.
“Dos de mis constituyentes, Renee Good y Alex Pretti,
fueron asesinados por agentes federales de inmigración. Un tercero fue herido
de bala en circunstancias cuestionables. Miles fueron gaseados y alcanzados por
armas no letales y acosados por agentes enmascarados. Lo que presenciamos no
fue aplicación de la ley — fue terror racial militarizado desatado en las
calles de Minnesota como un intento deliberado de demonizar a la comunidad
somalí”, dijo Omar.
“La ‘Operación Arremetida Metropolitana’ ha expuesto
hasta dónde está dispuesto a llegar ICE para intimidar y aterrorizar a las
comunidades negras, morenas e inmigrantes en nuestro Estado. Casi todos los
somalíes en Minnesota son ciudadanos, sin embargo, los agentes de ICE acosaron
a los residentes exigiendo pruebas de papeles y, cuando los ciudadanos buscaron
documentar estas paradas ilegales, se encontraron con fuerza letal. Las comunidades
latina, asiática y otras comunidades de color se vieron obligadas a esconderse
independientemente de su estatus, y aquellos que se atrevían a vivir sus vidas,
a menudo eran arrestados sin causa. Eso no era seguridad pública. Eso fue un
abuso de poder autoritario”.
Omar sostiene que “nada de lo que vimos fue normal.
Las empresas están tambaleándose por la devastación económica. Las familias
están destrozadas. Los niños llevarán el trauma de que agentes federales
descendieran sobre sus vecindarios por el resto de sus vidas. El dolor infligido
a esta comunidad no se desvanecerá — permanecerá grabado en su memoria como el
momento en que su propio gobierno se volvió contra ellos”.
La rendición de cuentas, dice la representante,
requiere una acción audaz. Es hora, explica, “de pasar a abolir esta agencia matona
para que ninguna comunidad en USA sea nunca más aterrorizada así”.
Omar también ha respaldado la Resolución 996 de la
Cámara, que busca destituir a la secretaria de Seguridad Nacional por altos
crímenes y delitos menores. Hasta esta semana, 187 miembros de la Cámara se han
inscrito como copatrocinadores de la resolución — convirtiéndola en una de las
iniciativas de destitución más ampliamente apoyadas en la historia de USA.
Declarando: “No descansaré hasta que podamos asegurar
que este abuso de poder y terror nunca vuelva a suceder”, Omar dice: “Debe
haber justicia y rendición de cuentas. Esta administración debe cooperar
plenamente con las investigaciones independientes sobre los asesinatos de Renee
Good y Alex Pretti. El Congreso debe retener la financiación para acciones
ilegales y asegurarse de que los dólares federales nunca financien violaciones
de derechos civiles. Deberíamos llevar a los secretarios del gabinete y jefes
de agencia ante los comités del Congreso y exigir testimonio bajo juramento.
Deben explicar quién autorizó estas acciones, qué justificaciones legales se
utilizaron y por qué se ignoraron las protecciones constitucionales”.
Con ICE Map, los estudiantes de la Universidad Rice, Jack Vu y Abby Manuel, esperan ayudar a las comunidades a entender dónde ocurre la actividad de control de inmigración y cómo se desarrolla en tiempo real.
Arman Amin, The Nation, 13-2-2026
Arman Amin (promoción de 2027) es estudiante de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Vanderbilt (Nashville, Tennessee), donde se especializa en ciencias políticas, derecho, historia y sociedad. También es becario 2025 de la Fundación Puffin y escribe artículos sobre política y juventud para la revista The Nation.
Desde la segunda investidura del presidente Trump el
año pasado, las acciones federales de control de inmigración por parte de
agentes de ICE se han expandido dramáticamente. Se han desplegado agentes en
las principales ciudades con medidas drásticas generalizadas. Se han empleado
métodos controvertidos y violentos de focalización y detención que han atraído
un amplio escrutinio y protestas generalizadas, particularmente después de los
tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.
En medio de esta creciente tensión, dos estudiantes de
primer año de la Universidad Rice [Houston, Texas], Jack Vu y Abby Manuel,
desarrollaron una plataforma en línea, llamada [ICE Map], que rastrea los
informes locales sobre las acciones de ICE y consolida los incidentes
verificados. El proyecto tiene como objetivo ayudar a los usuarios a comprender
mejor dónde ocurre la actividad de control de inmigración y cómo se desarrolla
en tiempo real.
El mapa de Vu y Manuel ha atraído una mayor atención
en los últimos meses, incluida la amplificación por activistas prominentes como
Greta Thunberg, quien compartió el proyecto en Instagram. Los estudiantes
también han presentado su trabajo en el simposio 2025 New(s) Knowledge en el
MIT.
Hablé con Vu y Manuel sobre cómo desarrollaron este
proyecto, qué tipo de recepción han tenido y hacia dónde ven que se dirige a
partir de ahora. La conversación ha sido editada por razones de extensión y
claridad.
Arman Amin
Arman Amin: ¿Qué los inspiró a desarrollar este proyecto?
Jack Vu:
Ambos somos de Houston. Tenía un proyecto de voluntariado con inmigrantes en un
complejo de apartamentos en el este de Houston. Íbamos allí cada semana,
jugábamos, leíamos libros, jugábamos a la rayuela y les enseñábamos fútbol
americano. En abril de 2025, un sábado dejaron de aparecer, y nos dijimos: “¿Qué
está pasando?”
Alguien del programa va a tocar puertas y un residente
dice que ICE vino el fin de semana pasado, así que ninguno de ellos sale de sus
casas. Ni siquiera van a la escuela. Así que el programa se detuvo porque los
niños ya no podían venir. Fue bastante indignante.
Abby Manuel: Jack y yo estábamos en la misma clase de informática
en la escuela secundaria, así que trabajamos en muchos proyectos diferentes
juntos. Me consultó sobre lo que estaba pasando con su programa.
Creo que a ambos nos conmovió mucho el problema. Al
crecer en la comunidad de Houston, la inmigración es algo muy presente. Tenemos
una enorme comunidad de habla hispana. En nuestra escuela, comenzamos a tener
foros sobre las acciones de ICE. Se volvió muy pertinente para la vida
cotidiana, especialmente en Houston.
Así que empezamos a trabajar en el proyecto justo
después de salir de la escuela secundaria porque teníamos mucho tiempo libre.
Comenzamos a trabajar un par de días a la semana y luego el proyecto se
convirtió en algo mucho más grande. Decidimos pasar días enteros en cafeterías
programando, y nos apasionamos mucho por el esfuerzo. Lo lanzamos probablemente
solo dos semanas después de empezar a trabajar en él.
Pero continuamos trabajando en él para construir
nuestra base de datos. Una de las mayores dificultades desde el principio fue
adquirir fuentes, porque realmente queríamos enfatizar las voces locales en
lugar de simplemente “¿Qué dice el gobierno sobre ICE? ¿Qué dicen los titulares
nacionales sobre ICE? ¿Cuáles son las grandes estadísticas?” Queríamos capturar
lo que estaba sucediendo más a nivel comunitario.
Nos topamos con una herramienta llamada Media Cloud
que nos ayudó a reunir todos estos periódicos locales a través de una
herramienta basada en consultas. Y una vez que descubrimos eso, pudimos
realmente continuar amplificando el sitio y construyéndolo durante el verano.
AA: ¿Pueden explicar qué hace ICE Map y cómo funciona?
JV: Es una
plataforma agregadora de noticias. Recopilamos miles y miles de artículos de
todo el país y los introducimos en este gran proceso donde evaluamos si son
relevantes para la actividad de ICE. Por ejemplo, ¿esto realmente habla de
nuestro propósito previsto y, luego, tiene alguna información de ubicación que
nos permita mapearlo? Según el resultado de nuestro proceso, podemos insertarlo
para que la gente pueda mirar alrededor, puedan mirar su área, puedan mirar
Minneapolis, Houston, Los Ángeles, y ver noticias relevantes sobre la actividad
de ICE.
Lo bueno de las noticias es que ya están verificadas. Algunos
mapas adoptan un enfoque donde recopilan “informes de usuarios”. Algo que
pensamos que era difícil de
ese proceso era que tienes que verificar manualmente todos esos diferentes
informes, y la gente hace informes falsos. Pero todas estas fuentes de noticias
locales ya han hecho todo ese trabajo. Podemos aprovechar eso para difundir su
trabajo en un escenario más grande.
AM: También
usamos titulares de periódicos nacionales. Incluimos incluso fuentes de
comunicados de prensa de ICE. Realmente estamos tratando de dar a las personas
una visión general de lo que está sucediendo, porque creemos que la información
y la transparencia son lo más importante.
AA: ¿Cómo fue el proceso de construcción de esta
herramienta, de principio a fin?
JV: Siempre
supimos que sería un problema de datos. Sabes, mostrar cosas en un mapa no es
muy difícil. Hay muy buenas herramientas para ayudarte a hacerlo creadas por
mucha gente muy inteligente. Pero pasábamos horas en nuestras computadoras
portátiles, tratando de encontrar buenas fuentes consistentes que informaran
consistentemente sobre la actividad de ICE de una manera verificada, y eso nos
llevó a Media Cloud, organizaciones sin fines de lucro, etcétera. La mayor
parte de la aplicación es obtener buena información.
AM: Y luego,
una vez que tenemos esa información, filtrar lo que es realmente relevante, lo
que está relacionado con ICE en términos de inmigración, no solo relacionado
con "ice" en términos de tormentas invernales y congelación.
Deshacerse de todos esos falsos positivos. También averiguar la ubicación,
asegurarse de que estamos representando los datos con precisión, es otra
dificultad.
AA: ¿Cómo se ha utilizado el mapa hasta ahora? ¿Pueden
rastrear cuántas personas acceden o interactúan con su mapa?
JV: Tenemos
alrededor de 100,000 usuarios hoy, en todo el país. Vemos una amplia ubicación.
Washington, DC, es el número uno, seguido de Cleveland y Houston.
AM: En
cuanto a cómo la gente está usando el sitio, creo que es realmente una
herramienta de información para ayudar a aprender sobre lo que está sucediendo
en tu comunidad. Nuestro sitio en realidad no ayuda a las personas a rastrear
agentes de ICE en su área. Realmente se trata de ayudar a informar a las
personas. Así que creo que la mayoría de nuestros usuarios solo buscan
información sobre lo que está sucediendo en su región.
AA: ¿Qué tipo de recepción ha tenido el proyecto desde su
lanzamiento?
AM: Cuando
nuestro sitio salió por primera vez, intentábamos promocionarlo en nuestras
páginas de Instagram y en algunos hilos de Reddit. Cuando pones algo en
Internet en general, obviamente vas a recibir opiniones encontradas.
Definitivamente recibimos un poco de reacción negativa. Y ICE es un tema muy
candente.
Hubo un poco de respuesta negativa al principio, pero
diría que abrumadoramente positiva, especialmente para las personas de nuestra
comunidad, nuestros amigos, nuestras familias y otros estudiantes de nuestra
área. Mucha gente en Houston realmente vio la herramienta como un beneficio en
lugar de un daño, y recientemente, hemos recibido comentarios aún más
positivos. El tráfico del sitio se estancó un poco después de su lanzamiento, y
luego recientemente realmente aumentó. Hemos tenido mucha actividad reciente de
ICE, así que creo que el tema se está volviendo aún más apremiante. La gente
realmente continúa buscando recursos.
Justo la semana pasada, Greta Thunberg publicó nuestro
sitio en su Instagram. Así que empezamos a tener mucha más tracción. Luego, la
Universidad Rice publicó sobre nuestro proyecto. Toda esta mayor cobertura ha
atraído más miradas al sitio, y creo que las respuestas a todo eso en nuestra
comunidad han sido realmente positivas. Y en todo el país, la gente está
aprendiendo lo que está pasando y solo esperando poder deshacerse un poco del
miedo y lo desconocido. La gente se nos acerca y nos felicita por los proyectos,
y nos agradece por el trabajo. Así que nuestra comunidad ha estado realmente
agradeciendo la herramienta.
AA: ¿Cómo ha moldeado esta mayor atención y visibilidad
el proyecto?
AM: Ha sido
increíble tener más ojos en el trabajo. Esa era nuestra intención con el
proyecto desde el principio. Lo creamos para que pudiera ayudar a las personas,
para que pudiera llegar a tantas personas como fuera posible y simplemente
difundir la conciencia. Fuimos invitados por esa organización con la que nos
asociamos, Media Cloud, a presentar nuestro trabajo en un simposio del MIT en
octubre.
Esa fue probablemente una de las mayores oportunidades
que hemos tenido para obtener miradas o comentarios sobre nuestro sitio. Muchos
de ellos nos dieron comentarios sobre nuestro proyecto que pudimos incorporar,
e hicimos conexiones realmente significativas. Poder presentárselo a ellos fue
la primera vez que sentí que nos dimos cuenta de que "Está bien, esta
herramienta es realmente, realmente significativa".
AA: En las últimas semanas, las conversaciones nacionales
sobre ICE se han vuelto aún más acaloradas tras la represión de alto perfil y
las protestas en Minnesota, incluidos los tiroteos mortales de Renee Good y
Alex Pretti por agentes federales. ¿Cómo ha moldeado este momento nacional la
forma en que las personas responden a su proyecto ICE Map, y ha influido en
cómo piensan sobre su propio rol o responsabilidad en este momento?
JV: Lo que
está pasando en Minneapolis es muy revelador porque es tan descarado. Con Alex
Pretti y Renee Goode, todos pueden ver los videos y darse cuenta de lo que
estaba pasando por sí mismos. Pero al mismo tiempo, si siguen sitios de
noticias específicos, verían opiniones que no están en absoluto en línea con lo
que muestra el video.
El objetivo de ICE Map siempre fue darle a la gente
esta información para mostrarles exactamente lo que ICE estaba haciendo, porque
pensamos que eso les era muy perjudicial, ¿verdad? Lo que más daña a ICE es que
la gente sepa la verdad exacta sobre lo que están haciendo. Creo que
Minneapolis lo hace muy obvio. El objetivo siempre fue llamar la atención sobre
el sitio. Siempre se trató de mostrarle a la gente: "Esto es lo que están
haciendo en Houston. Esto es lo que están haciendo en Los Ángeles, Chicago y la
ciudad de Nueva York. Esta es la verdad: usan máscaras y corren y golpean a la
gente".
AA: ¿Cómo visualizan la evolución del proyecto en el
futuro?
AM: Como
mencionamos, el factor más importante en nuestro sitio es realmente la
información, las fuentes. Así que cualquier cosa que podamos hacer para
simplemente construir nuestras fuentes y obtener tanta información como podamos
es realmente el objetivo. Solo continuar reuniendo lo que hay y mostrarlo de la
manera más precisa posible y simplemente asegurarnos de que estamos filtrando
lo mejor de nuestras habilidades.
AA: Mirando hacia adelante, ¿qué esperan hacer ambos
después de la graduación? ¿Trabajar en este proyecto ha moldeado esos
objetivos?
JV: ICE Map
es casi como una startup.
Construyes tu producto y luego sales y tratas de que
la gente lo mire, tal vez que se interese un poco. Espero hacer eso en el
futuro.
AM: Siempre
me ha interesado mucho la intersección entre derecho, tecnología y economía.
Estudio economía e informática en Rice. Espero tomar la intersección de esos
campos y tal vez buscar algo en el ámbito del derecho después de graduarme, tal
vez ir a la facultad de derecho. Espero poder reunir todo eso. ICE Map es una
representación de esas habilidades en cierto modo. Captura esos aspectos
legales y de política pública y también la tecnología y la informática. Esto ha
sido un producto increíble para que yo explore estos intereses, además de hacer
algo impactante para mi comunidad, que siempre es una prioridad.
AA: Ha habido informes de que Meta bloquea el acceso a la
ICE List, una base de datos de empleados del Departamento de Seguridad
Nacional. ¿Cómo ven su proyecto como diferente, y han tenido alguna
preocupación sobre la censura o las restricciones de plataforma?
JV: Nos ha
preocupado, pero estamos seguros de que lo que estamos haciendo está bien y es
bueno. No tenemos la intención de decirle a todos: "este tipo es un
oficial de ICE, este tipo es un oficial de ICE". Lo que hacemos es sacar a
la luz noticias disponibles públicamente, y eso es impactante. No se trata de
pararse físicamente frente a los agentes de ICE e impedirles que hagan lo que
están haciendo, sino de dejar que la opinión pública cambie.
AM: Al final del día, solo estamos sirviendo información que ya existe y haciéndola fácil de encontrar para las personas, porque no es fácil saber lo que está pasando en tu comunidad, aunque existan fuentes. No estamos creando ninguna información nueva. No estamos rastreando ICE. No importa en qué posición estés sobre la inmigración, realmente no hay ambigüedad legal allí. Creo que todos deberían estar de acuerdo en que el público debe entender lo que está pasando con el gobierno, lo que está pasando en sus vidas y lo que está pasando en sus comunidades.