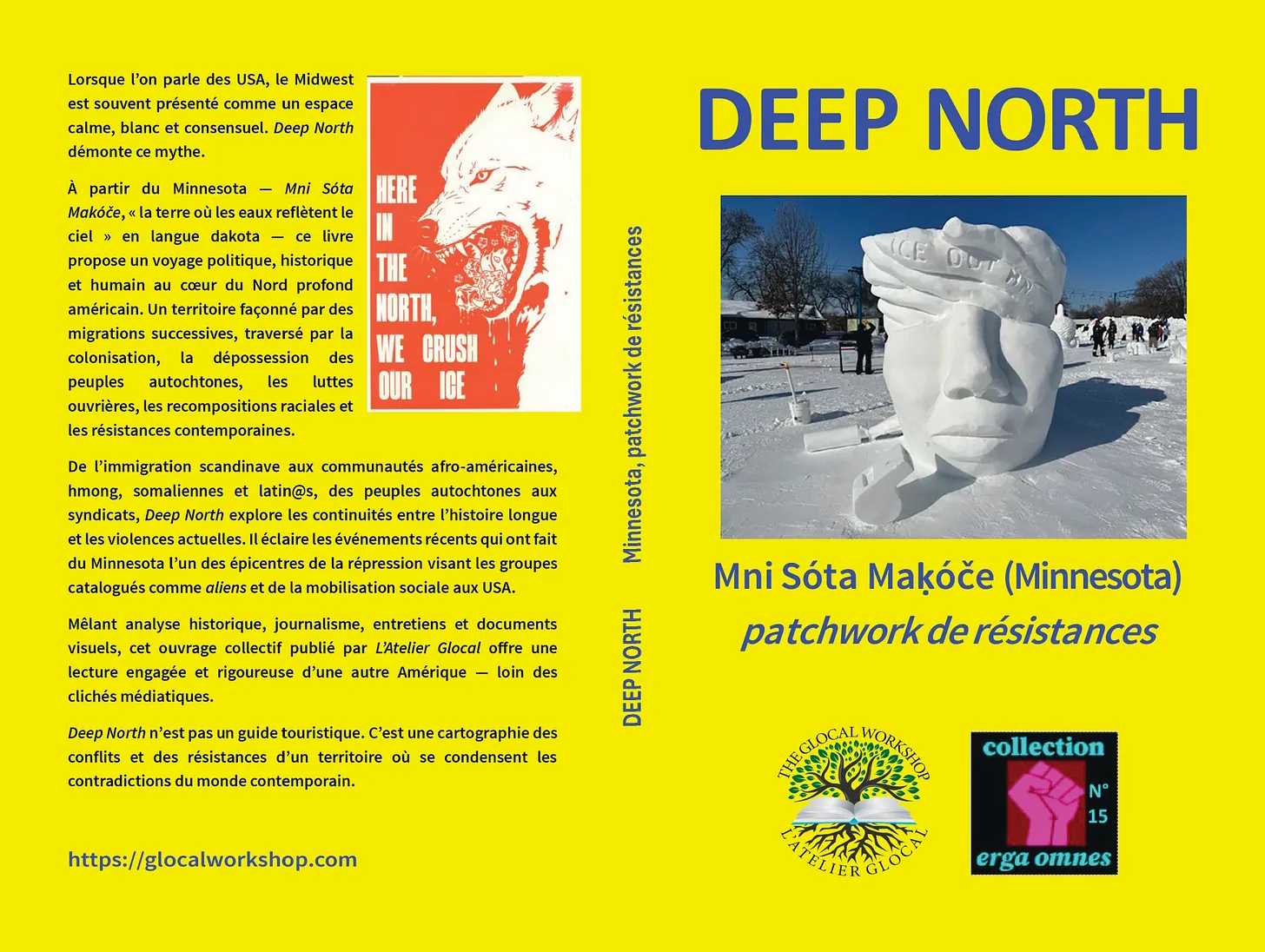Pat Bagley, Salt Lake Tribune, 25/8/2025
Tom Homan, le « tsar des frontières » de Trump a
déclaré le 12 février que l’Opération Metro Surge, lancée début décembre au
Minnesota, était terminée. Il aura fallu trois morts — Renee Nicole Good,
Victor Manuel Diaz et Alex Pretti -, plusieurs centaines de blessés et entre 3
000 et plus de 4 000 arrestations d’étrangers, majoritairement qualifiés de « criminal
illegal aliens ». Aucun bilan consolidé des expulsions
effectives n’a été publié à ce jour. Les données disponibles restent
fragmentaires et font l’objet de controverses sur la nature des arrestations et
le profil des personnes interpellées. L’opération, menée principalement par l’ICE
(Immigration and Customs Enforcement) et la CBP (Customs and Border Patrol), a
été qualifiée par Washington de « plus vaste opération de contrôle migratoire
jamais menée » dans l’intérieur des USA.
On peut constater que la société et
les autorités du Minnesota ont remporté une victoire sur la machine fédérale
trumpesque. Leur résistance, allant jusqu'à une grève générale, a écrit une nouvelle page de l’histoire de l’autre
USAmérique, celle d’en bas, des « grassroots » -les bases
autorganisées ad hoc selon des relations de voisinage, d’affinité,
intercommunautaires, interclassistes, intergénérationnelles et
interconfessionnelles. Les éditions The Glocal Workshop/L’Atelier Glocal
publieront la semaine prochaine un livre intitulé Deep North : Mni Sóta
Makóche (Minnesota), patchwork de résistances, qui
reconstitue la généalogie des migrations successives et des luttes qui ont
façonné le Minnesota depuis un siècle et demi. En attendant, nous vous
proposons les traductions de 3 articles.
Le premier se focalise sur des artisans cruciaux de la
résistance, les journalistes-citoyen·es armé·es de leurs portables, le second
pose la question première de l’après-Metro Surge : Washington doit rendre
des comptes, l’ICE et sa patronne Kristi Noem doivent dégager. Le troisième
article présente une initiative de deux étudiants consistant à fournir une
cartographie interactive des opérations policières anti-immigrés à l’échelle nationale et en temps réel.-Fausto Giudice,
Tlaxcala
Les
journalistes citoyen·nes, héro·ïnes méconnu·es de Minneapolis
Sans leurs
vidéos des fusillades de l’ICE, nous ne saurions pas ce qui se passe vraiment.
Mark Hertsgaard,
The Nation, 29/1/2026
Mark Hertsgaard est le correspondant pour l’environnement de
The Nation, cofondateur et directeur exécutif de Covering Climate Now, une
collaboration médiatique mondiale consacrée à la couverture du climat, cofondée
par la Columbia Journalism Review et The Nation. Son nouveau livre est Big Red’s Mercy: The Shooting of Deborah
Cotton and A Story of Race in America.

Des Minnesotaines filment un agent des forces de l’ordre
fédérales lors d’une patrouille à Minneapolis, le 11 janvier 2026. Photo
Victor J. Blue / Bloomberg via Getty Images
Dimanche 25
janvier dans l’après-midi, le présentateur de CNN, Jake Tapper, interviewait la
membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, quelques heures après que des
agents de la patrouille frontalière eurent tué Alex Pretti. Soudain, CNN a
coupé l’antenne pour une couverture en direct de la conférence de presse de la
secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Noem a déclaré que Pretti
avait « attaqué nos officiers » en « brandissant » un pistolet et avait prévu «
de tuer des forces de l’ordre ». Quand un journaliste a tenté de poser une
question sur son affirmation, elle l’a interrompu pour dire : « Ce n’est pas
une affirmation. Ce sont les faits. » Quand un autre journaliste a noté que la
Maison-Blanche venait de traiter Pretti de « terroriste domestique », Noem a
vigoureusement approuvé.
À ce moment-là,
des vidéos prises par des témoins de la fusillade apparaissaient en ligne et
sur les médias d’information. Quand Tapper a [repris son interview avec
Ocasio-Cortez], la députée a dit que Noem et l’administration Trump «
demandaient au peuple américain de ne pas croire ses yeux... de plutôt déposer
votre croyance en tout ce qu’ils disent. Je ne demande pas au peuple américain
de me croire, moi, ou elle, mais de se croire lui-même. »
Tout
journaliste qui a prêté attention sait que le patron de Noem, le président
Donald Trump, ne dit souvent pas la vérité. Trump a lancé sa carrière politique
en affirmant sans preuve que le premier président noir d’Amérique n’était pas
né aux USA, ce qui aurait signifié que Barack Obama était au pouvoir
illégalement. Après avoir perdu l’élection de 2020, Trump a dit qu’il n’avait
pas l’intention de quitter ses fonctions parce que, insistait-il, il avait en
réalité gagné. Trump répète ce mensonge à ce jour, ainsi que son affirmation
selon laquelle l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole pour le maintenir
au pouvoir était un jour de « paix » et d’« amour ».
Mais en tissant
leur dernière toile de mensonges, Trump et ses adjoints n’ont pas compté avec l’ingéniosité
et le courage des Minnesotain·es qui ont été témoins des tirs des agents de la
patrouille frontalière sur Pretti — et sur Renee Good avant lui — et ont
enregistré ces scènes sur leurs téléphones portables. Sans ces preuves, la
version des faits du gouvernement aurait eu le dessus pour façonner le récit
public. Avec ces preuves, cependant, il est évident qu’« Alex ne tient
clairement pas d’arme quand il est attaqué », comme l’ont écrit les parents «
au cœur brisé mais aussi très en colère » de Pretti dans une déclaration le
lendemain. « Il avait son téléphone dans sa main droite, et sa main gauche vide
est levée au-dessus de sa tête essayant de protéger la femme que l’ICE venait
de pousser au sol. » De même, les vidéos de témoins de la fusillade de Renee
Good montrent qu’elle tournait son véhicule pour s’éloigner de l’agent de
l’ICE Jonathan Ross au moment où celui-ci a tiré trois coups mortels à travers
ses vitres.
Qu’ils le
sachent ou non, les témoins qui ont enregistré ces vidéos sont des journalistes
citoyen·nes. Ce sont des gens ordinaires, non formés au journalisme
conventionnel, et ils témoignaient d’événements d’une importance capitale pour
leur communauté et leur pays. Et ils le faisaient dans des conditions
dangereuses, comme l’a également illustré Darnella Frazier, 17 ans, qui, le 25
mai 2020, a courageusement gardé son téléphone portable braqué sur l’agent de
police Derek Chauvin pendant les neuf minutes et 29 secondes où le genou de
Chauvin étouffait la vie de George Floyd.
Les événements
de ces derniers jours ont montré que les journalistes citoyen·nes, bien qu’ils
ne remplacent pas les professionnels, peuvent être un complément inestimable.
Sans leur présence sur les lieux et leur sang-froid sous pression, le public et
le reste des médias ignoreraient un aspect central de l’histoire qui se déroule
à Minneapolis. Nous n’entendrions que la version gouvernementale de la vérité,
qui, compte tenu des antécédents de l’administration Trump en matière de
faussetés flagrantes, mérite un extrême scepticisme. En l’absence de ces
vidéos, il est quasiment inconcevable que les rédactions de trois des journaux
les plus influents d’USAmérique — The New York Times, The Washington
Post et The Wall Street Journal — déclarent que la version de
l’administration est tout simplement invraisemblable — à moins qu’elle ne
cherche à faire marche arrière après avoir calomnié Pretti dans un premier
temps.
Toutes les
parties du système d’information moderne, des salles de rédaction
traditionnelles aux influenceurs des médias sociaux, peuvent désormais
présenter un compte rendu plus complet de ce qui se passe au Minnesota et
laisser les téléspectateurs et les lecteurs tirer leurs propres conclusions. Et
nous pouvons explorer les questions urgentes soulevées par ces vidéos, telles
que : Combien de personnes de plus les agents de l’ICE ont-ils pu tuer quand
aucune caméra n’enregistrait ? Travaillant de concert à ce moment critique pour
la démocratie usaméricaine, les journalistes citoyen·nes et professionnel·les
peuvent remplir la mission essentielle que les fondateurs de la nation
envisageaient pour une presse libre : informer le peuple et demander des
comptes au pouvoir.
L’ICE* fond
dans l’hiver de Minneapolis
Il est
maintenant temps d’abolir l’agence et de destituer Kristi Noem
John Nichols, The Nation, 13/2/2026
John Nichols est le rédacteur en chef exécutif de The
Nation. Il a précédemment occupé les postes de correspondant pour les
affaires nationales et de correspondant à Washington du magazine. Nichols a
écrit, coécrit ou édité plus d’une douzaine de livres sur des sujets allant des
histoires du socialisme américain et du Parti démocrate aux analyses des
systèmes médiatiques usaméricains et mondiaux. Son dernier livre, coécrit avec
le sénateur Bernie Sanders, est le best-seller du New York Times It’s OK to Be Angry About Capitalism.
*ICE,
acronyme d’ Immigration and Customs Enforcement, signifie aussi « glace »
en anglais, d’où le jeu de mots devenu courant, en particulier dans le
Minnesota sous la neige hivernale.
Des manifestants défilent
lors d’une manifestation « Nationwide Shutdown » contre les actions
de l’ICE le 30 janvier 2026 à Minneapolis, Minnesota. Photo Stephen Maturen /
Getty Images
Les habitants
de Minneapolis ont élevé leurs voix dans une opposition glorieuse à l’occupation
fédérale de leur ville avec une telle énergie, et une telle beauté, que le
monde entier a entendu leur cri de justice. Et ils n’ont jamais cessé. Quelques
jours seulement avant que le « tsar des frontières » de Donald Trump,
Tom Homan, annonce officiellement que la vague meurtrière du ministère de la
Sécurité intérieure, qui avait déployé des milliers d’agents armés et masqués
de l’ICE dans leur ville, prendrait fin, 1 600 Minnesotain·es avaient rempli la
caverneuse [église centrale luthérienne] du centre-ville de Minneapolis avec le
chœur de leur résistance chantante :
Tiens bon
Tiens bon
Ma chère
Voici l’aube...
Quand l’aube
est arrivée jeudi, après plus de deux mois de violence et de cruauté — qui ont
inclus des milliers d’arrestations, de détentions et d’expulsions, et le
meurtre de la poète et mère de trois enfants Renee Good et de l’infirmier de
soins intensifs Alex Pretti — le maire de Minneapolis, Jacob Frey, est arrivé
aussi près qu’un Minnesotain peut l’être de déclarer la victoire.
« Ils
pensaient pouvoir nous briser, mais l’amour pour nos voisins et la
détermination à endurer peuvent survivre à une occupation. Ces patriotes de
Minneapolis montrent qu’il ne s’agit pas seulement de résistance — se tenir aux
côtés de nos voisins est profondément américain », a déclaré le maire, qui
avait annoncé en janvier : « À l’ICE, allez vous faire foutre de
Minneapolis ! »
« Cette
opération a été catastrophique pour nos voisins et nos entreprises, et
maintenant il est temps pour un grand retour », a dit Frey. « Nous
montrerons le même engagement envers nos résidents immigrés et la même
endurance dans cette réouverture, et j’espère que tout le pays se tiendra à nos
côtés alors que nous avançons ».
Frey a ajouté :
« Les personnes qui méritent le crédit pour la fin de cette opération, ce
sont les 435 000 résidents qui appellent Minneapolis leur maison ». Il a
raison. La résistance pacifique à la vague de 3 000 agents de l’ICE et de la
patrouille frontalière, mal formés et irresponsables, déployés par le ministère
de la Sécurité intérieure dans la ville — avec des marches massives, des
surveillances de quartier et des réseaux d’entraide pour soutenir les voisins
menacés — a été aussi résiliente que belle. Et elle constitue un modèle pour la
résistance dans les villes qui pourraient être ciblées ensuite.
Pourtant, Frey
a également eu raison de décrire les dégâts causés par plus de deux mois d’occupation
fédérale comme « catastrophiques ».
En plus des
meurtres, des arrestations et détentions, et des expulsions d’hommes, de femmes
et d’enfants, l’impact économique de l’Opération Metro Surge de la secrétaire à
la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a été accablant. La peur qui a saisi la
ville était palpable. Travailleurs et consommateurs avaient peur de sortir de
chez eux, laissant restaurants et magasins lutter pour rester ouverts. « La
longue route vers la reprise commence maintenant », a dit jeudi le
gouverneur du Minnesota, Tim Walz, en annonçant un plan pour fournir « 10
millions de dollars d’aide directe pour aider les entreprises touchées par l’Opération
Metro Surge à se stabiliser, protéger les emplois et se remettre sur des bases
solides ».
Dans une nation
dirigée par des adultes responsables ayant un minimum d’intérêt pour le service
public, cette aide serait accompagnée d’une aide financière fédérale. Mais le
président Trump et le Congrès républicain complotent toujours pour donner plus
d’argent à Noem et ses sbires afin d’étendre les opérations de l’ICE. Peut-être
ont-ils reconnu leur erreur en ciblant Minneapolis, mais ils n’ont pas appris
leur leçon. Et ils n’ont pas eu à rendre de comptes.
« L’Opération
Metro Surge se termine parce que les Minnesotain·es se sont battu·es », a dit
le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, qui a ajouté : « Nous
méritons toujours de la transparence, et Renee Good et Alex Pretti méritent
justice. Je continuerai à exiger des enquêtes indépendantes sur leur mort et
sur tout usage excessif de la force par des agents fédéraux ».
C’est une part
vitale de l’équation de la reddition de comptes. Mais ça ne s’arrête pas là,
comme l’a expliqué la congressiste Ilhan Omar.
« Deux de
mes administrés, Renee Good et Alex Pretti, ont été tués par des agents
fédéraux de l’immigration. Un troisième a été blessé par balle dans des
circonstances douteuses. Des milliers de personnes ont été gazées au poivre et
touchées par des armes non létales et harcelées par des agents masqués. Ce à
quoi nous avons assisté n’était pas de l’application de la loi — c’était une
terreur raciale militarisée déchaînée dans les rues du Minnesota comme une
tentative délibérée de diaboliser la communauté somalienne », a dit Omar.
« L’Opération
Metro Surge a révélé jusqu’où l’ICE est prête à aller pour intimider et
terroriser les communautés noires, brunes et immigrées dans notre État. Presque
tous les Somaliens du Minnesota sont citoyens, pourtant les agents de l’ICE ont
harcelé les résidents exigeant des preuves de papiers et, quand les citoyens
ont cherché à documenter ces interpellations illégales, ils ont été accueillis
par la force létale. Les communautés latino, asiatique et autres communautés de
couleur ont été forcées de se cacher indépendamment de leur statut, et ceux qui
osaient vivre leur vie étaient souvent arrêtés sans cause. Ce n’était pas de la
sécurité publique. C’était un abus d’autorité autoritaire ».
Omar soutient :
« Rien de ce que nous avons vu n’était normal. Les entreprises sont en
plein marasme à cause de la dévastation économique. Les familles sont brisées.
Les enfants porteront le traumatisme d’agents fédéraux débarquant dans leurs
quartiers pour le reste de leur vie. La douleur infligée à cette communauté ne
s’effacera pas — elle restera gravée dans leur mémoire comme le moment où leur
propre gouvernement s’est retourné contre eux ».
La reddition de
comptes, dit la députée, nécessite une action audacieuse. Il est temps,
explique-t-elle, « de passer à l’abolition de cette agence voyou pour qu’aucune
communauté en Amérique ne soit plus jamais terrorisée comme ça ».
Omar a
également soutenu la résolution 996 de la Chambre, qui cherche à destituer la
secrétaire à la Sécurité intérieure pour crimes et délits graves. À ce jour, 187
membres de la Chambre se sont inscrits comme coparrains de la résolution — ce
qui en fait l’une des initiatives de destitution les plus largement soutenues
de l’histoire USaméricaine.
Déclarant : « Je
ne me reposerai pas tant que nous ne pourrons garantir que cet abus de pouvoir
et cette terreur ne pourront plus jamais se reproduire », Omar dit : « Il
doit y avoir justice et reddition de comptes. Cette administration doit
coopérer pleinement aux enquêtes indépendantes sur les meurtres de Renee Good
et Alex Pretti. Le Congrès doit retenir les financements pour les actions
illégales et s’assurer que les dollars fédéraux ne financent jamais les
violations des droits civiques. Nous devrions traîner les secrétaires de
cabinet et les chefs d’agence devant les commissions du Congrès et exiger des
témoignages sous serment. Ils doivent expliquer qui a autorisé ces actions,
quelles justifications légales ont été utilisées, et pourquoi les protections
constitutionnelles ont été ignorées ».
Comment deux étudiants de première année suivent les
actions de l'ICE à travers le pays
Avec ICE Map,
Jack Vu et Abby Manuel, étudiants à l'université Rice (Houston, Texas),
espèrent aider les communautés à comprendre où et comment les opérations de
contrôle de l'immigration se déroulent en temps réel.
Arman Amin, The Nation, 13/2/2026
Arman Amin
(promotion 2027) est étudiant à la faculté des arts et des sciences de
l'université Vanderbilt (Nashville, Tennessee), où il se spécialise en sciences
politiques, droit, histoire et société. Il est également boursier 2025 de la
Fondation Puffin et rédige des articles sur la politique et la jeunesse pour le
magazine The Nation.
À gauche : les étudiants de l’Université
Rice Jack Vu et Abby Manuel. À droite : une capture d’écran d’ICE Map.
Depuis la
deuxième investiture du président Trump l’année dernière, les actions fédérales
d’application des lois sur l’immigration par les agents de l’ICE se sont
considérablement étendues. Des agents ont été déployés dans les grandes villes
avec des mesures de répression massives Des méthodes controversées et violentes
de ciblage et de détention ont été déployées, suscitant une large attention et
des protestations généralisées, particulièrement après les exécutions sommaires
de Renee Good et Alex Pretti à Minneapolis.
Au milieu de
cette tension croissante, deux étudiants de première année de l’Université
Rice, Jack Vu et Abby Manuel, ont développé une plateforme en ligne, appelée ICE Map,
qui suit les rapports locaux sur les actions de l’ICE et consolide les
incidents vérifiés. Le projet vise à aider les utilisateurs à mieux comprendre
où se déroule l’activité d’application des lois sur l’immigration et comment
elle se déroule en temps réel.
La carte de Vu
et Manuel a attiré une plus grande attention ces derniers mois, y compris une
amplification par des activistes éminents tels que Greta Thunberg, qui a
partagé le projet sur Instagram. Les étudiants ont également présenté leur
travail au symposium 2025 New(s) Knowledge au MIT.
Je me suis
entretenu avec Vu et Manuel sur la façon dont ils ont développé ce projet, le
type d’accueil qu’ils ont reçu, et où ils voient les choses aller à partir de
maintenant. La conversation a été éditée pour des raisons de longueur et de
clarté.
Arman
Amin : Qu’est-ce qui vous a inspiré pour développer ce projet ?
Jack Vu :
Nous sommes tous les deux de Houston. J’avais ce projet de bénévolat avec des
immigrants dans un complexe d’appartements dans l’est de Houston. Nous y
allions chaque semaine, nous jouions à des jeux, lisions des livres, faisions
de la marelle, et nous leur apprenions le football américain. En avril 2025,
ils ont arrêté de se présenter un samedi, et nous nous sommes demandé : « Que
se passe-t-il ? »
Quelqu’un du
programme va frapper aux portes et un résident dit que l’ICE est venue le
week-end dernier, donc aucun d’eux ne quitte sa maison. Ils ne vont même pas à
l’école. Donc le programme s’est arrêté parce que les enfants ne pouvaient plus
venir. C’était assez rageant.
Abby Manuel
: Jack et moi étions dans la même classe d’informatique au lycée, donc nous
avons travaillé sur beaucoup de projets différents ensemble. Il m’a consultée
sur ce qui se passait avec son programme.
Je pense que
nous avons tous les deux été vraiment touchés par le problème. Quand on grandit
dans la communauté de Houston, l’immigration est quelque chose de très présent.
Nous avons une énorme communauté hispanophone. Dans notre école, nous avons
commencé à avoir des forums sur les actions de l’ICE. C’est devenu très
pertinent pour la vie quotidienne, surtout à Houston.
Donc nous avons
commencé à travailler sur le projet juste après avoir fini le lycée parce que
nous avions beaucoup de temps libre. Nous avons commencé à travailler quelques
jours par semaine, puis le projet a évolué en quelque chose de beaucoup plus
vaste. Nous avons juste décidé de passer des journées entières dans des cafés à
coder, et nous sommes devenus vraiment passionnés par l’entreprise. Nous avons
lancé le site probablement seulement deux semaines après avoir commencé à y
travailler.
Mais nous avons
continué à y travailler pour construire notre base de données. L’une des plus
grandes difficultés dès le début a été d’acquérir des sources, car nous
voulions vraiment mettre l’accent sur les voix locales plutôt que simplement
sur « Que dit le gouvernement à propos de l’ICE ? Que disent les gros
titres nationaux à propos de l’ICE ? Quelles sont les grandes statistiques ? »
Nous voulions capturer ce qui se passait davantage sur le terrain.
Nous sommes
tombés sur un outil appelé Media Cloud qui nous a aidés à rassembler tous ces
journaux locaux grâce à un outil basé sur des requêtes. Et une fois que nous
avons découvert cela, nous avons pu vraiment continuer à amplifier le site et
simplement le construire au cours de l’été.
AA :
Pouvez-vous expliquer ce que fait ICE Map et comment ça fonctionne ?
JV : C’est
une plateforme d’agrégation de nouvelles. Nous récupérons des milliers et des
milliers d’articles de tout le pays et nous les jetons tous dans ce grand
pipeline où nous évaluons s’ils sont pertinents pour l’activité de l’ICE. Par
exemple, est-ce que ça parle vraiment de notre objectif visé, et ensuite,
est-ce que ça contient des informations de localisation qui nous permettraient
de le cartographier ? En fonction du résultat de notre pipeline, nous sommes
capables de l’insérer pour que les gens puissent regarder autour d’eux, ils
peuvent regarder leur région, ils peuvent regarder Minneapolis, Houston, Los
Angeles, et voir les actualités pertinentes concernant l’activité de l’ICE.
Le bon côté des
news, c’est qu’elles sont déjà vérifiées.
Certaines cartes adoptent une approche où elles
regroupent des « rapports d’utilisateurs ». Quelque chose que nous
pensions difficile dans ce processus était que vous
devez en quelque sorte vérifier manuellement tous ces différents rapports, et les gens font de faux rapports. Mais toutes
ces sources d’actualités locales ont déjà fait tout ce travail. Nous pouvons
profiter de ça pour diffuser leur travail sur une plus grande scène.
AM :
Nous utilisons également les gros titres des journaux nationaux. Nous incluons
même des sources provenant des communiqués de presse de l’ICE. Nous essayons
vraiment de donner aux gens une vue d’ensemble de ce qui se passe, parce que
nous pensons que l’information et la transparence sont la chose la plus
importante.
AA :
À quoi a ressemblé le processus de construction de cet outil, du début à la fin
?
JV :
Nous avons toujours su que ce serait en quelque sorte un problème de données.
Vous savez, montrer des choses sur une carte, ce n’est pas très difficile. Il y
a de très bons outils pour vous aider à le faire, créés par des gens très
intelligents. Mais nous passions des heures sur nos ordinateurs portables, à
essayer de trouver de bonnes sources cohérentes qui rapportent systématiquement
l’activité de l’ICE d’une manière qui soit vérifiée, et c’est ce qui nous a
conduits à Media Cloud, aux organisations à but non lucratif, à ce genre de
choses. L’essentiel de l’application consiste à obtenir de bonnes informations.
AM : Et
ensuite, une fois que nous avons ces informations, il faut filtrer ce qui est
vraiment pertinent, ce qui est lié à l’ICE en termes d’immigration, pas
seulement lié à "ice" en termes de tempêtes hivernales et de gel. Se
débarrasser de tous ces faux positifs. Trouver aussi le lieu, s’assurer que
nous représentons fidèlement les données, est une autre difficulté.
AA :
Comment la carte a-t-elle été utilisée jusqu’à présent ? Pouvez-vous savoir
combien de personnes accèdent à votre carte ou interagissent avec elle ?
JV :
Nous avons environ 100 000 utilisateurs aujourd’hui, dans tout le pays. Nous
voyons une large répartition géographique. Washington, DC, est numéro un, suivi
de Cleveland et Houston.
AM : En
ce qui concerne la façon dont les gens utilisent le site, je pense que c’est
vraiment un outil d’information pour apprendre ce qui se passe dans leur
communauté. Notre site n’aide pas réellement les gens à suivre les agents de l’ICE
dans leur région. Il s’agit vraiment d’aider à informer les gens. Donc je pense
que la plupart de nos utilisateurs recherchent simplement des informations sur
ce qui se passe dans leur région.
AA :
Quel type d’accueil le projet a-t-il reçu depuis son lancement ?
AM :
Quand notre site est sorti pour la première fois, nous essayions de le
promouvoir sur nos pages Instagram et sur quelques fils Reddit. Quand vous
mettez quelque chose sur l’Internet général, vous allez évidemment recevoir des
avis mitigés. Nous avons certainement reçu un peu de résistance. Et l’ICE est
un sujet très brûlant.
Il y a eu un
peu de réaction négative au début, mais je dirais que c’était extrêmement
positif, surtout pour les gens de notre communauté, nos amis, nos familles et
les autres étudiants de notre région. Beaucoup de gens à Houston ont vraiment
vu l’outil comme un bénéfice plutôt qu’un danger, et récemment, nous avons reçu
des retours encore plus positifs. Le trafic du site a un peu stagné après son
lancement, puis récemment, il a vraiment augmenté. Nous avons eu beaucoup d’activité
récente de l’ICE, donc je pense que le sujet devient encore plus pressant. Les
gens continuent vraiment à chercher des ressources.
Pas plus tard
que la semaine dernière, Greta Thunberg a posté notre site sur son Instagram.
Nous avons donc commencé à avoir beaucoup plus de suivis. Ensuite, l’Université
Rice a publié un article sur notre projet. Toute cette couverture médiatique
accrue a attiré plus de regards sur le site, et je pense que les réponses à
tout cela dans notre communauté ont été vraiment positives. Et à travers le
pays, les gens apprennent ce qui se passe et espèrent simplement pouvoir se
débarrasser d’un peu de la peur et de l’inconnu. Les gens viennent nous voir et
nous félicitent pour les projets, et nous remercient pour le travail. Donc
notre communauté a vraiment apprécié l’outil.
AA :
Comment cette attention et cette visibilité accrues ont-elles façonné le projet
?
AM : Ça
a été incroyable d’avoir plus de regards sur le travail. C’était notre
intention avec le projet depuis le début. Nous l’avons créé pour qu’il puisse
aider les gens, pour qu’il puisse toucher autant de personnes que possible et
simplement faire passer le message. Nous avons été invités par cette
organisation avec laquelle nous nous étions associés, Media Cloud, à présenter
notre travail lors d’un symposium du MIT en octobre.
C’était
probablement l’une des plus grandes opportunités que nous ayons eues d’avoir
des regards et des retours sur notre site. Beaucoup d’entre eux nous ont donné
des retours sur notre projet que nous avons pu intégrer, et nous avons créé des
liens vraiment significatifs. Le présenter à eux a été la première fois que j’ai
eu l’impression de réaliser que « OK, cet outil est vraiment, vraiment
significatif ».
AA :
Ces dernières semaines, les conversations nationales sur l’ICE sont devenues
encore plus vives suite à la répression très médiatisée et aux protestations au
Minnesota, y compris les exécutions de Renee Good et Alex Pretti par des agents
fédéraux. Comment ce moment national a-t-il façonné la façon dont les gens
réagissent à votre projet ICE Map, et cela a-t-il influencé votre façon de
penser votre propre rôle ou responsabilité dans ce moment ?
JV : Ce
qui se passe à Minneapolis est très révélateur parce que c’est si flagrant.
Avec Alex Pretti et Renee Goode, tout le monde peut regarder les vidéos et
réaliser ce qui se passait par lui-même. Mais en même temps, s’ils suivent
certains sites d’information, ils verraient des opinions qui ne sont pas du
tout en phase avec ce que montre la vidéo.
Le but d’ICE
Map a toujours été de donner aux gens ces informations pour leur montrer
exactement ce que l’ICE faisait, parce que nous pensions que cela leur était
très préjudiciable, n’est-ce pas ? Ce qui nuit le plus à l’ICE, c’est que les
gens connaissent la vérité exacte sur ce qu’ils font. Je pense que Minneapolis
rend cela très évident. Le but a toujours été d’attirer l’attention sur le
site. Il s’agissait toujours de montrer aux gens : « Voici ce qu’ils font
à Houston. Voici ce qu’ils font à Los Angeles, Chicago et New York. Voici la
vérité : Ils portent des masques et ils courent partout et tabassent les gens ».
AA :
Comment envisagez-vous l’évolution du projet à l’avenir ?
AM :
Comme nous l’avons mentionné, le plus grand facteur sur notre site est vraiment
l’information, les sources. Donc tout ce que nous pouvons faire pour simplement
augmenter nos sources et obtenir autant d’informations que possible est
vraiment l’objectif. Juste continuer à rassembler ce qui existe et l’afficher
de la manière la plus précise possible et simplement nous assurer que nous
filtrons au mieux de nos capacités.
AA :
Pour l’avenir, qu’espérez-vous poursuivre tous les deux après l’obtention de
votre diplôme ? Le travail sur ce projet a-t-il façonné ces objectifs ?
JV : ICE
Map est presque comme une start-up.
Vous construisez votre produit, puis vous allez essayer d’amener les
gens à le regarder, peut-être à s’y intéresser un peu. J’ai hâte de faire cela à l’avenir.
AM : J’ai
toujours été très intéressée par l’intersection entre le droit, la technologie
et l’économie. J’étudie l’économie et l’informatique à Rice. J’espère prendre l’intersection
de ces domaines et peut-être poursuivre quelque chose dans le domaine du droit
après l’obtention de mon diplôme, peut-être aller à l’école de droit. J’espère
pouvoir rassembler tout cela. ICE Map est une représentation de ces compétences
en quelque sorte. Il capture les aspects juridiques et de politique publique
ainsi que la technologie et l’informatique. Cela a été un produit incroyable
pour moi d’explorer ces intérêts, en plus de faire quelque chose d’impactant
pour ma communauté, ce qui a toujours été une priorité.
AA :
Il y a eu des rapports selon lesquels Meta bloquait l’accès à l’ICE List, une
base de données des employés du ministère de la Sécurité intérieure. Comment
voyez-vous votre projet comme différent, et avez-vous eu des préoccupations
concernant la censure ou les restrictions de plateforme ?
JV :
Nous nous sommes inquiétés à ce sujet, mais nous sommes confiants que ce que
nous faisons est tout à fait légitime et bon. Nous n’avons pas l’intention de
dire à tout le monde : « ce type est un agent de l’ICE, ce type est un
agent de l’ICE ». Ce que nous
faisons, c’est mettre en lumière des informations publiquement disponibles, et
c’est impactant. Il ne s’agit pas d’aller se tenir physiquement devant des
agents de l’ICE et de les empêcher de faire ce qu’ils font, mais plutôt de
laisser l’opinion publique changer.
AM : Au
final, nous ne faisons que servir des informations qui existent déjà et les
rendre faciles à trouver pour les gens, car il n’est pas facile de savoir ce
qui se passe dans sa communauté, même si des sources existent. Nous ne créons
aucune nouvelle information. Nous ne suivons pas l’ICE. Peu importe où vous
vous situez sur l’immigration, il n’y a vraiment aucune ambiguïté légale
là-dedans. Je pense que tout le monde devrait être d’accord sur le fait que le
public devrait comprendre ce qui se passe avec le gouvernement, ce qui se passe
dans sa vie, et ce qui se passe dans sa communauté.