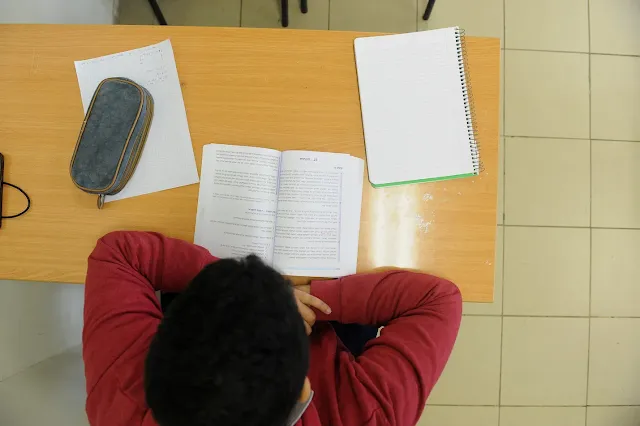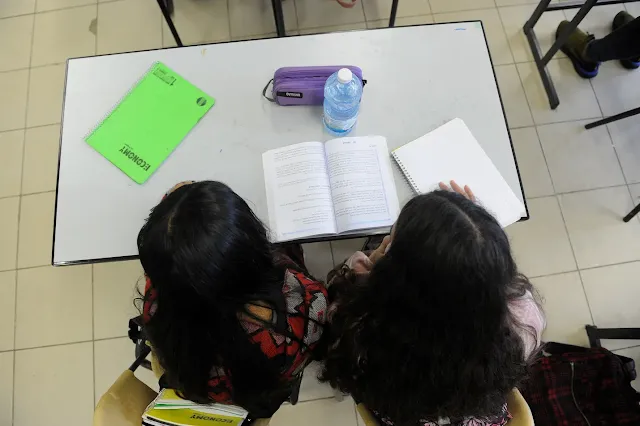Malgré l’obtention de diplômes ou l’exercice d’un métier en hébreu, un sentiment croissant d’aliénation vis-à-vis de l’État israélien et des Israéliens juifs a conduit certains citoyens arabophones israéliens à renoncer complètement à l’hébreu, en particulier pendant la guerre de Gaza : « Je parle une langue dont les locuteurs natifs, bien souvent, n’acceptent même pas mon existence ».
Nagham Zbeedat, Haaretz,
13/7/2025
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
Nagham Zbeedat est une journaliste palestinienne d’Israël couvrant les affaires palestiniennes et le monde arabe pour le quotidien Haaretz .@ztnagham
Illustration : Shumisat Rasulaev
Dans un café animé de Haïfa, un
groupe d’amis passe sans effort de l’arabe à l’anglais, sans prononcer un mot d’hébreu. Ce n’est
pas qu’ils ne le parlent pas. En fait, la plupart d’entre eux l’ont étudié
pendant des années et le parlent couramment dans un contexte académique ou
professionnel. Mais lorsqu’il s’agit de conversations informelles, de nombreux
arabophones font désormais un choix délibéré : éviter complètement de parler
hébreu.
Parmi ceux qui ont fait ce choix
linguistique conscient, on trouve Ahlam, une infirmière diplômée de 26 ans
originaire de la ville de Kafr Yasif, dans le nord du pays. Comme beaucoup de
citoyens palestiniens d’Israël, elle a grandi en parlant arabe à la maison et a
fréquenté des écoles publiques arabophones, où l’hébreu est enseigné comme
deuxième langue à partir du CE2.
Ahlam a étudié les sciences
infirmières à l’université de Tel Aviv et a terminé sa formation clinique dans
un hôpital du centre d’Israël. Après s’être liée d’amitié avec des Palestiniens
vivant à Gaza et en Cisjordanie, elle s’est rendu compte que l’hébreu s’était
glissé dans son vocabulaire quotidien, même lorsqu’elle parlait arabe.
« J’ai commencé à me sentir
dégoûtée de moi-même », dit-elle. « Pourquoi utilisais-je des mots hébreux avec
des gens qui parlaient la même langue que moi ? Notre langue commune est l’arabe.
Et pourtant, la moitié des mots que j’utilisais, ils ne les comprenaient même
pas parce qu’ils étaient en hébreu. »
Ahlam a commencé à supprimer
délibérément les mots hébreux de son vocabulaire quotidien, un processus qu’elle
poursuit encore aujourd’hui. « Je pense qu’il est important d’apprendre la
langue, mais je ne trouve pas normal de l’utiliser entre nous [les Arabes] »,
explique-t-elle. « L’éducation m’a tellement éloignée de ma langue que je
connais certains mots uniquement en hébreu et que je ne sais pas ce qu’ils
signifient en arabe, et vice versa. Il y a des mots arabes que je ne comprends
même plus. »
Ce qui a commencé comme un
changement subtil est devenu une tendance croissante parmi les jeunes citoyens
arabes d’Israël, sous la forme d’une expression culturelle et politique
discrète influencée par la guerre en cours, la discrimination et un sentiment
croissant d’aliénation vis-à-vis des Israéliens juifs et de la culture
hébraïque.
« [Parler hébreu] était quelque
chose qui m’était imposé. J’ai vécu avec. Mais maintenant que je le rejette, c’est
une façon de résister, de m’accrocher à mon identité et à mes racines », dit
Ahlam. « Ils ont essayé de nous dépouiller de tout, y compris de notre langue.
L’hébreu représente l’occupant. Celui qui est venu, a pris mon pays et m’a
imposé sa langue. »
« Bien sûr, quand les Juifs ne
connaissent pas l’arabe, je suis obligé de leur parler dans leur langue. Mais
on ne leur demande jamais de parler la mienne. »
Double identité
En Israël, le ministère de l’Éducation
gère deux systèmes éducatifs distincts : les écoles arabophones et les écoles hébréophones.
Chaque système dispose de ses propres superviseurs, budgets, établissements de
formation des enseignants et systèmes de placement des enseignants. Cependant,
le secrétariat pédagogique du ministère de l’Éducation élabore et supervise un
programme unique pour les deux systèmes.
L’étude de l’hébreu dans les
écoles arabophones est obligatoire à partir de la troisième année, voire dès la
première année pour certains élèves. Ceux-ci suivent plusieurs heures de cours
d’hébreu par semaine et, à la fin du lycée, ils passent des examens d’hébreu
dans le cadre du baccalauréat. L’apprentissage de cette langue est obligatoire
depuis la création de l’État. Mais l’apprentissage de l’hébreu n’est pas
seulement une exigence éducative : il est pratiquement impossible pour les
arabophones de travailler, d’étudier ou d’accéder aux services de santé et aux
services sociaux sans une certaine maîtrise de l’hébreu.
Bien qu’elle ait dû acquérir un
niveau élevé en hébreu pour pouvoir étudier à l’université et obtenir des
diplômes en soins infirmiers, Ahlam a finalement pris la décision inhabituelle
de poursuivre une carrière en dehors du système de santé israélien. Elle a préféré
lancer sa propre petite entreprise en tant qu’infirmière consultante
spécialisée dans l’activité physique, offrant des conseils personnalisés à des
clients arabes qui cherchent à améliorer leur santé grâce à des soins axés sur
le mouvement.
« Travailler dans le système de
santé israélien ne me convenait tout simplement pas », dit-elle. « Même si j’aimais
mon travail et que les patients m’appréciaient, je ne pouvais pas accepter de
faire partie d’un système dirigé par un gouvernement qui bombarde mon peuple [à
Gaza] et détruit notre secteur de la santé. »
« J’aurais adoré travailler dans
mon domaine », dit-elle, « mais je ne peux tout simplement pas. Je suis
sincèrement reconnaissante de ne pas vivre avec cette double identité, de ne
pas devoir donner tout ce que j’ai pour combler les lacunes de leur système
alors que mon propre peuple se voit refuser le droit le plus fondamental à des
soins médicaux, tandis qu’Israël bombarde et arrête nos équipes médicales. »
Ironiquement, ce sont ses études
universitaires qui ont perfectionné sa maîtrise de la langue. « L’éducation
dans une institution israélienne a fait de l’hébreu une partie encore plus
importante de ma vie quotidienne. Cela m’a éloignée de ma langue maternelle.
Quand j’essaie de parler de sujets médicaux, je ne peux même pas le faire dans
une autre langue, je ne sais le faire qu’en hébreu. Cela a complètement
remplacé mes autres langues. Si je voulais étudier ou travailler à l’étranger,
ce serait très difficile pour moi, car tout ce que j’ai appris est en hébreu.
Je parle hébreu. »
« Une forme de boycott »
Ahlam n’est pas la seule à Haïfa
à être mal à l’aise avec la présence de l’hébreu dans sa vie quotidienne. De l’autre
côté de la table, Rashid, un ingénieur civil de 28 ans, acquiesce à mesure que
la conversation avance. Comme Ahlam, il a pris la décision consciente de se
distancier de l’hébreu dans sa vie quotidienne. « Ma mission d’éviter l’hébreu
a commencé il y a huit ans », explique-t-il. « Aujourd’hui, je ne le parle plus
que pour le travail. »
Travaillant dans un environnement
mixte, Rashid est constamment entouré de collègues juifs israéliens et arabes
qui parlent hébreu, mais il dit n’avoir jamais ressenti de pression pour l’adopter
au-delà du nécessaire. « Je ne me sens pas proche de l’hébreu. J’ai toujours
été distant de cette langue », explique-t-il.
« Que ce soit pendant mes études
ou maintenant au travail, être obligé d’utiliser l’hébreu suscite en moi
beaucoup de sentiments contradictoires. Je ne parle pas seulement une langue
qui n’est pas la mienne, je parle une langue dont les locuteurs natifs, bien
souvent, n’acceptent même pas mon existence. »
Pour Rashid, ce refus de parler
hébreu n’est pas seulement personnel, c’est politique. « Je considère cela
comme une forme de boycott », affirme-t-il avec fermeté. « Mais il ne devrait
pas falloir une guerre à Gaza ou l’annexion de la Cisjordanie pour que nous
prenions conscience de l’urgence de préserver notre identité et notre langue.
Cela aurait toujours dû être notre mission. »
Comme Rashid, Dima, 25 ans,
diplômée en génie civil du Technion, a grandi en parlant arabe et a fait ses
études universitaires en hébreu ; adolescente, elle a fait le choix délibéré de
garder l’hébreu à distance.
« Je me suis assurée que cela ne
fasse pas partie de mon langage quotidien », dit-elle. « Je ne suis pas
disposée à utiliser l’hébreu sauf si je n’ai vraiment pas le choix, pas lors d’une
réunion ou avec des amis. »
Dima décrit cette frontière
linguistique comme étant à la fois personnelle et politique. « Utiliser une
langue qui ne me reflète pas était difficile. C’était un défi constant de la
séparer de mon identité. » Son détachement vis-à-vis de l’hébreu, dit-elle, s’est
accentué ces derniers mois. « Dès le début, j’avais des réserves à l’égard de
cette langue et de tout ce que représente l’État. Tout cela s’est intensifié
avec cette guerre. »
Pour Dima, parler arabe, en
particulier dans les espaces palestiniens communs, est une forme de résistance
culturelle. « Notre simple présence ici est une forme de résistance. Alors que
l’État tente de judaïser tout ce qui nous touche, nous accrocher à notre
langue, à nos coutumes et à notre identité est notre moyen de riposter. »
Ce sentiment d’imposition
culturelle est également ressenti par Arwa, une jeune fille de 18 ans qui vient
d’obtenir son diplôme d’études secondaires et se prépare à entrer à l’université
dans le centre d’Israël. Comme les autres, Arwa parle couramment l’hébreu ;
elle a excellé dans cette langue tout au long de sa scolarité et a obtenu de
bons résultats aux examens nationaux. Mais dernièrement, elle s’est mise à le
pratiquer moins, en particulier dans des situations informelles avec ses amis.
Arwa, qui vit dans la ville de
Sakhnin, dans le nord du pays, explique qu’elle et ses camarades se sentent
souvent exclus par leurs homologues juifs israéliens, que ce soit dans la vie
sociale ou dans le milieu scolaire. « Nous ne nous sentons pas les bienvenus »,
explique-t-elle. « Nous avons constamment le sentiment d’être des étrangers,
même si nous vivons ici, parlons la même langue et étudions dans les mêmes
établissements. »
Certains diplômés arabes du
secondaire ont des difficultés à étudier dans les collèges et universités
israéliens où l’hébreu est la langue d’enseignement, car ils ne maîtrisent pas
suffisamment cette langue. Dans les établissements d’enseignement supérieur
israéliens, ils sont censés parler l’hébreu aussi couramment que les locuteurs
natifs, car les cours, les examens et les devoirs sont tous en hébreu, alors
que près d’un cinquième des étudiants israéliens sont de langue maternelle
arabe.
Arwa décrit « une forte identité
culturelle enracinée en Palestine », et non dans l’État israélien. Et bien que
ses résultats scolaires restent solides, elle admet qu’elle appréhende d’entrer
dans des espaces universitaires dominés par l’hébreu. « Je crains de ne pas
être capable de tenir des conversations à ce niveau de fluidité », dit-elle. «
Ce n’est pas que je ne comprends pas, c’est juste que je n’ai plus l’impression
que ça m’appartient. »
Bien qu’Arwa reconnaisse son
utilité, elle a commencé à associer l’hébreu à bien plus que la communication.
« Après avoir été témoin de la vérité en ligne, de la guerre à Gaza, du
massacre de mon peuple, tout cela documenté, j’ai cessé de voir l’hébreu comme
une simple langue », dit-elle. « C’est devenu la langue de l’occupation, la
langue d’une société qui exprime son racisme envers mon peuple.
Ses parents travaillent tous deux
pour le ministère israélien de l’Éducation, ce qui explique que la famille
reste relativement discrète sur ses opinions culturelles et politiques en
public. Mais à la maison, l’attachement à la langue arabe est évident. « Nous
avons été élevés dans le sentiment d’appartenir à notre patrie, et non à l’occupant
», explique-t-elle. « Nous ne parlons qu’arabe à la maison, à l’exception de
quelques mots hébreux qui se sont naturellement glissés dans notre langage au
fil des ans, comme mazgan [climatiseur]. »
Changement de code et identité
Ce glissement subtil, l’utilisation
de mots hébreux dans des conversations autrement arabes, est courant chez les
citoyens palestiniens d’Israël. Bien qu’il existe des équivalents arabes (par
exemple « mukayyif » pour « mazgan »), les mots empruntés à l’hébreu
les remplacent souvent dans le langage courant. Ce phénomène, connu sous le nom
de “code-switching” [alternance codique ou changement de code, NdT], est
profondément ancré dans les habitudes linguistiques de nombreuses familles
palestiniennes vivant en Israël.
Une étude
publiée en 2019 dans le Global Journal of Foreign Language examine les
raisons pour lesquelles l’hébreu s’immisce dans les conversations arabes dans
une enquête auprès d’étudiants arabes israéliens de l’Université
arabo-américaine de Cisjordanie, où les cours sont dispensés exclusivement en
arabe ou en anglais.
Les étudiants ont signalé des cas
de changement de code même dans un environnement entièrement arabophone, et ont
indiqué que ce phénomène était souvent inconscient ; les participants ont
expliqué qu’ils n’avaient pas appris les équivalents arabes de certains mots
dans leur famille ni même à l’école. L’étude a également révélé que l’âge et l’origine
des personnes interrogées en Israël avaient une influence significative sur
leur utilisation de l’hébreu.
« Il était clair que le nord a
tendance à changer de code plus que le centre d’Israël », écrivent les
chercheurs, ajoutant qu’« un pourcentage important d’étudiants venant du sud d’Israël
utilisent le changement de code principalement pour des raisons liées à la
proximité géographique des colonies israéliennes et au fait que de nombreux
citoyens druzes [qui vivent principalement dans le nord d’Israël] servent dans
l’armée israélienne ».
Dans cette étude, 72 % des
participants estimaient que le changement de code linguistique avait une
incidence sur leur sentiment d’identité palestinienne. La langue continuant à
servir non seulement d’outil de communication, mais aussi de marqueur
identitaire, le choix entre les mots mazgan et mukayyif dépasse
la simple question sémantique. Il devient politique.
Mustafa, un père de 39 ans
originaire de Nazareth, explique que son fils Mohammed, âgé de 13 ans, a
développé une forte aversion pour l’hébreu. « Seuls quelques mots basiques lui
échappent, comme mazgan, shalat (télécommande) ou haklata (enregistrement).
Et même là, Mohammed ne les utilise pas beaucoup. Il n’aime pas l’hébreu, c’est
la matière qu’il déteste le plus à l’école ».
« Il faut beaucoup d’efforts et
de temps pour qu’il termine ses devoirs d’hébreu », admet Mustafa. « La guerre
à Gaza l’a profondément marqué. Depuis le 7 octobre, il s’est encore plus
éloigné de cette langue. »
Au lieu de cela, Mohammed s’est
tourné vers l’anglais. « Il l’utilise beaucoup plus, surtout quand nous
voyageons », explique Mustafa. « Je vois la différence dans son enthousiasme.
Il passe tout en anglais : son téléphone, ses jeux vidéo, ses films. Cela le
passionne. L’hébreu, en revanche, ne lui parle tout simplement pas. »
Ce fossé entre la langue et l’identité
est une source de tension pour Mustafa, tant sur le plan émotionnel qu’en tant
que parent. « C’est un sujet très sensible pour nous », dit-il. « D’un côté,
nous essayons de l’encourager à apprendre l’hébreu : c’est nécessaire pour
vivre ici. Mais d’un autre côté, je veux qu’il excelle dans quelque chose qu’il
aime. Je veux qu’il ait des rêves qui dépassent les frontières de ce pays. »
Un moment qui l’a particulièrement marqué est celui où il a essayé de motiver son fils à terminer un devoir d’hébreu. « Je lui ai dit : “L’hébreu, c’est facile, c’est comme l’arabe, on est pratiquement cousins !” Et il m’a regardé et m’a répondu : “Tu n’arrêtes pas de dire qu’on est cousins, mais ils sont en train de nous tuer.” »