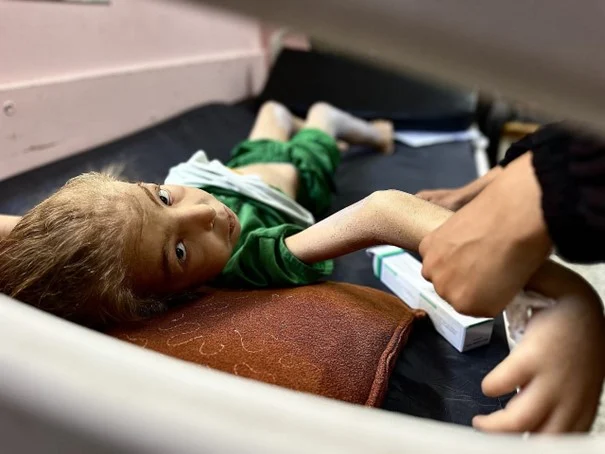Mon corps est à bout. Ma mère s’effondre
d’épuisement. Mon cousin défie la mort chaque jour pour obtenir un peu d’aide.
Les enfants de Gaza meurent sous nos yeux, et nous sommes impuissants à les
aider.
Ruwaida Amer ,+972 Magazine, 21/7/2025
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
Ruwaida Kamal Amer est une journaliste,
productrice et réalisatrice (sur)vivant à Gaza. Elle a précédemment travaillé
comme enseignante de sciences. Après le déclenchement de la guerre, elle est
restée avec sa famille à Gaza, d’où elle rend compte du génocide en cours et de
ses effets dévastateurs sur la population civile. Son travail a été publié par
plusieurs médias internationaux tels qu’Al Jazeera English, Euronews et ABC
News. Elle écrit régulièrement pour le magazine +972 sur la réalité quotidienne
de la vie dans Gaza assiégée et sur la crise humanitaire, et elle met souvent
en lumière des histoires qui sont souvent ignorées par les médias grand public.
Des
Palestiniens tentent de recevoir un repas chaud préparé par des bénévoles, à
Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 20 juin 2025. (Abed Rahim
Khatib/Flash90)
J’ai tellement faim.
Je n’ai jamais pensé ces mots
comme je les pense aujourd’hui. Ils véhiculent une sorte d’humiliation que je
ne peux pas vraiment décrire. À chaque instant, je me surprends à souhaiter : «
Si seulement ce n’était qu’un cauchemar. Si seulement je pouvais me réveiller
et que tout soit fini. »
Depuis mai dernier, après avoir
été contrainte
de fuir mon foyer et trouver refuge chez des proches
dans le camp de réfugiés de Khan Younès, j’ai entendu ces mêmes mots prononcés
par d’innombrables personnes autour de moi. Ici, la faim est vécue comme une
atteinte à notre dignité, une cruelle contradiction dans un monde qui se targue
de progrès et d’innovation.
Chaque matin, nous nous
réveillons avec une seule idée en tête : trouver quelque chose à manger. Je
pense immédiatement à notre mère malade, qui a subi une opération de la colonne
vertébrale il y a deux semaines et qui a maintenant besoin de se nourrir pour
se rétablir. Nous n’avons rien à lui offrir.
Et puis il y a ma petite nièce et
mon petit neveu, Rital, 6 ans, et Adam, 4 ans, qui réclament sans cesse du
pain. Et nous, les adultes, nous essayons de résister à notre propre faim afin
de garder les miettes pour les enfants et les personnes âgées.
Depuis qu’Israël a imposé un
blocus total sur Gaza début mars (qui n’a été que
légèrement assoupli fin mai), nous n’avons pas mangé de viande, d’œufs ou de
poisson. En fait, nous avons dû renoncer à près de 80 % de notre alimentation
habituelle. Nos corps sont à bout. Nous nous sentons constamment faibles,
désorientés et déséquilibrés. Nous sommes facilement irritables, mais la
plupart du temps, nous restons silencieux. Parler demande trop d’énergie.
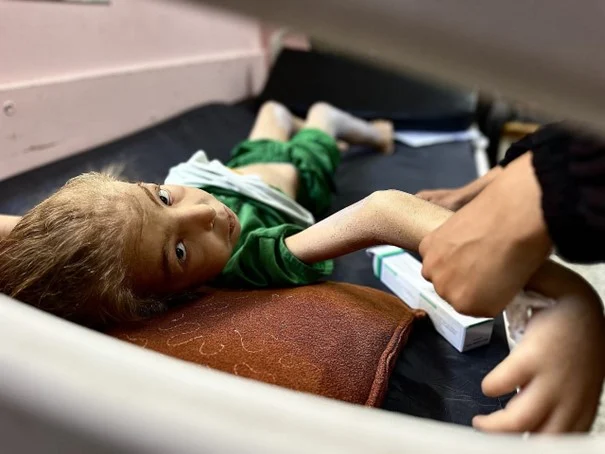
Huda Abu
Al-Naja, 12 ans, accompagnée de sa mère, reçoit un traitement contre la
malnutrition à l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de
Gaza, le 25 juin 2025. (Doaa Albaz/Activestills)
Nous essayons d’acheter tout ce
qui est disponible sur les marchés, mais les prix deviennent impossibles. Un
kilo de tomates coûte désormais 90 NIS (= 23€). Les concombres sont à 70 NIS le
kilo (= 18€). Un kilo de farine coûte 150 NIS (= 39€). Ces chiffres semblent
scandaleux et cruels.
Nous survivons avec un seul repas
par jour : généralement du pain, fait avec la farine que nous avons réussi à
trouver. Si nous avons de la chance, le déjeuner comprend parfois un peu de
riz, mais cela ne suffit pas à nous rassasier. Nous essayons de mettre un peu
de nourriture de côté pour ma mère, peut-être quelques légumes, mais ce n’est
jamais assez. La plupart du temps, elle est trop faible pour se tenir debout,
trop épuisée pour même prier.
Nous ne sortons presque plus de
chez nous, de peur que nos jambes ne nous lâchent. C’est déjà arrivé à ma sœur
: alors qu’elle cherchait dans les rues quelque chose, n’importe quoi, pour
nourrir ses enfants, elle s’est soudainement effondrée sur le sol. Son corps n’avait
même plus la force de rester debout.
Nous avons commencé à prendre
conscience de la gravité de la crise alimentaire lorsque le boulanger Abou
Hussein, connu de tous dans le camp, a commencé à réduire son activité. Il
cuisait auparavant pour des dizaines de familles chaque jour, dont la nôtre,
qui n’avons plus ni gaz ni électricité pour cuisiner. Du matin au soir, ses
fours à bois fonctionnaient sans interruption.
Mais récemment, il a été
contraint de réduire progressivement son temps de travail hebdomadaire. Ma sœur
rentrait à la maison et disait : « Abou Hussein est fermé. Il travaillera
peut-être demain. » Aujourd’hui, trouver de la pâte et de la farine est devenu
une véritable épreuve.
Trois générations en proie à la famine
Dans le camp, j’ai compris la
véritable cruauté de ce génocide : la promiscuité étouffante, la foule de
réfugiés chassés de leurs maisons et les innombrables récits de famine.
Une femme
palestinienne déplacée nourrit des enfants à Al-Mawasi, dans le sud de la bande
de Gaza, le 13 juillet 2025. (Doaa Albaz/Activestills)
Je vis actuellement chez ma
tante, qui nous a recueillis après notre déplacement et nous héberge depuis
deux mois. Comme presque tous les autres bâtiments du camp, sa maison a été
presque entièrement détruite par les attaques israéliennes. Les frères et sœurs
de ma tante ont travaillé sans relâche pour réparer ce qu’ils pouvaient et ont
réussi à rendre une pièce habitable.
La maison déborde de
petits-enfants, chacun luttant contre la faim. Mon cousin aîné, Mahmoud, est
père de quatre d’entre eux. Il a lui-même perdu près de 40 kilos au cours des
derniers mois. Les signes de malnutrition sont visibles partout sur son visage
pâle et son corps émacié.
Chaque jour avant l’aube, Mahmoud
se rend dans les centres de distribution d’aide humanitaire gérés par les USA, risquant
sa vie pour essayer de ramener de quoi manger à ses
enfants affamés. Depuis que je suis arrivé chez eux, il me raconte jour après
jour les mêmes histoires poignantes.
« Aujourd’hui, j’ai rampé à
quatre pattes parmi une foule de milliers de personnes », m’a-t-il récemment
confié en me montrant un sac rempli de restes de nourriture qu’il avait réussi
à récupérer. « J’ai dû ramasser tout ce qui était tombé par terre : des
lentilles, du riz, des pois chiches, des pâtes, même du sel. J’ai mal partout
où j’ai été piétiné, mais je dois le faire pour mes enfants. Je ne supporte pas
d’entendre leurs cris de faim. »
Un jour, Mahmoud est revenu les
mains vides. Il était livide et semblait sur le point de s’effondrer. Il m’a
raconté que l’armée israélienne avait ouvert le feu sans avertissement. « Le
sang d’un jeune homme à côté de moi a éclaboussé mes vêtements, m’a-t-il dit.
Pendant un instant, j’ai cru que c’était moi qui avais été touché. Je me suis
figé, persuadé que la balle était dans mon corps. »
Le jeune homme s’est effondré
juste devant lui, mais Mahmoud n’a pas pu s’arrêter pour lui venir en aide. « J’ai
couru plus de six kilomètres sans me retourner. Mes enfants ont faim et
attendent que je leur ramène à manger », a-t-il déclaré d’une voix brisée, «
mais ils ne seront pas contents si je rentre mort ».

Un
Palestinien blessé récupère de l’aide humanitaire distribuée par des organisations
internationales à Gaza, dans le nord de la bande de Gaza, le 26 juin 2025.
(Yousef Zaanoun/Activestills)
Mon autre cousin, Khader, a 28
ans. Il a une fille de 2 ans et sa femme est enceinte. Il est rongé par l’inquiétude
pour leur enfant à naître, qui doit venir au monde dans deux mois. Sa femme ne
mange pas correctement et chaque jour, il reste assis en silence, tourmenté par
les mêmes questions : Cette famine va-t-elle nuire à ma femme ? L’enfant qu’elle
mettra au monde sera-t-il en bonne santé ou malade ?
Sa fille de deux ans, Sham,
pleure toute la journée parce qu’elle a faim. Elle réclame du pain, n’importe
quoi d’autre que les aliments insipides et lourds à digérer qui composent son
régime quotidien, à savoir du riz, des lentilles et des haricots, qui lui ont
donné la diarrhée à plusieurs reprises.
Un jour, une amie de Khader lui a
donné une poignée de raisins pour elle. C’était un petit miracle. Khader s’est
agenouillé à côté de Sham et lui a offert les raisins, mais elle les a
simplement regardés, jouant avec eux dans ses petites mains et refusant de les
manger. Elle ne les reconnaissait pas : en deux ans de vie à Gaza, elle n’avait
jamais vu de raisins.
Ce n’est que lorsque son père en
a mis un dans sa bouche et lui a souri qu’elle l’a imité avec hésitation. Elle
a mâché. Puis elle a ri.
Les corps s’éteignent
Je me tiens souvent à la porte de
la maison, à regarder les enfants du camp. Ils passent la plupart de leur temps
assis par terre, le regard vide, fixant les passants. Quand je demande à l’un d’eux
de m’acheter une carte Internet pour que je puisse travailler ou appeler ma
nièce depuis la maison du voisin, ils me répondent d’une voix faible et
fatiguée. Ils me disent qu’ils ont faim. Qu’ils n’ont pas mangé de pain depuis
des jours.
Je n’ai que 30 ans, mais je ne
suis plus la femme énergique que j’étais autrefois. Avant, je travaillais de
longues heures. entre l’enseignement
et le journalisme, mais depuis que cette guerre a commencé, je n’ai
pas eu un instant de répit. Je jongle entre des tâches ménagères épuisantes —
prendre soin de ma mère et de ma famille — tout en essayant simultanément
de continuer
à documenter et à rédiger à propos de tout ce qui se passe
autour de moi.
Une femme
palestinienne déplacée prépare du pain sous sa tente, à Al-Mawasi, dans le sud
de la bande de Gaza, le 13 juillet 2025. (Doaa Albaz/Activestills)
Mais depuis environ un mois, je
ne suis plus capable de suivre l’actualité. Je n’arrive plus à me concentrer.
Mon corps est à bout. Je souffre d’anémie après avoir mangé exclusivement des
lentilles et d’autres légumineuses pendant des mois. Et depuis deux jours, je
ne peux plus avaler à cause d’une grave inflammation de la gorge, conséquence
de ma consommation excessive de dukkah
et de piments rouges pour tenter d’apaiser ma faim.
Mahmoud, un photographe de 28 ans
qui travaille avec moi sur des reportages vidéo, est également en difficulté. «
Je n’ai rien mangé depuis deux jours, à part de la soupe », m’a-t-il récemment
confié. « Je n’ai plus la force de travailler. » Personne n’en a la force.
Travailler pendant un génocide exige une force impossible à maintenir. La
famine a paralysé la productivité de tous les travailleurs de Gaza.
Hier, j’ai accompagné ma mère à l’hôpital
Nasser pour une séance de kinésithérapie après son opération. Sur le chemin,
nous avons vu des dizaines de personnes qui ne pouvaient pas marcher plus de
quelques mètres sans devoir s’arrêter pour se reposer. Ma mère était dans le
même état : ses jambes étaient trop faibles pour la porter. Elle s’est assise
sur une chaise en plastique au bord de la route, rassemblant le peu d’énergie
qu’elle pouvait pour continuer.
Alors que nous continuions à
marcher, nous avons entendu des cris. Des jeunes hommes et femmes couraient en
criant de joie : « Il y a des camions de farine dans la rue ! » Une foule
immense s’était formée. Les gens couraient désespérément vers les camions pour
tenter d’obtenir un sac de farine.
C’était le chaos. Personne n’escortait
les camions pour s’assurer que tout le monde puisse obtenir sa part en toute
sécurité. Au lieu de cela, nous avons vu la foule se précipiter vers des zones
dangereuses contrôlées par l’armée israélienne, juste pour obtenir de la
farine.
Certaines personnes sont revenues
avec des sacs. D’autres ont été
tuées. Nous avons vu des corps emportés sur les épaules d’hommes,
abattus à bout portant là où l’aide était censée leur sauver la vie.
Des
Palestiniens transportent un homme blessé par des tirs israéliens alors qu’il
tentait d’obtenir de l’aide alimentaire dans la rue Al-Rashid, au nord de la
ville de Gaza, le 16 juin 2025. (Yousef Zaanoun/ActiveStills)
18 morts de faim en 24 heures
Après la séance de thérapie, nous
avons quitté l’hôpital et sommes passées devant des femmes qui pleuraient sur
leurs enfants affamés, mourant sous nos yeux. Une femme, Amina Badir, hurlait
en serrant son enfant de 3 ans dans ses bras.
« Dites-moi comment sauver ma
fille Rahaf de la mort », s’écria-t-elle. « Depuis une semaine, elle ne mange
qu’une cuillère de lentilles par jour. Elle souffre de malnutrition. Il n’y a
pas de traitement, pas de lait à l’hôpital. Ils lui ont retiré son droit à la
vie. Je vois la mort dans ses yeux. »
Selon le ministère de la Santé à
Gaza, le nombre de morts dus à la faim et à la malnutrition depuis le 7
octobre a
augmenté à 86 personnes, dont 76 enfants. Hier, il a signalé que
18 personnes étaient mortes de faim au cours des dernières 24 heures seulement.
Le personnel médical a
tenu un piquet de protestation à l’hôpital Nasser pour demander l’intervention
internationale avant que davantage de personnes ne meurent de faim.
Je n’ai pas trouvé de taxi pour
nous ramener à la maison. Ma mère a attendu à la porte de l’hôpital pendant que
je cherchais un moyen de transport, mais le carburant est rare et les taxis
sont pratiquement inexistants. J’ai passé une heure entière à essayer.
Quand je suis revenue, j’étais
étourdie et faible. Je me suis effondrée. J’ai essayé de rester forte pour ma
mère, mais il n’y avait personne d’autre avec nous. Autour de moi, je voyais
des gens s’évanouir partout. Un homme m’a dit : « S’il y avait eu de la
nourriture convenable, ta mère ne serait pas tombée aussi malade. »
Nous essayons tous de nous
réconforter mutuellement dans cette famine sans fin. Sur Facebook, les gens
expriment leur colère, publiant post après post sur la politique d’affamement
menée par Israël qui a mis Gaza à genoux. Nous ne pouvons plus faire les choses
les plus élémentaires que les gens font chaque jour partout dans le monde. La
faim nous a tout pris.