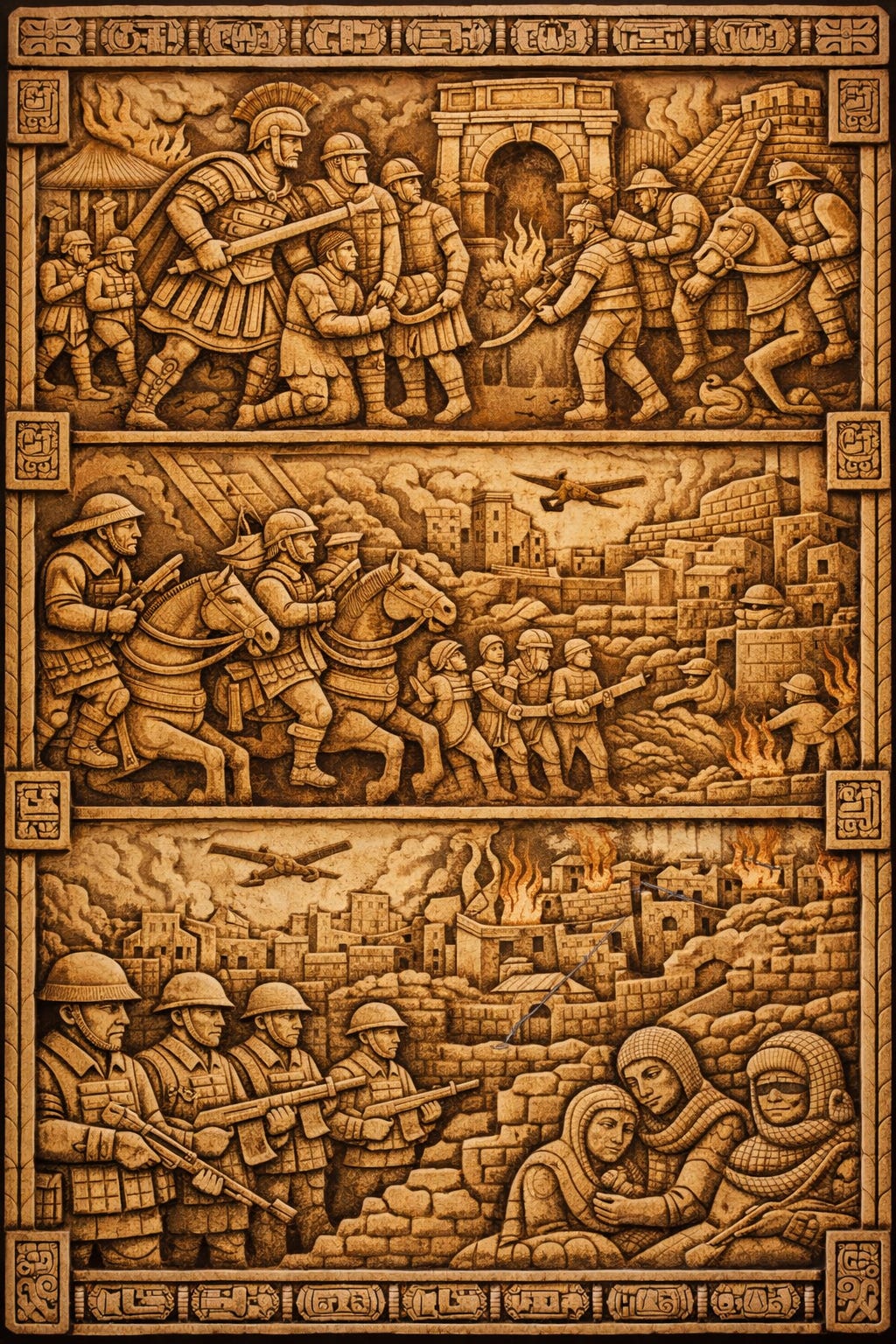Collettivo Le Gauche, 8/11/2025
Traduit par Tlaxcala
Lire aussi
Hommage à Paolo Virno
Paolo Virno, récemment disparu, a écrit un livre qui demeure pour nous fondamental, intitulé Grammaire de la multitude. Pour une analyse des formes de vie contemporaines. Le noyau de sa réflexion part de la réactivation d’une ancienne alternative conceptuelle, celle entre peuple et multitude, qui aujourd’hui se propose à nouveau comme un instrument herméneutique décisif pour déchiffrer les formes de la sphère publique contemporaine. Cette dichotomie, forgée dans le feu des luttes pratiques et théoriques du XVIIᵉ siècle – de la fondation des États modernes aux guerres de religion – vit la nette prévalence du concept de peuple, tandis que multitude devint le terme perdant, expulsé du lexique politique dominant. La thèse de fond est qu’au crépuscule d’un long cycle historique, et au cœur d’une crise radicale de la théorie politique moderne, c’est précisément la notion alors vaincue qui manifeste une vitalité extraordinaire, se prêtant à une éclatante revanche théorique.
Les deux polarités ont leurs pères putatifs en Hobbes et Spinoza, qui les définissent en opposition radicale. Pour Spinoza, la multitudo désigne une pluralité qui persiste en tant que telle sur la scène publique, dans l’action collective et la gestion des affaires communes, sans se fondre dans un Un, sans se dissoudre dans un mouvement centripète. C’est la forme d’existence politique et sociale des « nombreux en tant que nombreux » : une forme permanente, non épisodique ni interstitielle, qu’il considère comme la clef de voûte même des libertés civiles. À l’extrême opposé, Hobbes, avec une attitude que Virno n’hésite pas à qualifier de « haine », voit dans la multitude le plus grand danger pour le « suprême empire », pour ce monopole de la décision politique qu’est l’État. Pour Hobbes, la sphère publique moderne peut avoir pour centre de gravité ou bien la multitude, ou bien le peuple, mais pas les deux. Le peuple est une entité unifiée, dotée d’une volonté unique, et il est le reflet direct de l’existence de l’État : là où il y a l’État, là se constitue le peuple.
La multitude, au contraire, relève de l’« état de nature » ; elle est l’héritage antérieur à l’institution du corps politique, un refoulé susceptible de resurgir à tout moment pour ébranler la souveraineté étatique. La multitude, par son caractère intrinsèquement pluriel, se dérobe à l’unité politique, résiste à l’obéissance et, surtout, ne transfère jamais ses droits naturels au souverain. La célèbre formule hobbesienne – « les citoyens, lorsqu’ils se rebellent contre l’État, sont la multitude contre le peuple » – cristallise cette opposition à son diapason.
La question cruciale qui se pose est celle de savoir comment la multitude a survécu à l’hégémonie du modèle étatique-populaire. La réponse est qu’elle a été exorcisée et confinée dans des formes dissimulées et rachitiques à l’intérieur des deux grandes traditions politiques modernes. Dans la pensée libérale, l’inquiétude suscitée par les « nombreux » a été domestiquée à travers la dyade public/privé. La multitude, privée de voix et de présence publique, a été reléguée dans la sphère du privé, entendue au sens étymologique de privus, c’est-à-dire « dépourvu », privé de pertinence publique. Dans la pensée démocratique-socialiste, un écho de l’antique multitude résonne au contraire dans le second terme du couple collectif/individuel. Le peuple est le collectif, la volonté générale, tandis que la multitude se profile dans la prétendue impuissance et l’agitation désordonnée de l’individu singulier, perçu comme un reste ineffable et inopérant.
Aujourd’hui, dans les formes contemporaines de la vie et de la production matérielle, on assiste à un brouillage de ces lignes de démarcation. Les couples conceptuels public/privé et collectif/individuel « ne tiennent plus, mordent dans le vide, s’entrechoquent ». L’expérience collective et l’expérience individuelle, tout comme la sphère publique et la sphère privée, se confondent et se superposent inextricablement. La multitude contemporaine n’est plus composée ni de « citoyens » au sens classique, ni de « producteurs » au sens traditionnel : elle occupe une région médiane et hybride. Il est essentiel de souligner que cette multitude ne s’oppose pas de manière simpliste à l’Un, comme dans une certaine rhétorique postmoderne qui célèbre le multiple comme un bien absolu, mais qu’elle le redéfinit radicalement. Les nombreux ont eux aussi besoin d’une forme d’unité, mais cette unité n’est plus l’État, point d’aboutissement d’une convergence. Elle est plutôt une prémisse, un arrière-plan : le langage, l’intellect, les facultés communes du genre humain. L’Un dont les nombreux, dans un mouvement centrifuge, se différencient et persistent comme tels, est un universel partagé qui rend possible la différenciation elle-même.
Pour analyser concrètement cette multitude, Virno propose de développer trois blocs thématiques, dont le premier est la dialectique entre peur et recherche de sécurité. Le modèle traditionnel, de Kant à Heidegger, distinguait nettement entre une peur déterminée, liée à un danger circonscrit (une avalanche, le chômage), et une angoisse indéterminée, provoquée par la pure exposition au monde dans son ensemble, par le « ne pas se sentir chez soi » (Heidegger). À ces deux formes de crainte correspondaient deux formes d’abri : une sécurité empirique pour la peur, et un refuge absolu, souvent de nature religieuse ou morale, pour l’angoisse. Cette distinction servait de fondement au concept de peuple, lié à l’existence de communautés substantielles qui délimitaient un « dedans » stable et rassurant opposé à un « dehors » inconnu et angoissant.
Cette séparation nette a disparu pour trois raisons fondamentales. D’abord, les communautés substantielles, avec leur éthos consolidé et leurs « jeux de langage » familiers, se sont dissoutes. Les individus sont désormais accoutumés au changement rapide et vivent dans une réalité toujours déjà innovée, exposés en permanence à l’imprévu. Il n’existe plus de « dedans » protégé, de sorte que tout danger factuel se teinte immédiatement des couleurs de l’angoisse indéterminée. Peur et angoisse se superposent dans un sentiment que Virno propose d’appeler le perturbant. Ensuite, ce « ne pas se sentir chez soi » n’est plus une expérience solitaire et intérieure, mais il est devenu une condition commune et partagée, un fait public qui rassemble la multitude. Enfin, et c’est le point le plus radical, la séquence logique même peur-abri se trouve renversée. L’expérience originaire n’est pas la perception d’un danger appelant une réponse, mais l’activité première et active de se procurer un abri. C’est dans la tentative de nous protéger que nous identifions, souvent rétrospectivement, les dangers. Le vrai danger n’est souvent rien d’autre qu’une stratégie de salut monstrueuse et vénéneuse (le souverain fort, la xénophobie, la course effrénée à la carrière).
La
dialectique se transforme ainsi en une dialectique entre formes alternatives de
protection. C’est dans ce paysage modifié que s’enracine l’expérience de la
multitude, unie par le désarroi et caractérisée par une oscillation constante
entre des stratégies de réassurance opposées.
La ressource essentielle à laquelle la multitude puise pour s’orienter et se protéger dans ce monde sans certitudes, ce sont les lieux communs (topoi koinoi). Ceux-ci, au sens aristotélicien originel et non dans celui, moderne, de banalités, sont les formes logico-linguistiques de valeur universelle (le rapport plus/moins, l’opposition des contraires, la réciprocité) qui constituent l’ossature de tout discours. Avec le déclin des lieux spécifiques (topoi idioi), ces codes sectoriels et contextuels propres à des communautés particulières (le parti, l’Église, le groupe de supporteurs), les lieux communs perdent leur caractère d’arrière-plan inaperçu et remontent à la surface, devenant visibles et immédiatement utilisables comme unique boussole disponible. La « vie de l’esprit », l’intellect dans sa forme la plus abstraite et générale, devient ainsi un bien public et partagé.
C’est ici que Virno reprend la notion marxienne d’intellect général (General Intellect), l’intellect général qui, de principale force productive dans le capitalisme contemporain, devient aussi la ressource apotropaïque de la multitude. Ainsi se renverse l’analogie aristotélicienne entre le penseur et l’étranger : ce n’est plus le penseur qui s’éloigne temporairement de la communauté, mais c’est la multitude entière des « étrangers », de ceux qui ne se sentent pas chez eux, qui doit se comporter, par nécessité, comme un penseur, en recourant à l’intellect abstrait pour naviguer dans la contingence.
Cette publicité de l’intellect, ce General Intellect devenu patrimoine commun, est profondément ambivalente. S’il ne se traduit pas en une sphère publique non étatique, en un espace politique où les nombreux puissent délibérer des affaires communes, il peut engendrer des effets terrifiants. Virno rappelle l’essai freudien sur L’Inquiétante étrangeté, où la croyance en l’omnipotence des pensées et la situation fusionnelle de la séance spirite exemplifient les effets angoissants d’une pensée dotée d’efficacité pratique immédiate, mais dépourvue de médiation politique. Dans le processus productif postfordiste, où le partage d’attitudes linguistico-cognitives générales est la condition technique fondamentale, ce même partage, s’il ne devient pas république, se traduit par une prolifération de hiérarchies personnelles et arbitraires, par une dépendance personnelle qui soumet l’être entier du travailleur. La publicité sans sphère publique est donc le versant négatif et dangereux de l’expérience de la multitude.
L’Un de la multitude n’est pas et ne peut pas être l’Un étatique du peuple. C’est un Un d’une autre nature, constitué des lieux communs de l’esprit, de l’intellect général, du langage lui-même. Si la multitude du XVIIᵉ siècle, héritière des républiques communales, exerçait un jus resistentiae pour défendre des coutumes et des prérogatives locales déjà existantes, la multitude contemporaine, tout en partageant cette logique défensive et non représentative, a pour fond un Un bien plus universel que l’État et est profondément marquée par l’histoire du capitalisme et du mouvement ouvrier. Sa particularité est de fomenter l’effondrement de la représentation politique au nom de la recherche de nouvelles formes politiques qui s’approprient le savoir/pouvoir aujourd’hui figé dans les appareils étatiques. Contre la tentation de voir dans la multitude la fin de la classe ouvrière, Virno soutient qu’elle en représente plutôt une nouvelle configuration historique. La classe ouvrière, en tant que productrice de plus-value, ne disparaît pas : c’est sa manière d’être qui change, passant de populaire à multitudinaire, avec tout ce que cela implique en termes de mentalité, d’organisation et de conflit.
La
fabrique loquace
Angelo Nizza, dans Linguaggio e lavoro nel XXI secolo (Langage et travail au XXIᵉ siècle. Nature et histoire d’une relation), soutient que la perspective opéraïste — à l’intérieur de laquelle s’inscrit la pensée de Paolo Virno — interprète l’alliance contemporaine entre langage et travail comme le signe d’une transformation fondamentale, par laquelle la poiesis (l’activité productive orientée vers un extérieur) est en train de devenir praxis, un agir qui contient en lui-même sa propre fin. Le mérite spécifique de Virno est d’avoir cristallisé ce lien dans une implication logique particulièrement efficace : si la communication devient un élément constitutif du travail, alors son dispositif téléologique se fissure inévitablement et, une fois la prédominance du modèle finaliste évanouie, se dissout également le monisme du concept de production.
Cette série de conséquences négatives trouve sa formulation la plus dense dans la notion de travail sans téléologie, qui désigne une poiesis entrée dans une zone d’indétermination sémantique précisément pour avoir absorbé en elle les caractères typiques de la praxis. Virno construit son argumentation en déconstruisant le concept traditionnel de travail comme poiesis à travers deux mouvements logiques fondamentaux. Par le premier, il rattache encore fermement le concept de travail à la téléologie, reprenant la distinction aristotélicienne selon laquelle, contrairement à la praxis, qui a sa fin en elle-même, le travail est régi par un rapport causal moyen-fin et trouve son unité de mesure dans un produit extérieur. Par le second argument, Virno identifie la condition de possibilité de ce finalisme : la solidité du rapport travail-téléologie dépend entièrement du caractère restreint du travail, c’est-à-dire de l’exclusion rigoureuse de la communication linguistique du concept de production. Pour que le travail puisse se maintenir comme poiesis pure, il faut qu’il expurge l’interaction linguistique.
C’est ainsi que Virno, dans le but polémique de réfuter Habermas, pousse à l’extrême l’opposition entre travail et interaction, en indiquant dans le langage l’« au-delà » spécifique de la notion de poiesis. Le caractère distinctif de l’agir communicatif, en effet, n’est pas l’emploi d’un moyen en vue d’une fin. L’action linguistique ne s’inscrit pas dans le régime des causes naturelles et, par conséquent, dans son déroulement, le moyen ne transite pas vers une fin extérieure. Il apparaît donc évident que la communication, au moment où elle devient le terme médian du processus de travail, en dissout la structure rigoureusement finaliste. La thèse du travail sans téléologie saisit l’indistinction entre praxis et poiesis sans supprimer la paire conceptuelle, préservant ainsi l’idée de l’existence humaine comme vie active, en contraste net avec les positions d’Agamben. De plus, elle identifie avec précision à la fois l’opérateur de cette transformation — le langage — et l’opération spécifique, c’est-à-dire la pénétration du langage dans le travail, qui est à l’origine du mélange entre agir et faire, se distanciant aussi des thèses de Rossi-Landi.
Dans l’essai Virtuosité et révolution, théorie politique de l’exode et dans Grammaire de la multitude, Paolo Virno part d’un paradoxe palpable de la condition contemporaine : l’action politique, jadis notion familière et opérante, apparaît aujourd’hui enveloppée d’une aura d’inaccessibilité énigmatique. Cette paralysie de l’agir, soutient Virno, ne se réduit pas à une simple conjoncture défavorable ou à l’hégémonie d’une idéologie résignée : elle plonge ses racines dans une transformation essentielle et durable du fond même de notre expérience. Pour la comprendre, il faut remettre en question la tripartition consolidée de l’existence humaine en Travail (poiesis), Action politique (praxis) et Intellect (vie de l’esprit), une distinction cardinale de la tradition philosophique, d’Aristote à Hannah Arendt.
Selon ce schéma classique, le Travail se caractérise par son aspect instrumental, finalisé à la production d’une œuvre durable et détachable de l’acte qui l’a générée. L’Action politique, elle, trouve sa fin en elle-même ; elle concerne l’imprévisible, le possible et le commencement de processus nouveaux, et se déploie nécessairement dans la « présence d’autrui », dans un « espace à structure publique ». L’Intellect pur, enfin, est une activité solitaire et imperceptible, retirée du tumulte du monde.
Virno conteste radicalement l’actualité de ce schéma. Les frontières entre ces sphères, autrefois perçues comme nettes, ont cédé, donnant lieu à des perméabilités et hybridations décisives. Sa thèse centrale, en contraste frappant avec celle de Hannah Arendt — qui voyait dans la politique moderne une dégénérescence sous forme de travail productif —, est que c’est exactement l’inverse qui s’est produit : c’est le Travail postfordiste qui a absorbé en lui les traits distinctifs de l’Action politique.
La figure clé pour comprendre cette métamorphose est celle du virtuose, de l’artiste exécutant, tel le pianiste ou le danseur. Sa performance, comme le notaient déjà Aristote et Arendt, est une activité « sans œuvre » qui ne produit pas d’objet extrinsèque et durable mais trouve son accomplissement en elle-même, et qui, pour exister, requiert constitutivement un public, une relation avec la « présence d’autrui ». Ce qui, autrefois, était un cas spécial et marginal — analysé avec une certaine perplexité même par Marx, qui, dans ses écrits sur le travail intellectuel, distinguait les activités produisant une œuvre de celles où « le produit est inséparable de l’acte de produire », assimilant souvent ces dernières au travail servile et improductif — est devenu le prototype du travail salarié contemporain.
Dans le capitalisme postfordiste, le travail vivant n’est plus principalement l’agent central du processus productif immédiat, mais il se situe « à côté » de celui-ci, assumant toujours plus les fonctions de « surveillance et de coordination ». Son activité consiste de moins en moins à atteindre une fin particulière, et de plus en plus à moduler, varier et intensifier la coopération sociale elle-même. Cette modulation s’opère à travers des prestations linguistiques et communicatives qui, s’épuisant dans l’interaction qu’elles déterminent, sont précisément « sans œuvre ». L’« espace à structure publique » dont le virtuose et l’homme politique ont besoin est désormais incorporé directement dans le processus productif. Le langage, dont l’acte d’énonciation est la virtuosité par excellence (puisqu’il ne présuppose pas de partition définie mais puise dans la pure potentialité de la faculté de langage), devient la matière première du travail.
Le slogan capitaliste de la « qualité totale » se révèle être la demande de rentabiliser le goût de l’action, l’aptitude à affronter l’imprévu et la capacité de commencer quelque chose de nouveau — toutes des qualités que la tradition attribuait à la praxis politique. La conséquence, profondément paradoxale, est l’éclipse et la paralysie de la politique au sens strict : elle apparaît désormais comme une duplication superflue et appauvrie d’une expérience déjà vécue — quoique sous forme asservie et déformée — à l’intérieur de la sphère productive. La multitude postfordiste est donc une multitude dépolitisée précisément parce que son travail est déjà, structurellement, saturé de politique.
Cette hybridation entre Travail et Action a été rendue possible par un second événement crucial : l’irruption publique de l’Intellect. Virno développe la catégorie marxienne du General Intellect tout en opérant une correction significative. Si, pour Marx, le savoir social général s’objectivait principalement dans le capital fixe, dans le système des machines, pour Virno, il se présente aujourd’hui avant tout comme un attribut direct du travail vivant — comme le répertoire des facultés génériques (langage, capacité d’abstraction, apprentissage, autoréflexion) qui constituent une ressource partagée, un bien commun.
Cet intellect devenu public, cette puissance mentale et linguistique, est la « partition » sui generis que les travailleurs-virtuoses exécutent dans leurs performances productives. Cette publicité de l’intellect, au lieu de se traduire en sphère publique autonome, est capturée et déformée par le travail salarié. Les conséquences de cette capture sont lourdes d’implications : on assiste à une étatisation de l’intellect. Sa publicité particulière, privée d’expression propre, se reflète dans l’État sous forme d’une croissance hypertrophique et autoritaire des appareils administratifs.
L’Administration, supplantant le système politico-parlementaire, devient le cœur de l’État, représentant une concrétisation despotique du General Intellect, un point de fusion entre savoir et commandement. L’ancienne expression « raison d’État » acquiert pour la première fois un sens non métaphorique : il ne s’agit plus du simple transfert du droit naturel au souverain (Hobbes), mais d’un véritable transfert de la publicité de l’intellect à l’appareil étatique.
La nature « sans œuvre » du travail virtuose, jointe à sa subordination, engendre un travail universellement servile. Comme l’activité ne s’objectivise pas dans un produit séparé, elle met directement en jeu la personne même de celui qui l’accomplit, ainsi que sa relation avec celui qui commande ou bénéficie de la prestation. La mise au travail de ce qu’il y a de plus commun — l’intellect et le langage —, non traduite en communauté politique, engendre une « personnalisation de l’assujettissement » visqueuse et étouffante.
Face à ce scénario, la voie de sortie indiquée par Virno consiste en un renversement des alliances. Le pari est de rompre le lien qui unit l’intellect au travail salarié et de construire une nouvelle, féconde alliance entre l’intellect et l’action politique. À ce passage radical, qui est à la fois une soustraction et une fondation, Virno donne le nom d’Exode.
L’Exode est une « soustraction entreprenante », une défection de masse qui, au lieu de protester à l’intérieur des règles données, modifie le contexte même du conflit, inventant de nouvelles possibilités et altérant les règles du jeu. Des exemples historiques d’une telle défection sont la fuite des ouvriers américains du XIXᵉ siècle vers les terres de frontière, ou la préférence, chez la force de travail juvénile italienne des années 1970, pour la précarité plutôt que pour le poste fixe en usine.
Aujourd’hui, la « frontière » à coloniser est l’excédent de savoirs, de communication et d’agir de concert impliqué par la publicité du General Intellect. La défection donne à cet excédent une expression autonome et affirmative, le soustrayant au double chantage du profit et de l’administration étatique.
Le sujet de cet Exode n’est pas le peuple, unitaire et représentable dans l’État, mais la multitude, un ensemble de singularités irréductibles qui coopèrent horizontalement sans se fondre dans une unité souveraine. La multitude, dont le mode d’être est l’agir-de-concert, obstrue par nature les mécanismes de la représentation politique, s’exprimant plutôt comme un ensemble de « minorités agissantes » qui n’aspirent pas à devenir majorité.
La crise de la représentation, loin d’être un mal absolu, devient ainsi l’occasion d’expérimenter des formes de « démocratie non représentative et extraparlementaire ». Les organes de cette démocratie sont les soviets, les conseils, les ligues, qui s’opposent à la délégation par la logique de l’Exemple : des actions paradigmatiques qui, en exhibant dans un cas particulier la possible alliance entre intellect et république, ont la force du prototype reproductible et non la froide normativité du commandement.
Les formes d’action de cette multitude sont la désobéissance radicale, qui ne transgresse pas une loi spécifique au nom d’une fidélité supérieure à l’ordre établi, mais met en cause le présupposé hobbesien de l’obéissance préalable et vide de contenu, fondement de la validité de tout commandement.
S’y ajoute la vertu d’intempérance qui, différente de la vulgaire incontinence, oppose une connaissance intellectuelle (le General Intellect) à la norme éthico-politique étatique, en tirant de celle-ci des conséquences pratiques en rupture avec les lois civiles. Dans ce nouveau contexte, même la géométrie du conflit change : l’inimitié n’est plus « absolue » comme dans la guerre civile pour la conquête de l’État, mais « illimitée et réactive », asymétrique, car les amis ne se placent pas sur un front opposé à l’ennemi, mais le prennent à revers, par des lignes de fuite.
La violence, enfin, perd son caractère révolutionnaire et novateur pour assumer la forme pré-moderne du jus resistentiae, du droit de résistance, orienté à conserver et protéger les nouvelles formes de vie communautaire et les institutions non étatiques expérimentées pendant l’Exode.
Le
concept de multitude
Virno, en s’inspirant de l’épistémologie de Gaston Bachelard, suggère que le concept de multitude, à l’instar des paradoxes de la mécanique quantique, exige pour être pensé adéquatement une constellation de prédicats philosophiques hétérogènes, empruntés à des auteurs et domaines différents. Il explore la multitude à partir des formes de la subjectivité, en s’appuyant sur quatre prédicats fondamentaux : le principe d’individuation, la biopolitique, les tonalités affectives (opportunisme et cynisme), et enfin la paire heideggérienne bavardage et curiosité, qu’il relit de manière radicale.
Le
principe d’individuation
Le premier et fondamental prédicat est le principe d’individuation. La multitude, entendue comme pluralité s’opposant à l’unité cohésive du peuple, est un réseau d’individus qu’il faut comprendre non comme des points de départ atomistiques, mais comme des points d’arrivée — l’issue d’un processus d’individuation enraciné dans une réalité préindividuelle. Cette réalité préindividuelle, commune, universelle et indifférenciée, se compose de trois strates distinctes.
En premier lieu, il y a le fond biologique de l’espèce, cet appareil perceptif et sensoriel anonyme pour lequel, comme le remarque Merleau-Ponty, on ne dit pas « je vois » mais « il se voit », car la perception précède et demeure étrangère à la vie personnelle. En second lieu, il y a la langue historico-naturelle, qui est à la fois de tous et de personne, et dont l’usage initial est interpsychique et public. À la différence de la perception, qui reste anonyme, la langue est le lieu où le processus d’individuation prend forme, notamment lorsque le locuteur prend conscience du rapport entre sa faculté générique de parler (la puissance de dire) et l’acte énonciatif particulier, définissant ainsi un espace du « propre à moi ».
Enfin, il existe une réalité préindividuelle proprement historique : le rapport de production capitaliste, qui, à l’époque postfordiste, mobilise directement les facultés génériques de l’espèce — perception, langage, mémoire, affects —, autrement dit ce que Marx appelait le Gattungswesen, ou « être/essence générique », objectivée dans le General Intellect.
La réflexion du philosophe Gilbert Simondon fournit les instruments pour approfondir cette articulation. Sa première thèse cruciale est que l’individuation n’est jamais achevée : le sujet n’est pas seulement la partie individualisée, mais le tissage permanent — souvent conflictuel — entre éléments préindividuels (espèce, langue, coopération) et aspects singularisés. Le sujet est donc un « champ de bataille », une entité amphibie suspendue entre le je et le on, où l’harmonie est précaire et où peuvent naître crises, angoisses ou, à l’inverse, la prétention paranoïaque d’un moi qui absorberait tout en lui.
La seconde thèse de Simondon, encore plus décisive, renverse la conception commune du collectif : l’expérience collective n’est pas le lieu où l’individu s’annule, mais le terrain d’une nouvelle et plus radicale individuation. C’est dans le collectif que la part de préindividuel que chacun porte en soi peut, au moins en partie, être à son tour individualisée. C’est ce qui fonde la différence ontologique entre peuple et multitude. Pour la multitude, le collectif n’est ni centripète ni fusionnel ; il ne produit pas une « volonté générale » à déléguer à un souverain. En radicalisant le processus d’individuation, il fonde la possibilité d’une démocratie non représentative, que l’on peut définir comme l’individuation du préindividuel historico-social (science, savoir, coopération). Les « plusieurs » persistent en tant que « plusieurs » parce qu’ils ont déjà derrière eux l’universalité du préindividuel, et parce que leur action collective ne fait qu’accentuer leur singularisation.
Cet enchevêtrement complexe trouve sa synthèse dans le concept marxien d’« individu social » — un oxymore désignant l’individu en qui l’intellect général et l’être/existence générique se manifestent ouvertement à côté du je singulier, exposant leur propre genèse ontologique.
La
biopolitique
Le second prédicat est le concept, souvent équivoque, de biopolitique. Pour en saisir le noyau rationnel, il faut remonter à la notion paradoxale de force de travail. Celle-ci n’est pas le travail effectif, mais la pure puissance de produire, la dynamis qui incorpore « la somme de toutes les aptitudes physiques et intellectuelles ». Sa particularité, comme le souligne Marx, est d’être une marchandise qui, en tant que pure puissance, n’a pas d’existence autonome (« qui dit capacité de travail ne dit pas travail »), et pourtant est achetée et vendue.
Puisque cette puissance est inséparable de la corporéité vivante du vendeur, c’est le corps vivant — le pur bios — qui devient l’objet indirect d’intérêt. Le capitaliste achète la faculté, et pour ce faire, il doit avoir affaire à son substrat vivant. L’origine de la biopolitique foucaldienne doit donc être recherchée dans ce fait premier : l’achat et la vente de la puissance en tant que puissance, qui met en jeu son réceptacle corporel, faisant de la « vie » la cible de stratégies gouvernementales multiples et différenciées. La biopolitique est ainsi l’effet du fait que la dimension potentielle de l’existence (la faculté de parler, de penser, d’agir) devient prépondérante, prenant la forme empirique de la force de travail.
Opportunisme
et cynisme
Le troisième
prédicat analyse les tonalités affectives de la multitude contemporaine,
entendues comme des modes d’être diffus et ambivalents, dotés d’un « noyau
neutre » susceptible de dérives opposées. Dans le postfordisme, on observe une
coïncidence immédiate entre production et éthique : les qualités requises dans
le travail — mobilité, adaptabilité, flexibilité, habitude à ne pas avoir
d’habitudes — ne résultent pas d’une discipline industrielle, mais d’une
socialisation qui se déroule essentiellement hors du travail, dans l’attente
précaire et les chocs métropolitains.
Le nihilisme, autrefois contrepoint de la vie moderne, entre directement dans la production, devenant lui-même un prérequis professionnel. Sur ce fond, deux « mauvais sentiments » prédominent : l’opportunisme et le cynisme.
L’opportunisme structurel est une sensibilité aiguë aux possibilités toujours interchangeables, une familiarité avec le possible en tant que tel, qui devient une ressource technique indispensable dans des processus de travail non plus ordonnés par des finalités univoques, mais par des classes de possibilités équivalentes.
Le cynisme, à son tour, naît de l’expérience directe de la conventionalité et de l’inanité des règles qui structurent les contextes sociaux. Le cynique, ayant démasqué l’arbitraire des règles, les utilise avec parfaite adhérence momentanée mais sans illusion, dans une brutale affirmation de soi. Ce cynisme est étroitement lié à la centralité du General Intellect.
Contrairement à l’argent, qui fonctionnait comme une abstraction réelle fondée sur le principe d’équivalence (et pouvait donc soutenir des idéologies égalitaires), le savoir social, devenu force productive immédiate, n’égalise pas : il sert de prémisse constructive à des actions hétérogènes. La chute du principe d’équivalence se manifeste, chez le cynique, comme l’abandon de l’exigence d’égalité et l’acceptation de la prolifération des hiérarchies. La familiarité avec le possible et la proximité aux règles conventionnelles constituent le « noyau neutre » de cette disposition affective — un mode d’être fondamental qui, bien qu’il se manifeste aujourd’hui sous des formes détériorées, pourrait, en principe, donner lieu à des conflits et à des issues radicalement différentes.
Bavardage
et curiosité
Le quatrième et dernier groupe de prédicats est formé par le bavardage et la curiosité, analysés par Heidegger comme manifestations de la « vie inauthentique » du on anonyme. Contrairement à Heidegger, qui les relègue dans le loisir futile et les oppose au laborieux « prendre soin » du monde-chantier, le bavardage et la curiosité sont vues par Virno comme des attributs centraux de la production contemporaine.
Le bavardage, par son émancipation du paradigme référentialiste (le discours qui n’a pas besoin de refléter la réalité pour être compris) et son caractère performatif et infondé, constitue la matière première du virtuosisme postfordiste. C’est l’agir communicatif informel et flexible, la mobilisation de la langue et de la pure faculté de langage, qui caractérise le travail actuel, au point que l’on pourrait imaginer des panneaux invitant à « Parler ! » pour travailler.
La curiosité, cette « concupiscence de la vue » déjà analysée par Augustin, n’est plus l’éloignement du monde des œuvres. À travers une relecture de Walter Benjamin, la curiosité médiatique et « distraite » est louée comme une nouvelle forme d’apprentissage sensoriel. Les mass media, en satisfaisant cette curiosité vorace, entraînent les sens à considérer le connu comme inconnu (en découvrant des marges de liberté dans l’usuel) et l’inconnu comme familier (en apprivoisant l’imprévu). La distraction, condamnée par Heidegger, devient chez Benjamin l’attitude propre d’un observateur qui, sans l’attention requise par l’apprentissage intellectuel, assimile perceptivement les produits intellectuels et les paradigmes abstraits de la technique.
Multitude
et postfordisme
Dans Grammaire de la multitude, Virno est convaincu que, pour décrire de manière claire le mode de production contemporain — le postfordisme —, il faut recourir à une constellation de catégories issues de la philosophie politique, de l’éthique, de l’épistémologie et de la philosophie du langage. Ce n’est pas un caprice académique, mais une nécessité dictée par la nature même de l’objet étudié : le fait central de cette époque consiste dans l’identification progressive et toujours plus étroite entre poiesis et langage, entre activité productive et communication.
Pour nommer de façon unitaire ce nouveau panorama de formes de vie et de jeux de langage, Virno se réfère au concept de multitude, entendue comme un ensemble de ruptures et d’innovations : la vie d’étrangers comme condition ordinaire, la prévalence des lieux communs du discours sur ceux spécialisés, la publicité de l’intellect comme ressource apotropaïque et pilier de la production, l’activité sans œuvre coïncidant avec la virtuosité, la centralité du principe d’individuation, le rapport au possible en tant que possible (qui se traduit en opportunisme), et enfin le développement hypertrophique des aspects non référentiels du langage, à savoir le bavardage.
Dans cette configuration, la multitude représente la pleine manifestation historique, empirique et phénoménale de la condition ontologique de l’animal humain, mettant à nu sa fragilité biologique, le caractère potentiel et indéfini de son existence, l’absence d’un environnement spécifique, et l’intellect linguistique comme « compensation » à la pauvreté d’instincts spécialisés. C’est comme si la racine ontologique de l’humain était venue à la surface, se montrant à découvert.
Autrement dit, la multitude est la configuration biologique fondamentale devenue un mode d’être historiquement déterminé, une ontologie qui se révèle phénoméniquement. Le capitalisme contemporain trouve sa ressource productive principale dans les aptitudes linguistico-relationnelles et dans l’ensemble des facultés communicatives et cognitives qui distinguent l’être humain.
Pour
pénétrer cette réalité complexe, Virno avance dix thèses qui, bien que
formulées de manière concise, ne prétendent pas à l’exhaustivité.
1. Première
thèse. Le
postfordisme débute historiquement en Italie avec les luttes sociales connues
sous le nom de mouvement de 1977. Ce mouvement exprima une force de travail
scolarisée, précaire et mobile, qui s’opposa frontalement à l’éthique du
travail et à la culture de la gauche historique, marquant une discontinuité
nette avec la figure de l’ouvrier fordiste. Ce qui apparut alors comme un
conflit marginal fut en réalité l’anticipation du nouveau centre du
développement capitaliste. Le chef-d’œuvre du capitalisme italien fut de
convertir ces propensions collectives conflictuelles — l’exode de l’usine, le
désamour du poste fixe, la familiarité avec les savoirs et les réseaux
communicatifs — en un nouveau concept de professionnalité fondé sur
l’opportunisme, le bavardage et la virtuosité.
2. Deuxième
thèse. Le
postfordisme réalise empiriquement le Fragment sur les machines de Marx.
Dans ce texte, Marx préfigure une situation où le savoir abstrait, la science,
le General Intellect, deviennent la principale force productive,
réduisant le travail immédiat à une « base misérable » et minant à la racine la
loi de la valeur. Ce que Marx décrivait comme la prémisse d’un dépassement
révolutionnaire du capitalisme s’est réalisé pleinement à l’intérieur même des
rapports de production capitalistes, donnant naissance à de nouvelles formes
stables de domination.
3. Troisième
thèse. La
crise de la société du travail ne correspond pas à une simple réduction
quantitative du temps de travail, mais au fait que la richesse sociale est
désormais produite par le General Intellect et la coopération sociale,
tandis que le temps de travail continue d’être la mesure officielle, bien
qu’elle ne soit plus véridique.
4. Quatrième
thèse.
Pour la multitude postfordiste, il n’existe plus de différence qualitative
entre temps de travail et temps de non-travail. L’intellect, la « vie de
l’esprit », est pleinement intégré au processus productif. En découle un
paradoxe : on peut affirmer à la fois qu’on ne cesse jamais de travailler et
qu’on travaille toujours moins.
5. Cinquième
thèse. Il
faut distinguer, suivant Marx, le temps de travail du temps de production. Dans
le postfordisme, l’écart entre les deux s’élargit : le temps de production
inclut la coopération sociale et la productivité de la vie elle-même. Le
surtravail se tire non seulement de la journée de travail, mais de cet écart
non rémunéré.
6. Sixième
thèse. Le
postfordisme est caractérisé par une mosaïque de modèles productifs. À côté de
secteurs avancés, persistent des modèles archaïques, en une sorte d’Exposition
universelle de l’histoire du travail. Ce qui unit le technicien logiciel et
l’ouvrier à la chaîne, ce n’est pas la tâche, mais un ethos commun fait
d’opportunisme et de bavardage.
7. Septième
thèse. Le
General Intellect ne se limite plus au capital fixe : il se manifeste
surtout comme attribut du travail vivant, comme interaction linguistique et
coopération humaine. Dans cette fabrique loquace, le travail est
interaction, rendant obsolètes les dichotomies habermassiennes entre agir
instrumental et agir communicationnel.
8. Huitième
thèse.
L’ensemble de la force de travail postfordiste constitue une intellectualité
de masse. Le travailleur ordinaire, en tant qu’être parlant, mobilise dans
son activité les facultés cognitives les plus générales : apprendre, abstraire,
mémoriser, communiquer.
9. Neuvième
thèse. La
théorie de la prolétarisation est dépassée. Tout travail postfordiste est
complexe, non par addition quantitative, mais par qualité coopérative et
linguistique. La multitude n’est pas un peuple homogène par soustraction, mais
un ensemble de singularités dont la richesse productive échappe aux catégories
de l’économie politique.
10.
Dixième thèse. Le postfordisme est le communisme
du capital. Comme le fordisme fut un « socialisme du capital » après la
crise de 1929, le postfordisme est la réponse capitaliste à la révolution
vaincue des années 1960–1970, qui avait attaqué le salariat et la forme-État
elle-même. Le capital a orchestré à son profit les mêmes exigences communistes
— abolition du travail, dissolution de l’État, valorisation des différences —
en les retournant en leur contraire : précarité au lieu de libération,
fragmentation étatique au lieu de disparition, fétichisme des différences
générant de nouvelles hiérarchies.
Le
postfordisme est, en définitive, un communisme réalisé par et pour le
capital.