Michael Gorra, The New York Review of Books, 22/12/2022
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
Dans ce qui pourrait être ses deux derniers romans, Cormac McCarthy a assemblé une chronique familiale à partir de fragments, qui présente, pour la première fois dans son œuvre, des personnages ayant une vie intérieure et un passé significatif.
Ouvrages recensés :
The
Passenger
by Cormac McCarthy
Knopf, 383 pp., $30.00
(à
paraître en français aux éditions de l’Olivier en mars 2023)
Stella Maris
by Cormac McCarthy
Knopf, 190 pp.,
$26.00
(à
paraître en français aux éditions de l’Olivier en mai 2023)
Aucun lecteur habitué de Cormac McCarthy ne sera surpris d’apprendre que The Passenger commence par un cadavre. Ou plutôt deux cadavres, dont l’un a disparu. Celui que nous voyons, dans le prologue en italique d’une seule page qui ouvre le livre, est celui d’une jeune fille aux cheveux dorés et gelés, retrouvée pendue « parmi les poteaux gris et dénudés des arbres d’hiver ». Elle s’appelle Alicia Western, et elle est vêtue de blanc, avec une ceinture rouge qui la rend facilement repérable contre la neige, un « peu de couleur dans la désolation scrupuleuse ». C’est Noël 1972, dans une forêt proche du sanatorium du Wisconsin où la jeune femme de vingt ans s’est enregistrée, un endroit où elle est déjà allée.
Cormac McCarthy ; illustration de Harriet Lee-Merrion
C’est une prodige des mathématiques, fille d’un homme qui a travaillé sur le Projet Manhattan, mais elle est aussi visitée depuis l’âge de douze ans par une apparition qu’elle appelle le Kid de la Thalidomide, une silhouette d’un mètre de haut, avec des nageoires à la place des mains, qui n’est ni un rêve ni une hallucination mais “cohérente dans chaque détail”. Le Kid la surveille souvent, lui parle, la taquine et la pousse à bout, et connaît ses moindres pensées et faiblesses. Elle comprend qu’il n’est pas réel, mais elle croit aussi en son existence séparée, un être “petit, frêle et courageux... [et] honteux” du spectacle de son corps. Mais il ne lui rend pas visite seul. D’habitude, il amène des amis, ceux qu’Alicia appelle ses “amuseurs”, un vieil homme dans un manteau “marteau-piqueur”, par exemple, ou “une paire de nains assortis”. Ses médecins l’ont diagnostiquée comme schizophrène paranoïaque, certains pensent qu’elle est autiste, et selon un test de personnalité, elle est une “déviante sociopathe”. Aucune de ces étiquettes ne colle.
Et puis il y a le corps que l’on ne voit pas, celui qui aurait dû être retrouvé dans un jet privé à quarante pieds de profondeur dans le Golfe du Mexique. Nous sommes en 1980, et le frère aîné d’Alicia, Bobby, qui a décroché de Caltech [Institut californien d Technologie] et ancien pilote de course, travaille comme plongeur sauveteur à la Nouvelle-Orléans. Lui et sa partenaire ont été engagés pour enquêter sur le crash. Ils ouvrent la porte de l’avion et nagent lentement à l’intérieur, “les visages des morts à quelques centimètres”, leurs cheveux flottant avec leurs tasses de café vers le plafond. Le pilote et le copilote plus sept passagers en combinaison, et il ne faut pas longtemps à Bobby pour se rendre compte qu’il manque quelques éléments. Pas de sac de vol du pilote, pas de boîte noire, et le panneau de navigation a été retiré du tableau de bord. Leur entreprise sera payée par un mandat postal intraçable, mais plus tard dans la journée, Bobby trouve deux hommes avec des badges devant son appartement. Sept passagers, demandent-ils ? Vous êtes sûr ? Parce que le manifeste en indique huit, et les questions des agents confirment ses soupçons. Le loquet de la porte de l’avion était peut-être intact avant que le chalumeau de son partenaire ne l’ouvre, mais quelqu’un d’autre, quelqu’un de vivant, est entré et sorti avant eux de ce jet coulé.
Nous n’apprendrons jamais qui était ce passager, ni ce qui a provoqué la chute de l’avion. J’admets avoir une curiosité insatisfaite à ce sujet, mais il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre que ni Bobby ni moi n’obtiendrions de réponses. Le passager manquant, le huitième homme, est un MacGuffin, et il n’est pas le passager auquel le titre fait référence. C’est Bobby. Les deux mots n’ont pas d’étymologie commune, mais un passager est essentiellement passif. Un passager se laisse porter, il ne contrôle pas la destination, il ne conduit pas, ne dirige pas et ne décide pas. Et Bobby ne conduit plus, même s’il possède toujours une Maserati qu’il conduit parfois sur la route. C’est fini depuis qu’il a écrasé sa Lotus lors d’une course de Formule 2 et qu’il est tombé dans le coma, depuis qu’il en est sorti pour découvrir que sa sœur était morte.
Maintenant il plonge. L’argent est bon et l’adrénaline aussi ; comme Alicia le dit à son psy, Bobby n’a jamais eu peur des hauteurs ou de la vitesse, mais des profondeurs, oh oui. Alors il plonge et il boit, une vie de Quartier français sans forme au-delà du moment présent, jusqu’à ce que l’avion s’écrase et qu’il commence à attendre ce qui va arriver. C’est là que les surprises commencent. Les cadavres vous saisissent, mais il y a bien d’autres choses qui vous retiennent : une histoire familiale troublée d’une part et un drame formel compliqué, enveloppant et exaltant d’autre part.
Jusqu’à présent, j’ai présenté la nouvelle œuvre de McCarthy comme s’il s’agissait d’un seul récit, allant de la mort d’Alicia à la vie actuelle de Bobby, lorsque les questions de ces agents le poussent finalement à quitter la ville pour vivre en dehors de ce qu’on n’appelait pas encore le réseau. McCarthy a cependant publié deux livres cet automne, The Passenger à la fin du mois d’octobre et Stella Maris au début du mois de décembre, et certaines des citations ci-dessus proviennent de ce dernier, qui porte le nom de l’hôpital psychiatrique où Alicia va mourir. Les deux livres sont aussi intimement liés que, eh bien, le frère et la sœur. Et aussi différents. Ils s’éclairent l’un l’autre, et pourtant la relation entre eux n’est pas plus facile à définir que celle entre des personnes qui respirent.
The Passenger est vaste, apparemment axé sur l’intrigue, mais aussi étrangement et agréablement digressif, plein de conversations de Bobby avec ses amis, l’un d’entre eux étant un transsexuel nommé Debussy Fields qui est à la tête d’un spectacle de travestis tout en économisant pour son opération, et un autre un détective privé ayant des idées bizarres sur les Kennedy. Stella Maris est beaucoup plus rigoureusement structuré et, après sa première page, entièrement dialogué : il s’agit de la transcription des séances électrisantes d’Alicia avec son dernier psychiatre, le Dr Cohen. Le livre ne la suit pas dans la neige, mais nous savons toujours que c’est là qu’elle va ; nous ne pouvons pas oublier, même au début, qu’elle est déjà morte depuis presque quatre cents pages.
Je suppose que vous pouvez lire l’un sans l’autre, The Passenger en particulier. Mais je ne peux pas imaginer que quelqu’un qui termine ce livre ne veuille pas continuer. Chacun d’eux offre des bribes différentes de l’histoire familiale, un détail dans l’un donnant un sens à un moment dans l’autre, comme s’ils s’infiltraient mutuellement. Alicia raconte tout du Kid à son psychiatre, mais le personnage lui-même n’apparaît que dans The Passenger, dans une série d’interchapitres en italique et d’une sinistre drôlerie qui brisent le flux de son récit central. Stella Maris offre un récit plus complet de l’accident de course de Bobby. Après qu’il a passé quelques mois inconscient, les médecins essaient de convaincre Alicia de le débrancher ; elle refuse même si elle ne croit pas qu’il va vivre. Chaque livre permet de mieux comprendre l’autre, tout comme le fait de rencontrer de vrais frères et sœurs ; ils ont été conçus en tandem et sont tout au plus semi-détachés.
Néanmoins, je pense qu’il faut commencer par The Passenger. Il soulève des questions que Stella Maris nous aide à comprendre, et bien que ce volume plus court n’y réponde pas précisément, le lire d’abord semblerait préventif. Pourtant, il ne s’agit en aucun cas d’une suite, et pas seulement parce que les dernières séances d’Alicia se déroulent avant les années 1980 de l’autre. En fait, Stella Maris pourrait même prendre le dessus, en tant que partenaire dominant de cette paire codépendante. McCarthy a apparemment livré une ébauche de ce livre il y a huit ans, alors que The Passenger était encore en morceaux, et un article du New York Times note que ses éditeurs ont eu un débat animé sur la manière de “conditionner” l’œuvre. Un seul volume ou deux ? Ils ont fait le bon choix.1
Chaque livre regorge d’incidents et de personnages, mais aucun d’entre eux ne nous présente une histoire linéaire dans laquelle le présent défile vers l’avenir. Au contraire, plus on avance, plus on tombe dans le passé, dans une chronique familiale assemblée à partir de fragments, qui s’étend sur plusieurs générations. Il y a une grand-mère maternelle qui vit encore à l’extérieur de Knoxville, où McCarthy lui-même a grandi ; elle est mystifiée par le monde dans lequel vivent ses petits-enfants et s’interroge encore aujourd’hui sur les accidents qui ont permis à sa fille d’obtenir un emploi à Oak Ridge pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a le scientifique de Princeton qui l’a épousée, un ami d’Oppenheimer et de Feynman, qui refuse de se sentir coupable d’Hiroshima. Los Alamos, une épave d’avion dans les bois du Tennessee, des violons Cremona, et la cave de l’autre grand-mère de Bobby dans l’Ohio, où il trouve une fortune en or. Le travail d’Alicia en topologie et sa théologie privée fondée sur le nombre, le singulier. Des noms, beaucoup de noms, de grands physiciens et mathématiciens, tous réels, ainsi que des pages poignantes dans lesquelles elle décrit ce que ce serait de se noyer dans le lac Tahoe, où l’eau est si froide qu’elle est « probablement capable de vous garder en vie pendant une période de temps inconnue. Des heures peut-être, noyé ou non », alors que vous descendez lentement vers le fond. Les souvenirs du Vietnam d’un autre plongeur, une plate-forme pétrolière apparemment abandonnée, puis les chambres miteuses où Alicia attend le Kid, qui ne cesse de faire des jeux de mots : « Un de plus », lui dit-il, « dans une longue histoire de locaux mal entretenus..... La maladie persiste ».
Une partie de cette histoire apparaît en flash-back. Bobby, assis à la Nouvelle-Orléans, lit les lettres de sa sœur et se souvient d’un enterrement familial et de la maison d’enfance de son père à Akron, celle avec l’or. La plupart de ces souvenirs apparaissent dans les dialogues. Alicia a ses amuseurs et Bobby ses consolateurs, les amis qui le bombardent de questions. Le plus important est John Sheddan, un escroc spécialisé dans les fausses ordonnances. Il dit à Bobby que « ta vie intérieure est une sorte de passe-temps pour moi », et aussi que « chaque conversation porte sur le passé ». Chaque question tente de découvrir ce que personne ne veut dire, et avec les frères et sœurs de l’Ouest, un seul sujet préoccupe tout le monde. Sheddan raconte à un compagnon de beuverie que Bobby est amoureux de sa sœur décédée, et le Kid suggère qu’Alicia va se suicider parce qu’elle pense qu’il ne se réveillera jamais de son coma - qu’elle ne peut pas survivre sans la seule personne qui rend sa vie un tant soit peu supportable.
Mais ce n’est pas tout. « On peut faire ce qu’on veut », dit Alicia à Bobby dans The Passenger, et il répond : « Non..... On ne peut pas ». Le Quentin Compson de Faulkner veut coucher avec sa sœur Caddy, être pour toujours ensemble et seul avec elle dans un endroit muré par les flammes ; il ne lui demande pas seulement parce qu’il a peur qu’elle dise oui. C’est Alicia qui le propose, persuadée qu’elle et son frère sont déjà tout l’un pour l’autre, un monde et une loi à eux seuls. Bobby le croit aussi, mais il est plus âgé et s’en empêche. Ce désir partagé est présent dès les premières pages de The Passenger, un sentiment de ce qui doit rester inexprimé. Stella Maris le dit, cependant, et montre clairement à quel point il a façonné leurs vies - un désir qui s’arrête juste avant l’inceste, une consommation qui ne se produit pas sur la page mais dans la relation entre ces deux livres.
Rien de tout cela ne ressemble beaucoup à McCarthy. Si Bobby et Alicia traînent une histoire derrière eux, alors lui aussi. Je ne parle pas de biographie - l’histoire qui compte ici est celle de ses dix premiers romans, à commencer par The Orchard Keeper (1965). Il est aujourd’hui dans sa quatre-vingt-dixième année, et ces nouveaux livres, ses premiers depuis The Road (2006), qui a reçu le prix Pulitzer, sont selon toute vraisemblance ses derniers. Pourtant, s’ils sont bien de lui, ils ne distillent pas ses réalisations antérieures, comme le font si souvent les œuvres tardives. Ils les étendent. Oh, bien sûr, les corps, il a toujours besoin de corps. Knoxville, par exemple, et la description des saloons de cette ville dans Suttree (1979) trouve une réponse dans le récit de The Passenger sur la Nouvelle-Orléans. L’inceste : d’accord, un frère et une sœur figuraient dans Outer Dark (1968), et cela allait beaucoup plus loin qu’ici.
Mais permettez-moi d’utiliser ce premier roman pour montrer à quel point son œuvre a changé depuis un demi-siècle. McCarthy a situé ce livre terriblement effrayant dans un désert hobbesien. Il s’agit clairement du Sud usaméricain, mais il ne précise jamais l’époque ou le lieu de l’action : un pays marqué non seulement par l’inceste, mais aussi par l’infanticide, l’éviscération et le lynchage. Sa narration est à la fois décousue et entièrement linéaire, passant sans cesse d’un personnage à l’autre, mais sans nous laisser entrevoir leur vie intérieure ni tenter de définir leurs motivations. Les événements se succèdent, et c’est tout, comme si, dans ce monde en ruine, la pensée et les sentiments n’avaient aucune importance.
Et ainsi de suite, livre après livre, les personnages de McCarthy se distinguant par deux choses : une absence totale d’intériorité et aussi de passé significatif. Nous n’apprenons rien sur Anton Chigurh, la sombre star de No Country for Old Men (2005), si ce n’est par la façon dont il se déplace, agit et tue. Le juge Holden, dans Blood Meridian (1985), parle suffisamment pour que nous sachions qu’il croit que la mort est le lot du monde et que le monde appartient à ceux qui sont les plus disposés à l’affronter. De sa vie antérieure - quelles que soient les forces qui l’ont façonnée - nous n’apprenons que ce que disent les autres personnages. Il est vrai que nous connaissons le passé de John Grady Cole dans Cities of the Plain (1998), le dernier volume de ce qu’on appelle La trilogie des confins, ou du moins si nous avons déjà lu All the Pretty Horses (1992). Non pas qu’il y pense, car ce qui compte, c’est ce qu’il peut faire avec un cheval ou une corde, la connaissance pratique et taciturne de la main et de l’œil. Il s’approche d’un cheval « et s’appuie sur son épaule, soulève sa patte avant entre ses genoux et examine le sabot. Il passait son pouce autour de la fourchette et il examinait la paroi du sabot ». Pourtant, nous ne savons ce qu’il voit là que grâce à ce qu’il fait ensuite, comme si l’action révélait la pensée. Ou plutôt la supplante.
Même dans La Route, McCarthy n’offre que quelques phrases sur la vie antérieure de ses personnages anonymes, celle qu’ils avaient avant que le désastre ne s’abatte sur leur monde. Ce temps disparu a nécessairement mis en mouvement celui-là, il a créé la terre cendreuse qu’ils traversent. Mais ce qui compte, c’est la pierre du présent, qui roule toujours vers l’avant. C’est une décision esthétique, une déclaration sur ce qui compte dans ses pages ; c’est aussi, inévitablement, un choix éthique.
The Passenger et Stella Maris sont différents, et le plaisir de les lire vient en grande partie du fait de voir McCarthy faire quelque chose de nouveau. Je n’arrive pas à imaginer un personnage de l’un de ses premiers romans affirmant que « chaque conversation porte sur le passé ». Il est vrai qu’une grande partie de ce que nous apprenons sur les histoires partagées et séparées des westerns, sur les contours de leurs vies intérieures, ne vient pas d’une conscience dramatisée mais de la forme même de la conversation. Bobby est assis avec le détective Kline dans le Tujague’s de Decatur Street à la Nouvelle-Orléans et le regarde
faire bouger la glace dans son verre. Vous vous voyez comme une figure tragique.
Non, je ne le suis pas. Pas du tout. Une figure tragique est une personne de conséquence.
Ce que vous n’êtes pas.
Une personne de mauvaise réputation. Peut-être. Je sais que ça semble stupide. Mais la vérité est que j’ai laissé tomber tous ceux qui sont venus me demander de l’aide. Qui ont cherché mon amitié.
McCarthy n’a jamais utilisé de guillemets ni rien qui ressemble au conventionnel « dit-il », et il faut parfois revenir en arrière pour voir qui parle. Mais la parole force Bobby et Alicia à des moments d’introspection, et les pousse parfois dans la mémoire. Le mot parlé devient une synecdoque pour la vie intérieure, l’intériorité non représentée mais toujours ressentie qui se trouve juste à côté de la page, et la présence narrative du passé ne fait plus qu’un avec la conscience elle-même. Quant à savoir pourquoi ces livres sont différents, pourquoi McCarthy a décidé d’essayer quelque chose de nouveau, je ne peux que spéculer. Je soupçonne que cela a à voir avec Alicia, que sa présence centrale lui a fait changer les choses. Les femmes de McCarthy ont généralement été la partie faible de son œuvre. Ni The Road ni Blood Meridian n’ont un seul personnage féminin significatif, et celles de La Trilogie des confins ne sont guère plus que des stéréotypes. Seule Rinthy Holme, dans Outer Dark, joue un rôle important, mais elle n’est pas à la hauteur de l’imagination d’Alicia, qui semble avoir abordé ces nouveaux livres avec le sentiment d’avoir laissé quelque chose en suspens. « J’avais prévu d’écrire sur une femme pendant 50 ans », a-t-il déclaré dans une interview en 2009, et même si « je ne serai jamais assez compétent pour le faire... à un moment donné, il faut essayer »2.
Outer Dark s’est mal vendu, comme tous les premiers romans de McCarthy. Leur violence lui a probablement coûté quelques lecteurs, tout comme ses choix esthétiques aux principes étranges. Mais il y a plus. Flannery O’Connor a dit à propos de l’écriture dans l’ombre de Faulkner que « personne ne veut que sa mule et son chariot s’arrêtent sur la même voie que le Dixie Limited ». McCarthy a pourtant calé, et en ouvrant Outer Dark au hasard, j’ai trouvé la description d’une vieille femme « se déplaçant dans une aura de musc léger, l’odeur poussiéreuse d’une chair féminine âgée imperméable à la saleté comme la pierre ou l’argile ». Ou, comme le dit Faulkner au début d’Absalom, Absalom, « l’odeur fétide d’une vieille chair féminine longtemps attachée à sa virginité ». McCarthy a repris à la fois les adjectifs empilés et l’odeur de misogynie de son prédécesseur, et des morceaux d’intrigue également, ainsi que le parrainage d’Albert Erskine, l’éditeur de Faulkner chez Random House.
Pourtant, il y a quelque chose d’autre qui se passe dans ces premières pages, quelque chose de puissant. Il ne joue aucun des tours libérateurs agités du Mississippien avec le temps et le point de vue, et ne partage pas l’intérêt de Faulkner pour l’histoire de sa région. Mais il est bien plus implacable. Son monde semble dépourvu d’émotions, la vie de ses personnages n’est soulagée d’aucune trace de rire ou de générosité, d’un sentiment de solidarité et d’une société civile qui subsistent même dans les livres les plus sombres de Faulkner. Pour certains lecteurs, c’est un attrait.
McCarthy a publié régulièrement, mais avec peu de ventes et une réticence à enseigner, il a survécu pendant des années grâce à des subventions de fondations, dont l’un des premiers prix « pour génies » de MacArthur. De nombreux membres de ce groupe inaugural de 1981 avaient déjà des travaux importants à leur actif. Dans son cas, la fondation a parié sur l’avenir d’un homme approchant la cinquantaine et a dû se demander, au début, si son pari serait payant. En 1976, McCarthy a quitté le Tennessee pour s’installer dans l’ouest du Texas et, en écrivant sur ce nouveau paysage, il a trouvé une profondeur historique qui manquait à ses œuvres précédentes. Blood Meridian, son cinquième roman, est paru en 1985 et figure aujourd’hui en bonne place sur la liste des principaux romans usaméricains de cette décennie, n’étant égalé que par White Noise [de Don DeLillo] et Beloved [de Tom Morrison]. Mais à l’époque ? Il n’a pas été chroniqué dans ces pages, et le New York Times a enterré sa critique à la page 31 de la section livres du dimanche. Beaucoup de ceux qui l’ont lu ont été rebutés par son insistance à dire que la violence est la condition essentielle de la vie usaméricaine. C’était une chose de lire l’affirmation de D.H. Lawrence, dans Studies in Classic American Literature, selon laquelle « l’âme américaine essentielle est dure, isolée, stoïque et tueuse ». C’en est une autre de lire un récit du Vieil Ouest dans lequel un groupe de cavaliers anglophones, engagés pour tuer des Apaches, scalperont tous ceux qu’ils rencontreront pour toucher la prime.
Leur chef pointe son pistolet sur la tête d’une vieille femme, puis demande à l’un de ses hommes de recueillir le “reçu”, en tournant le « trophée dégoulinant... au soleil comme un homme qualifierait la peau d’un animal ». Qualifier - c’est un bon mot, surprenant mais juste, le scalp valant 100 dollars. Les cavaliers chevauchent à travers le désert, ils chevauchent sans destination ni but, et sont retenus un jour au crépuscule par la vue d’une « ville lointaine très blanche contre les collines bleues et ombragées », pour trouver au matin une plaine stérile devant eux. Ils chevauchent et tuent, se déplaçant sur un « lit de lac de lave tout craquelé et noir rougeâtre comme une casserole de sang séché », tuant non seulement parce qu’ils le peuvent mais aussi parce que c’est la seule chose qu’ils savent faire.
La langue de McCarthy a toute la richesse de la Bible du roi Jacques, ses cadences lentes et toujours belles et toujours en désaccord avec le monde qu’elle décrit. C’est une vision de l’Ouest usaméricain bien plus vraisemblable que tout ce que John Ford a jamais porté à l’écran, mais bien que la littérature critique à son sujet soit désormais énorme, Blood Meridian s’est vendu à moins de 1 500 exemplaires lors de sa première publication. Le tirage initial annoncé pour chacun de ces nouveaux livres est de 300 000 exemplaires. Il s’est manifestement passé quelque chose entre-temps.
Ou plutôt deux choses, sans compter Oprah, et les films, et les prix - deux choses internes à l’œuvre elle-même. La première est que McCarthy a brûlé non seulement la faulknerité mais aussi presque toute la grandiloquence de sa prose, ou du moins la grandiloquence telle qu’elle est définie conventionnellement. Blood Meridian est une couronne de joyaux. Chacune de ses phrases semble inévitable, et les outils de sa fabrication sont entièrement à sa disposition.
Par la suite, McCarthy a trouvé une nouvelle cadence et, à partir de All the Pretty Horses, son langage a commencé à rappeler celui d’Hemingway. Ses rythmes sont restés bibliques, mais ses phrases sont devenues fluides et dépouillées, les bavures ayant disparu de leurs surfaces bien usinées. Il n’avait jamais aimé les points-virgules, mais dans ses dernières œuvres, même les virgules sont rares, et les phrases complexes presque inexistantes. Au lieu de cela, il lie généralement une série de clauses indépendantes, souvent courtes : « La journée était chaude, ils ont lavé leurs chemises et les ont enfilées humides, puis ils sont montés et ont continué à rouler ». Parfois, il y a un inventaire, les « burros, trois ou quatre en tandem, attelés à des charges de candelilla, de fourrures, de peaux de chèvre ou d'enroulements de cordes artisanales fabriquées à partir de lechugilla ou de la boisson fermentée appelée sotol », mais son attention est presque toujours sur les processus des hommes au travail, dans lequel une chose ne peut s’empêcher de suivre une autre. Cette prose est laconique, maniérée et, à sa manière, aussi extravagante que tout ce qu’il avait écrit auparavant, avec une absence presque ostentatoire d’ornement. Pourtant, son registre évoque non seulement Hemingway, mais aussi le monde dur à cuire d’une grande partie de la fiction populaire usaméricaine, et All the Pretty Horses devient son premier best-seller.
La deuxième chose était encore plus radicale. Je ne pense pas que McCarthy ait jamais changé sa vision punitive de la vie humaine. Il est encore hobbesien, avec le monde vu comme une guerre de tous contre tous, et comme le dit le juge dans Blood Meridian, « Peu importe ce que les hommes pensent de la guerre..... La guerre perdure. Autant demander aux hommes ce qu’ils pensent de la pierre ». La vie se joue à pile ou face, mais c’est toujours le tueur qui décide et le tirage au sort est toujours truqué. Pourtant, après Blood Meridian, McCarthy a commencé à imaginer une série de protagonistes sympathiques, pas seulement les piliers de bar amusants et loquaces de Suttree, mais des personnages dont la probité les rend admirables. Ils sont les exceptions dans leur société, les figures par lesquelles nous la jugeons : John Grady Cole et Billy Parham dans La Trilogie des confins, le shérif dans No Country for Old Men, le père et le fils dans The Road, portant la flamme de ce qu’ils espèrent être un avenir. Ils donnent au lecteur quelque chose à quoi s’accrocher, et pourtant, ce faisant, ils soulignent aussi l’étrange pureté de Blood Meridian, dans lequel la croyance et le nihilisme ne font qu’un. McCarthy n’avait pas besoin de répéter ce livre, mais sa position critique actuelle repose paradoxalement sur le succès commercial de ses livres ultérieurs, apparemment plus faciles, et l’a peut-être exigé.
Alicia Western a toujours su qu’une force maléfique se trouvait au-delà de notre existence habituelle, elle a senti une présence à laquelle le reste d’entre nous est insensible. Enfant, elle a entrevu la terreur elle-même, et le Gamin de la Thalidomide prétend que c’est la raison pour laquelle elle est si troublée ; n’importe qui ayant vu une telle chose serait troublé, tout comme n’importe qui capable de l’imaginer :
Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois me souvenir d’une jeune fille sur la pointe des pieds qui jetait un coup d’œil à travers une haute ouverture rarement mentionnée dans les archives. Qu’a-t-elle vu ? Une silhouette à la porte ? Mais ce n’est pas la question, n’est-ce pas ? La question est : est-ce qu’il l’a vue ?
Le mal du monde se donnerait-il la peine de tenir compte d’un être aussi petit et curieux ? Bien sûr que oui : le juge Holden a sa série de petites victimes, après tout. Les paroles du Kid sont prononcées au tout début de The Passenger, et la première fois que je les ai lues, elles m’ont semblé n’être qu’un bavardage, faisant partie d’une série de mots délibérément ennuyeux. Mais rien ici n’est sans importance, et Alicia revient à cette idée dans Stella Maris. Elle raconte à sa psy qu’elle a fait un jour un rêve éveillé qui « n’était ni éveillé ni un rêve », un aperçu d’un royaume inconnu « où des sentinelles se tenaient devant une porte et je savais qu’au-delà de la porte se trouvait quelque chose de terrible et que cela avait un pouvoir sur moi ». Tous nos désirs d’abri et de communauté ne sont qu’une tentative d’ « échapper à cette chose maléfique » dont nous avons peur et dont nous ne pouvons pourtant pas avoir une connaissance directe. Ces sentinelles l’ont repoussée, loin de ce que personne ne devrait voir, mais si elle n’a trouvé la porte qu’une seule fois, cela ne signifie pas que sa vision était fausse. Elle a même donné un nom à cette force : l’Archatron, un mot lovecraftien inventé par McCarthy lui-même3.
Ce sentiment d’une force maligne mais impersonnelle à l’œuvre dans le monde fait que le fait que le père d’Alicia ait travaillé sur le Projet Manhattan est plus qu’une simple anecdote ; il était présent sur le site de Trinity, lorsque, dans la lumière d’un millier de soleils, Oppenheimer a pensé à une ligne de la Bhagavad Gita : « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Le Juge lui-même n’aurait pas pu mieux dire, et à présent Alicia a une idée de la façon dont l’Archatron fonctionne et d’où vient sa méchanceté. « Je pense qu’il faut avoir le langage pour avoir la folie », dit-elle au Dr Cohen, et elle ajoute que « l’arrivée du langage a été comme l’invasion d’un système parasitaire ». Parce que le langage est utile, il s’est répandu comme une épidémie dans toutes les poches de la vie humaine primitive, et à son cœur se trouvait l’idée qu’une chose pouvait en représenter une autre. Mais il « n’a évolué à partir d’aucun besoin connu » et son énorme pouvoir perturbateur était « à la mesure de sa valeur. La destruction créative. Toutes sortes de talents et de compétences ont dû être perdus... [remplaçant] au moins une partie du monde par ce qui peut en être dit ».
McCarthy a repris ces idées dans un bref essai de 2017, après avoir terminé une ébauche de Stella Maris4.
Il ne fait guère de doute qu’Alicia parle ici en son nom, que sa morosité est la sienne. Le langage est une force manichéenne, il nous fait et nous détruit à la fois, et d’où qu’il vienne, le fait que nous l’ayons appris est une chute loin d’être heureuse. L’essai a été publié dans le magazine scientifique Nautilus, et son argument est issu des conversations de McCarthy avec les membres de l’Institut Santa Fe, un groupe de réflexion multidisciplinaire auquel il est associé depuis longtemps. Il n’accorde presque jamais d’interviews, mais chaque fois qu’il le fait, il note les provocations et le plaisir qu’il y a à parler avec les physiciens et les mathématiciens de l’institut.
Alicia Western est inconcevable sans ces entretiens. Ou non : ce qui en ressort, ce sont les détails des choses qu’elle dit, les théories et les noms, sa conviction que les mathématiques ne sont « que de la sueur et du travail » et pourtant aussi « une initiative fondée sur la foi ». Mais les idées de Stella Maris sont passionnantes parce qu’elles sont les siennes, parce qu’elles sont ancrées dans le drame et la lutte de sa vie. Elle semble les découvrir au fur et à mesure qu’elle parle, pensant à haute voix pendant que le Dr Cohen essaie de suivre. Ce sont des déclarations sur le moi, et elles s’imposent sur la page même si - ou précisément parce que - elles ne suffiront pas à la sauver. Les mêmes idées dans la voix d’essai de McCarthy sont inertes en comparaison, le produit et non le processus de la pensée.
Aucune œuvre de fiction longue et complexe n’est parfaite. The Passenger pourrait être plus serré. Le dialogue de McCarthy est toujours propulsif, et pourtant certaines des rencontres de Bobby en Louisiane n’ont aucun but narratif réel : elles sont intéressantes sur le moment, mais c’est tout. De plus, je ne suis pas certain de la nécessité thématique de l’inceste, du désir menacé, promis ou repoussé entre le frère et la sœur. Cela renforce leur lien émotionnel ; cela explique pourquoi la conviction d’Alicia que Bobby ne sortira pas du coma est ce qui la pousse à bout, pourquoi aussi il reste un passager dans sa propre vie. Pourtant, certains liens non sexuels entre frères et sœurs ne sont-ils pas si étroits que leur perte peut conduire au désespoir ? Peut-être que c’est juste ma propre sensiblerie. C’est ce qu’Alicia elle-même soutiendrait, et à la lecture, il est difficile de la rejeter. Parce que je crois en cet amour. Je crois que c’est vrai pour ces personnages particuliers ; je le crois quand elle dit que « le fait que ce n’était pas acceptable n’était pas vraiment notre problème ».
Quand les hommes avec des badges commencent à devenir gênants, Bobby décide qu’il doit cacher les lettres de sa sœur. Même le coffre-fort où il les garde pourrait ne pas être assez sûr. Il les a lues si souvent qu’il les connaît par cœur, toutes sauf la dernière, celle qu’il n’a jamais ouverte. On ne nous dit pas grand-chose à ce sujet, mais dans les premières pages de The Passenger, le Kid demande à Alicia si elle va laisser un mot, et elle lui répond qu’elle est en train « d’écrire une lettre à mon frère », une lettre adressée à un homme qui, selon elle, était déjà mort. Elle était elle-même morte lorsque Bobby est sorti du coma, et lorsqu’il rend visite à l’hôpital du Wisconsin, personne ne veut lui raconter les détails de ses derniers jours. Il n’y a certainement pas de Dr Cohen à qui parler, et Bobby n’en apprend jamais autant que nous sur sa mort. À la fin de The Passenger, il remet la lettre à son ami·e Debussy et lui demande de la lire pour lui. Il quitte la pièce pendant qu’ielle le fait, et lorsqu’il revient, ses yeux sont brillants. Mais il ne peut se résoudre à lui demander ce qu’elle dit.
Ce n’est pas la première fois qu’un romancier utilise une enveloppe non ouverte comme emblème du mystère du cœur d’une autre personne, et je doute que ce soit la dernière. Néanmoins, j’ai eu envie de pleurer moi-même alors que j’approchais de la fin de Stella Maris, la fin de ce duo sombre et passionnant. Les séances d’Alicia avec son psychiatre sont de plus en plus courtes et de plus en plus irrégulières, et le Dr Cohen commence à noter ce que la forme du livre ne nous permet pas de voir, les détails de son apparence physique, si mince, si usée et si larmoyante. Elle ne peut plus résister à ce vers quoi elle court, et chaque phrase la rapproche de ce jour de décembre où nous avons vu pour la première fois son corps gelé. À la dernière page, le Dr Cohen lui dit que leur temps est écoulé, sans vraiment comprendre que c’est son propre temps qui est écoulé, et le nôtre aussi d’une certaine façon. Je sais, dit-elle :
Tiens-moi la main.
Tenir ta main ?
Oui. Je le veux.
D’accord. Pourquoi ?
Parce que c’est ce que les gens font quand ils attendent la fin de quelque chose.
Notes
1. Alexandra Alter, “Sixteen Years After The Road, Cormac McCarthy Is Publishing Two New Novels,” The New York Times, March 8, 2022.
2. John Jurgensen, “Hollywood’s Favorite Cowboy,” The Wall Street Journal, November 20, 2009.
3. McCarthy first used the word in Cities of the Plain, as part of a dream vision of human sacrifice.
4. “The Kekulé Problem,” Nautilus, April 17, 2017.




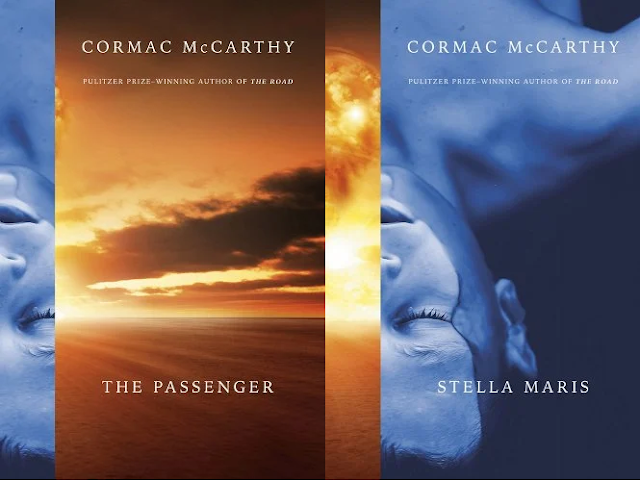
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire