Howard W. French, The New York Review of Books,
7/4/2022
Traduit par Fausto
Giudice, Tlaxcala
Pendant près de deux siècles, la Grande-Bretagne a tenté de minimiser l'importance de l'esclavage pour sa prospérité économique.
Livres recensés :
Slave Empire: How Slavery
Built Modern Britain
by Padraic X. Scanlan
London: Robinson, 448 pp., £25.00; £12.99 (paper)
Empireland: How
Imperialism Has Shaped Modern Britain
by Sathnam Sanghera
London: Viking, 306 pp., £18.99; £9.99 (paper)
En 1833, la Grande-Bretagne a alloué la somme extraordinaire de 20 millions de livres sterling - 40 % des dépenses annuelles du Trésor britannique de l'époque, et l'équivalent aujourd'hui de quelque 3,35 milliards de dollars [= 3 Mds €] - en paiements compensatoires pour rompre définitivement avec l'esclavage. C'était l'année où elle a libéré les personnes asservies dans tout son empire et un quart de siècle après avoir interdit la participation au commerce transatlantique des Africains, qu'elle avait dominé pendant 150 ans. Pendant cette période, elle a expédié trois millions d'esclaves vers les Amériques.
Depuis lors, le pays a tenté de refondre la compréhension historique de la manière dont il a profité du travail forcé de millions d'Africains. On a enseigné aux Britanniques - et beaucoup le croient encore - que l'esclavage n'a jamais été un fondement de la prospérité commerciale de leur pays, mais un boulet qu'il fallait éliminer pour que le capitalisme puisse vraiment s'épanouir. On peut entendre des échos de cette pensée dans les déclarations du Premier ministre Boris Johnson et de sa prédécesseure, Theresa May, selon lesquelles la sortie de l'Union européenne était un moyen pour la Grande-Bretagne de renouer avec ses fières traditions de puissance commerciale mondiale.
Au lieu d'éprouver des remords ou même d'entamer un dialogue sérieux sur leur passé d'esclavagistes et d'exploitants de plantations, les Britanniques ont été encouragés à adopter des messages rassurants sur la liberté. Ces efforts ont commencé au début du XIXe siècle avec la promotion de leur pays comme l'avatar même de la libération des esclaves humains. Un élément central de cette gestion de l'image nationale était l'escadron britannique d'Afrique de l'Ouest, les navires qui balayaient périodiquement les côtes africaines au XIXe siècle, interceptant les commerçants récalcitrants d'êtres humains, qu'ils viennent d'Europe ou des Amériques, et libérant les Africains qu'ils saisissaient. Les Britanniques se régalaient également des récits de la gratitude des anciens esclaves qui avaient été libérés de l'esclavage dans les plantations des Antilles et autorisés à travailler pour eux-mêmes dans le Nouveau Monde pour la première fois.
Qu'y avait-il de mal à une image aussi flatteuse ? Tout d'abord, les généreuses indemnités versées en 1833 ne sont pas allées dans les poches des esclaves, ni même pour les soigner ou les réhabiliter, mais dans celles des anciens propriétaires d'esclaves. Nombre d'entre eux ont augmenté leur fortune en investissant dans les industries émergentes de l'époque, notamment les banques, les actions des chemins de fer, les mines, les usines et, pour certains, le coton américain, qui était alors une nouvelle industrie esclavagiste en plein essor. Soixante-quinze baronnets figurent dans les registres d'indemnisation, ainsi que des dizaines de membres du Parlement.
La légende de l'Escadron d'Afrique de l'Ouest, bien que non négligeable, a été démesurément amplifiée par rapport à son impact réel sur les dernières années obscures du commerce international illicite d'esclaves. Comme l'écrit Padraic X. Scanlan dans Slave Empire : How Slavery Built Modern Britain, son ouvrage révisionniste et vivifiant sur l'ère de la servitude des Noirs et ses conséquences, les histoires populaires sur cette force d'interdiction portaient des sous-titres tels que « Les navires qui ont arrêté la traite des esclaves ». Mais en réalité, elle n'a rien fait de tel. Plus de 2,6 millions d'Africains réduits en esclavage ont traversé l'Atlantique après 1810, date à laquelle les patrouilles britanniques, toujours peu nombreuses, ont commencé : « L'escadron était plus utile en tant que force de combat pour intimider et détruire les royaumes et les chefferies de la côte ouest-africaine qui défiaient les exigences britanniques ».
Et que sont devenus les esclaves qui ont été libérés de leurs chaînes lorsque l'abolition totale a finalement eu lieu ? Selon Scanlan, ils recevaient des salaires bien trop bas pour leur permettre d'acheter leurs propres terres, et devaient donc continuer à produire du sucre et du café, du coton et de l'indigo pour d'autres dans des conditions difficiles dans les Caraïbes. En fait, soutient-il, c'était le but recherché depuis le début. Même parmi les abolitionnistes anglais les plus progressistes, nombreux étaient ceux qui pensaient que la meilleure issue de cette nouvelle ère de liberté nominale pour les Noirs autrefois asservis serait qu'ils travaillent indéfiniment sous la tutelle de riches propriétaires de plantations blancs dont le confort et la prospérité britanniques exigeaient les marchandises.
L'arrière-plan intellectuel du livre de Scanlan, qu'il reconnaît dès le début, est l'argument - d'abord avancé par l'ancien premier ministre trinidadien et universitaire Eric Williams, puis récemment développé et affiné par de nombreux autres historiens - selon lequel un empire dans les Caraïbes fondé sur l'esclavage était à la base du capitalisme et de la prospérité britanniques. Dire que les historiens occidentaux n'ont pas toujours adhéré à cette interprétation serait un euphémisme. Pendant les décennies qui ont suivi la publication de l'ouvrage de référence de Williams, Capitalism and Slavery (1944), le pendule scientifique est allé dans la direction opposée. Les historiens britanniques et américains dominants ont attaqué ses écrits, les jugeant exagérés et sans fondement, et ont minimisé l'ensemble de son argumentation en s'emparant de deux de ses affirmations : les profits tirés de la traite des esclaves ont constitué une part essentielle du financement de l'industrialisation britannique, et la Grande-Bretagne n'a renoncé à l'esclavage qu'une fois qu'il n'a plus été rentable. Cette deuxième idée est clairement indéfendable, mais aujourd'hui, de nombreux historiens estiment que la première ne peut être considérée comme erronée que si elle est envisagée de la manière la plus limitée qui soit.
Scanlan, comme d'autres chercheurs récents, soutient de manière tout à fait sensée que les profits de la traite des esclaves provenaient d'autres activités que l'achat et la vente purs et simples d'êtres humains. Il précise toutefois que ce commerce brutal était immensément lucratif. Les marchands d'esclaves de la fin du XVIIIe siècle réalisaient en moyenne un taux de profit annuel de 9,5 %, soit plus du double de l'appréciation de la valeur des biens immobiliers britanniques. Une autre façon de comprendre la rentabilité de ce commerce vient de l'examen de ses effets ailleurs. Dans un article de 2014, les économistes Thomas Piketty et Gabriel Zucman ont soutenu que la valeur dérivée du commerce et de la propriété d'esclaves en Amérique était supérieure à celle de toutes les usines, chemins de fer et canaux du pays réunis.* Et les importations d'esclaves aux USA représentaient moins de 5 % du commerce transatlantique total, un nombre bien plus important allant au Brésil et aux Caraïbes.
De nombreux détracteurs de Williams ont considéré de manière restrictive les prix du marché des esclaves pour attaquer l'idée que le profit de la traite aurait pu être un facteur décisif de l'industrialisation britannique. Pourtant, ce n'est que lorsque l'on considère la création globale de richesse rendue possible par le travail des esclaves, qui est implicite dans le calcul de Piketty et Zucman, que l'on peut commencer à prendre la véritable mesure de l'impact du commerce sur la prospérité britannique (ainsi qu'européenne et américaine). L'esclavage mobilier était à la base d'un grand nombre d'activités économiques, dont celle qui a sans doute le plus transformé l'époque : la plantation de sucre.
Selon Scanlan, les plantations étaient, en tant qu'entreprises, à peu près aussi rentables que le commerce des êtres humains, mais même ce chiffre est loin de donner une image complète de la façon dont l'esclavage a contribué de manière décisive à la fortune de la Grande-Bretagne (et de l'Amérique). Limiter l'estimation au sucre, ou même ajouter les profits tirés de l'achat et de la vente incessants de millions d'êtres humains, reviendrait à mesurer les émissions mondiales de carbone à partir du seul moteur à combustion interne. Au milieu des années 1660, le sucre produit dans la minuscule colonie britannique de la Barbade valait plus que tout l'argent et l'or expédiés en Espagne depuis ses colonies américaines.
Avec la forte croissance des plantations de sucre, à la Barbade puis à la Jamaïque, la contribution du commerce au produit intérieur brut de la Grande-Bretagne est passée de 4 % en 1700 à 40 % en 1770. Mais parallèlement, le boom du sucre et d'autres produits cultivés par les esclaves, ainsi que la traite des esclaves elle-même, ont donné naissance à toutes sortes d'activités auxiliaires très rentables qui employaient un grand nombre de Britanniques, de la fabrication de cordes à la construction navale, des armes à feu et des forges à la banque, de la production textile (destinée à deux marchés très différents : habiller les esclaves et leurs maîtres) aux assurances et à la finance. C'est la richesse en cascade dérivée de cette liste partielle d'entreprises liées à l'esclavage en plein essor qui a fait de Londres le leader des services financiers et la plus grande ville d'Europe au XVIIIe siècle, avec plus de 750 000 habitants - plus de 200 000 de plus que Paris et six fois plus que Vienne ou Madrid. En conséquence, écrit Scanlan, « le commerce a fait l'empire ; l'esclavage a fait le commerce ».
Pour saisir l'essence de toutes ces activités lucratives de manière encore plus accablante : « Esclaves. Coton. Le sucre. Ce pays n'est rien d'autre qu'une blanchisserie off-shore pour transformer le mal en monnaie forte ». Cette réplique est tirée de la série télévisée populaire Succession et est citée dans l'ouvrage Empireland: How Imperialism Has Shaped Modern Britain de Sathnam Sanghera.
Le HMS Tourmaline, navire amiral de l'escadron d'Afrique de l'Ouest ; gravure de Josiah Robert Wells d'après un croquis de H.P. Neville, The Illustrated London News, 1876
La contribution de l'esclavage à la richesse britannique ne se limitait pas à des éléments mesurés comme le commerce ou facilement saisis dans le registre comptable. Comme l'a souligné l'anthropologue Sidney Mintz dans son ouvrage classique Sweetness and Power (1986), au XVIIIe siècle, les plantations de sucre, gérées par les esclaves, étaient d'importants précurseurs de l'industrialisation. Non seulement elles étaient beaucoup plus grandes que presque tous les autres types de production courants en Europe à l'époque, mais elles fonctionnaient sur la base d'une spécialisation claire d'une main-d'œuvre enrégimentée travaillant sous une forte pression temporelle et reposaient sur la synchronisation d'opérations multiples et complexes, anticipant l'usine moderne. Ces opérations comprenaient non seulement la plantation, le désherbage et la récolte, ainsi que la gestion d'une importante main-d'œuvre asservie, mais aussi l'ébullition et la "purge" du jus de canne pour en faire de la mélasse et du sucre. Elles étaient brutales, écrit Scanlan, mais aussi parmi « les lieux de travail les plus prospères, fortement capitalisés et mécanisés de l'ère préindustrielle ».
Pour saisir toute la portée de l'affirmation de Scanlan selon laquelle l'esclavage a en fait créé l'empire, il faut cependant s'éloigner encore davantage de l'économie classique. Il affirme, par exemple, que c'est la création de nouvelles économies productives dans le Nouveau Monde, et surtout dans les Antilles, qui a facilité l'assemblage politique de ce qui est devenu le Royaume-Uni. L'histoire des serviteurs blancs sous contrat dans des endroits comme la Barbade au début du XVIIe siècle, au tout début du boom du sucre, est bien connue, du moins des historiens de l'esclavage et de l'empire. À cette époque, avant d'être remplacés après le milieu du siècle par des Africains réduits en esclavage, des Blancs d'origines diverses, certains économiquement désespérés, d'autres simplement désireux de faire fortune dans le monde florissant des plantations, ont fourni une grande partie de l'énergie et une petite partie de la main-d'œuvre qui a lancé ces opérations complexes et génératrices de richesse.
Ce déferlement de Johnny New-Comes, comme on les appelait parfois dans la culture populaire de l'époque, a permis de soulager quelque peu la misère qui régnait en Angleterre à la suite des lois d'enclosure qui interdisaient aux roturiers l'accès à de vastes étendues de terre à partir de 1604. Les Antilles (et le continent américain) sont ainsi devenues une "soupape d'échappement" vitale à une époque de bouleversements sociaux considérables. « Pour les esclaves, l'empire britannique était une prison », écrit Scanlan. Pour de nombreux Britanniques, l'empire des esclaves a ouvert un chemin vers la "liberté britannique". Pour les Blancs qui ont survécu, pourrait-on ajouter, le passage vers "les îles", et le régime esclavagiste qui s'y construisait, constituait également une énorme opportunité économique et une mise à niveau sociale historiquement unique, dans laquelle ils faisaient partie d'une nouvelle classe raciale de maîtres.
Tout aussi importante est la façon dont ce nouveau débouché pour l'émigration est devenu un lieu d'auto-réinvention et de création de richesse pour les personnes déjà aisées, servant ainsi de catalyseur vital dans la consolidation d'une union encore fragile englobant ce que sont aujourd'hui les îles britanniques. Scanlan écrit que les Antilles (ainsi que le continent américain, alors beaucoup moins riche) étaient ouvertes à la migration d'une classe de cadres écossais et irlandais d'une manière que l'Angleterre du milieu du XVIIIe siècle n'avait généralement pas : « Les Amériques offraient aux Écossais et aux Irlandais ambitieux un nouvel endroit où ils pouvaient faire fortune et s'assurer des terres, loin d'une Angleterre où les Celtes étaient souvent accueillis froidement ». Au niveau de l'élite sociale, la demande de services professionnels, en particulier de la part des avocats qui géraient les plantations au nom des propriétaires absents, et les possibilités de s'enrichir grâce à l'esclavage, au sucre et à d'autres marchandises ont été particulièrement importantes pour forger l'unité au sein de la Grande-Bretagne :
Les bénéfices du commerce et de l'esclavage rapprochent les riches propriétaires terriens et marchands anglais, écossais et irlandais, et fournissent aux jeunes hommes ambitieux et éduqués, en particulier en Écosse, une source d'emploi stable.
Le commerce de corps noirs réduits en esclavage dans les ports écossais et le passage constant par les îles des Caraïbes de la classe professionnelle écossaise ont contribué à faire de Glasgow la seconde capitale officieuse du lucratif empire atlantique de la Grande-Bretagne, pour reprendre l'expression de Sanghera. Les Écossais et les Irlandais qui faisaient fortune grâce à l'esclavage pouvaient également acquérir une adresse à Londres, ce qui leur donnait accès aux élites anglaises et contribuait à l'établissement d'une classe politique unique.
Une autre façon de construire l'Empire britannique peut être expliquée par la thèse du sociologue et penseur politique américain Charles Tilly, aujourd'hui décédé, selon laquelle "la guerre crée les États". Le livre de Scanlan rejoint un corpus croissant d'historiographie, y compris mon ouvrage Born in Blackness (2021), qui soutient que les États anglais, et par la suite britanniques, ont gagné en capacité administrative et en robustesse en conséquence directe des luttes militaires prolongées avec les Hollandais, les Espagnols et surtout les Français pour savoir qui dominerait le commerce des esclaves et l'économie de plantation centrée sur les Antilles.
La guerre avec la France, note Scanlan, seule ou en coalition, a duré presque tout le XVIIIe siècle, et une grande partie de cette guerre impliquait explicitement l'esclavage, bien que cela soit rarement souligné dans les récits standards de la période. Dans les récits britanniques, par exemple, la guerre de Sept Ans se déroule essentiellement en Europe. Aux USA, en revanche, on s'en souvient surtout comme de la guerre française et indienne, une lutte pour le contrôle de la vallée de l'Ohio, une histoire animée pour les lecteurs américains par l'apparition du jeune George Washington, pas encore très sûr de lui. Pour les Français, cependant, l'une des principales raisons de la guerre en Amérique continentale était d'immobiliser leurs rivaux britanniques afin de les empêcher de s'emparer des colonies antillaises de la France.
Comme le souligne Scanlan, William Pitt l'Ancien exhorta le Parlement à emprunter autant d'argent que les créanciers du gouvernement le permettaient afin de rassembler et de déployer d'énormes quantités de troupes dans un conflit qui devint véritablement mondial. Les Britanniques remportent des victoires de la Nouvelle- Écosse aux Philippines, mais les lots les plus riches sont concentrés dans les Caraïbes : la Guadeloupe, la Dominique, la Grenade, Saint-Vincent et Tobago, ainsi que la Havane espagnole, toutes ces régions étant beaucoup plus lucratives pour les Européens que le continent américain. Après la prise de la Guadeloupe par la marine de Pitt en 1759, la Grande-Bretagne y importa plus d'esclaves en deux ans que la France depuis le début du siècle. En conséquence, en 1761, cette petite île était en tête de toutes les possessions de Londres pour l'exportation de sucre, de coton, de rhum et de café.
Malgré tout cela, une diminution et une banalisation de la place de l'esclavage dans la vie économique moderne de la Grande-Bretagne est toujours un courant puissant, voire dominant, dans l'historiographie dominante du pays. Sanghera observe que l'étude majeure de P.J. Cain et A.G. Hopkins, British Imperialism : 1688-2015, publiée avec succès en Angleterre en 2016, mentionne à peine l'esclavage.
Cet effacement ne se limite pas aux discussions sur l'économie de l'empire. Déterminée à contrôler la plus riche des îles à sucre après sa prise de la Guadeloupe, la Grande-Bretagne a envoyé en 1793 la plus grande expédition navale qu'elle ait jamais réunie pour capturer Saint-Domingue, qui, sous la direction de Toussaint Louverture, s'était soulevée contre les Français. Les anciens esclaves de ce qui allait bientôt devenir Haïti ont cependant vaincu les Britanniques ; le nombre de leurs soldats morts au combat et de maladies y a été plus élevé que celui des victimes de la guerre d'indépendance américaine deux décennies plus tôt. Comme l'a dit Louverture en ralliant ses hommes à la victoire, « Nous nous battons pour que la liberté - le plus précieux de tous les biens terrestres - ne périsse pas ». Ni le nom de Saint-Domingue ni celui d'Haïti n'ont jamais figuré sur une bannière de régiment britannique en souvenir de cette campagne, contrairement aux grandes défaites des armées européennes. En outre, les étudiants britanniques sont rarement informés de ces événements, car ils vont à l'encontre du récit national privilégié.
Empireland est profondément préoccupé par les questions de la mémoire et de l'oubli, par les sentiments contrariés et déformés de la Grande-Bretagne à l'égard de l'empire, et par la place accordée à contrecœur aux non-Blancs de toutes origines dans sa société. Bien qu'il soit d'origine indienne, Sanghera, journaliste et réalisateur de documentaires né en Grande-Bretagne, se décrit comme ayant été "désemparé" sur des sujets comme ceux-là pendant la majeure partie de sa vie, et son livre s'ouvre sur un mode confessionnel sur la façon dont les écailles de l'ignorance lui sont tombées des yeux.
L'approche personnelle de Sanghera - beaucoup plus anecdotique que la plupart des écrits historiques - est désarmante et rend d'autant plus efficace le récit de sa découverte parfois horrifiée. Bien qu'il soit diplômé en histoire, il affirme néanmoins qu'il a davantage appris sur le côté sombre du passé impérial de la Grande-Bretagne lors de la récente vague de ce qu'il appelle le "statuecide" - le renversement des statues de certaines des figures les plus ignobles du passé impérial du pays - que dans toutes les conférences qu'il a suivies et les livres qu'il a lus à l'école.
Une révélation similaire lui est venue lors d'une visite en Inde, où il s'est rendu pour tourner un documentaire en 2019. Sanghera raconte qu'il a appris l'existence du massacre de Jallianwala Bagh en 1919, l'une des pires atrocités commises par les Britanniques dans le pays de ses ancêtres et ce qu'il appelle "l'un des événements clés du XXe siècle", en regardant le film Gandhi alors qu'il était éméché lors d'un long vol. Mais en confessant son ignorance, Sanghera est d'autant mieux armé pour inviter ses lecteurs à s'interroger sur leur propre manque de conscience et de honte à l'égard des actions de la Grande-Bretagne en Asie du Sud et ailleurs.
Son livre commence par les atrocités qui lui ont ouvert les yeux sur la violence et le pillage (looting, un mot importé dans l’anglais de l'Inde en conséquence directe de cette histoire) qui ont caractérisé la prise de contrôle de l'Inde par les Britanniques. De là, il s'attarde sur l'exploitation économique prolongée et extraordinaire que Londres a faite de sa riche colonie asiatique. Les estimations de la richesse accumulée par la Grande-Bretagne varient. L'une des sources indiennes de Sanghera écrit que son pays a été "saigné de 5 à 10 % de son PIB par an pendant près de deux siècles". Une autre source calcule que la colonie a été "vidée" de près de 45 000 milliards de dollars en monnaie actuelle entre 1765 et 1938, soit dix-sept fois le produit intérieur brut annuel total du Royaume-Uni d'aujourd'hui. D'autres estimations encore sont citées, laissant Sanghera et le lecteur dans l'incertitude quant à la manière exacte d'évaluer la relation économique entre la métropole et la colonie.
Il est plus intéressant de constater le contraste entre de telles réflexions et les déclarations de puissantes personnalités britanniques au fil des ans, qui sont imprégnées de négationnisme. Santham cite un discours de Benjamin Disraeli en 1872 : « Il a été démontré avec précision, avec une démonstration mathématique, qu'il n'y a jamais eu de joyau dans la couronne de l'Angleterre qui ait été aussi coûteux que la possession de l'Inde ». On peut en tirer une ligne de démarcation avec les remarques faites par l'ancien Premier ministre britannique David Cameron lors d'une visite en Inde en 2013, où il a déclaré : « Je pense qu'il y a énormément de raisons d'être fier de ce que l'Empire britannique a fait et dont il était responsable ». Ces deux remarques partagent l'idée que la Grande-Bretagne rendait service aux autres en les colonisant, prétendument même 0 ses propres frais. Voilà l'essence du "fardeau de l'homme blanc", l'expression immortalisée dans le poème éponyme de Rudyard Kipling en 1899, et une clé de voûte dans la refonte du sentiment d'identité du pays au XIXe siècle post-esclavage.
Sanghera est à son meilleur lorsqu'il explore les nombreuses contradictions soulevées par tout cela. La Grande-Bretagne veut que ses citoyens soient fiers de son grand passé impérial, mais elle ne semble pas vouloir qu'ils en sachent beaucoup. Un autre Premier ministre britannique, Gordon Brown, a soutenu, lors d'une visite en Afrique de l'Est en 2005, que la Grande-Bretagne devrait cesser de s'excuser pour son empire et reconnaître que ce qu'il a appelé certaines des "plus grandes idées" de l'histoire en sont issues. Il est donc pour le moins curieux que le passé impérial soit si peu enseigné dans les écoles. Au-delà du silence de son propre pensionnat d'élite sur le sujet, Sanghera cite de nombreuses autres personnes, y compris des historiens professionnels tels que Bernard Porter, qui a écrit qu'il « ne se souvient pas d'avoir jamais discuté de l'empire, ni même de l'avoir mentionné à la maison quand il était enfant », et qu'il n'avait rencontré « aucune histoire impériale » avant ses études supérieures. La romancière Charlotte Mendelson a affirmé qu'elle avait reçu « l'une des meilleures éducations que la Grande-Bretagne puisse offrir », mais qu'on ne lui avait « rien appris sur l'esclavage ou le colonialisme. Rien. Jamais. »
"L'empire britannique", écrit Sanghera, était non seulement la plus grande chose qui nous soit jamais arrivée, mais aussi l'une des plus grandes choses qui soient jamais arrivées au monde. À son apogée, il couvrait un quart des terres émergées de la planète et gouvernait près d'un quart de la population mondiale.
Il cite le chroniqueur du Financial Times Gideon Rachman, qui a observé que "pour un historien martien", ce serait sûrement l'aspect le plus intéressant de l'histoire moderne de la Grande-Bretagne. Et pourtant, selon Sanghera, l'image que le pays a de lui-même est presque entièrement construite autour de récits soigneusement entretenus de sacrifice national, d'héroïsme et de victoire dans les deux guerres mondiales du XXe siècle.
Mais ce n'est pas tout. L'une des découvertes qui semble avoir le plus touché Sanghera au cours de ses recherches est le fait que, pendant ces guerres, des millions de soldats ont été enrôlés dans tout l'empire pour combattre au nom de la Grande-Bretagne, ce qui est très peu mentionné dans les histoires classiques et est pratiquement absent des films ou des commémorations de guerre. Cela amène Sanghera à ruminer le traitement réservé aux populations brunes et noires de toutes sortes qui se sont installées en Grande-Bretagne dans l'après-guerre, souvent à la suite de campagnes de recrutement officielles visant à la reprise économique et à la reconstruction. Ce faisant, il revient une fois de plus à sa naïveté antérieure : « Le récit selon lequel les personnes de couleur brune se sont imposées en Grande-Bretagne est si puissant que je l'ai absorbé moi-même, en tant que jeune Britannique de couleur brune ». Plus loin, il écrit : « Nous oublions non seulement que les Noirs et les Asiatiques ont été invités à travailler ici, mais que beaucoup sont venus en tant que citoyens ; nous oublions plus généralement que la Grande-Bretagne s'est construite sur l'immigration ».
La question la plus puissante de Sanghera plane tout au long de son livre. Par le biais de la traite des esclaves et de la colonisation qui a suivi, l'Empire britannique a présidé à « l'une des plus grandes entreprises de suprématie blanche de l'histoire de l'humanité ». Comment, dès lors, la reconnaître aujourd'hui ? Pour beaucoup, conclut-il, la compréhension de l'empire est simplement devenue une procuration superficielle du nationalisme. Les Britanniques n'aiment pas être confrontés à des détails inconfortables, et ils confrontent des gens comme Sanghera, parfois avec colère, à la question de savoir si des intellectuels comme lui ne mettent pas trop l'accent sur le négatif.
Les Britanniques, dit-il, se réconfortent à l'idée que les USA sont, selon l'opinion populaire, plus "foireux" que leur propre pays. Mais au moins aux USA, qui luttent également contre le déni de leur histoire raciale, la tragédie de l'esclavage est enfin devenue un élément important de la culture populaire. Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, est allé beaucoup plus loin que n'importe quel dirigeant britannique, qualifiant le colonialisme de son pays de "crime contre l'humanité, une véritable barbarie." Il s'agit, selon Macron, "d'un passé que nous devons affronter en présentant des excuses à ceux contre qui nous avons commis ces actes." Pour la Grande-Bretagne, prévient Sanghera,
la façon dont nous ne reconnaissons pas que nous sommes une société multiculturelle parce que nous avions un empire multiculturel rend nos conversations nationales sur la race tragiques et absurdes..... Notre amnésie collective sur le fait que nous étions, en tant que nation, délibérément suprémacistes blancs et occasionnellement génocidaires, et notre incapacité à comprendre comment cela informe le racisme moderne, sont catastrophiques.
Note* "Capital Is Back : Wealth-Income Ratios in Rich Countries, 1700-2010", The Quarterly Journal of Economics, vol. 129, n° 3 (août 2014).




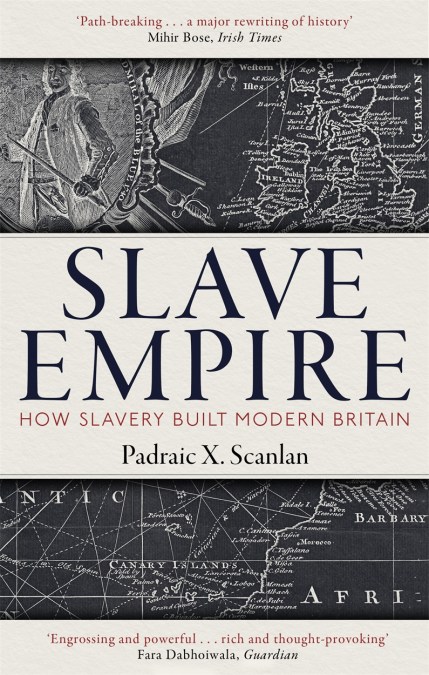
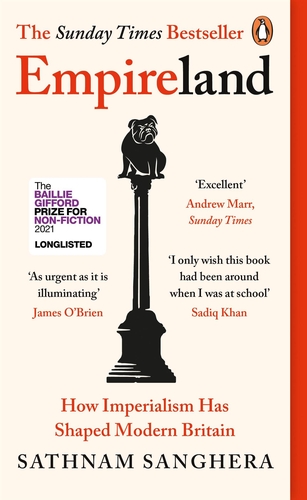
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire