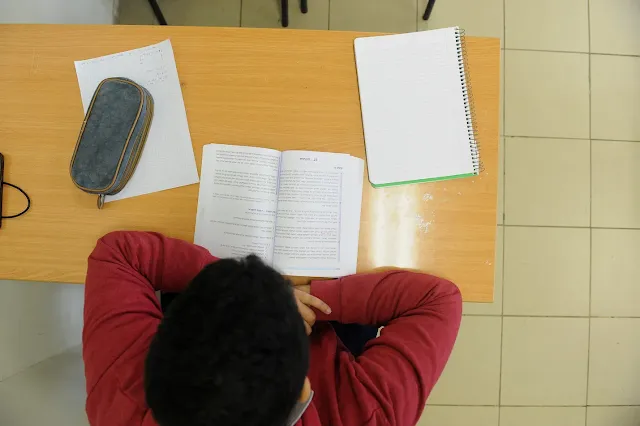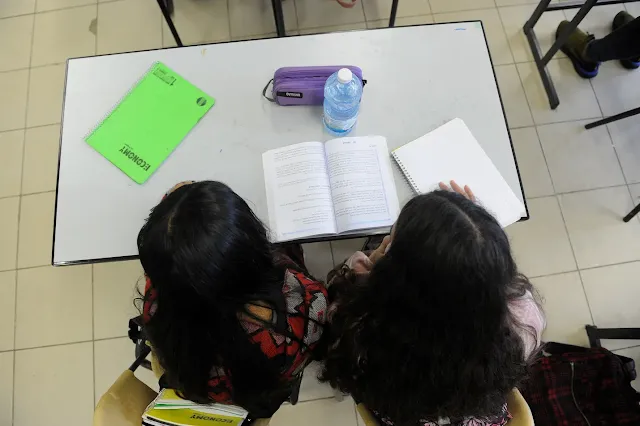Les députés du Congrès ont accusé le gouvernement de l’État de ne pas avoir apporté immédiatement une aide financière aux agriculteurs, privant ainsi bon nombre d’entre eux de l’aide à laquelle ils avaient droit.
Sudhir Suryawanshi, The New Indian Express, 1/7/2025
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
Sudhir Suryawanshi est un journaliste indien originaire du Maharashtra qui écrit sur la politique de cet État depuis quinze ans. Il a notamment travaillé pour DNA, Mumbai Mirror et Free Press Journal. Il est actuellement rédacteur en chef adjoint du New Indian Express. Il est l’auteur du livre Checkmate: How the BJP Won and Lost Maharashtra (Viking, 2020). @ss_suryawanshi
MUMBAI - Le gouvernement du Maharashtra a révélé mardi, lors de l’assemblée législative de l’État, qu’entre janvier et mars 2025, 767 suicides d’agriculteurs avaient été signalés dans l’État, la majorité d’entre eux dans la région de Vidarbha.
Les députés du Congrès ont posé une question écrite au parti au pouvoir sur l’augmentation du nombre de suicides d’agriculteurs dans le Maharashtra, en particulier dans la région de Vidarbha, et ont demandé des détails sur la manière dont le gouvernement de l’État apporte son aide aux familles des agriculteurs décédés. Les députés du Congrès ont également demandé une augmentation de l’aide financière, qui s’élève actuellement à 1 lakh de roupies [=1000 €].
Dans une réponse écrite, Makrand
Patil, ministre de la Réhabilitation et député du NCP
[Parti du Congrès Nationaliste], a présenté la réponse écrite à l’Assemblée
et a assuré que le gouvernement du Maharashtra apporterait toute l’aide
possible aux agriculteurs.
Le gouvernement du Maharashtra
accorde une aide financière de 1 lakh de roupies à la famille de l’agriculteur
qui s’est suicidé.
Selon ce rapport, en trois mois,
de janvier à mars 2025, 767 agriculteurs se sont suicidés, dont 376 étaient
éligibles à une indemnisation du gouvernement, tandis que 200 n’ont pas reçu d’aide
car ils ne répondaient pas aux critères fixés par le gouvernement.
Makrand Patil a en outre révélé
que dans l’ouest du Vidarbha – Yawatmal, Amarawati, Akola, Buldhana et Wasim –,
entre janvier et mars 2025, 257 agriculteurs se sont suicidés, parmi lesquels
76 familles ont reçu une aide financière du gouvernement de l’État, tandis que
74 demandes ont été rejetées.
Dans le district de Hingoli, dans
le Marathwada, 24 suicides d’agriculteurs ont été signalés au cours des trois
mois compris entre janvier et mars 2025.
Les députés du Congrès ont
affirmé que le gouvernement de l’État n’avait pas accordé immédiatement l’aide
financière aux agriculteurs et que de nombreux agriculteurs éligibles avaient
même été privés de l’aide à laquelle ils avaient droit pour des raisons
fallacieuses. En outre, le gouvernement de l’État a précisé qu’il n’y avait
aucune proposition d’augmentation de l’aide financière aux familles des
agriculteurs décédés.
Toutefois, le gouvernement de l’État a déclaré avoir pris diverses mesures pour mettre fin aux suicides des agriculteurs.
« Le gouvernement de l’État accorde une indemnisation aux agriculteurs dont les récoltes ont été endommagées par des pluies hors saison et des catastrophes naturelles. En outre, dans le cadre du programme PM Kisan Samman Nidhi [Fonds du Premier ministre d’allocation aux agriculteurs], le gouvernement central verse 6 000 roupies [= 71€], tandis que le gouvernement de l’État contribue également à hauteur de 6 000 roupies par an aux agriculteurs pauvres et dans le besoin », indique la note.
Celle-ci précise également que le
gouvernement de l’État organise des séances de soutien psychologique pour les
agriculteurs déprimés et en détresse, afin de les dissuader de se suicider, et
qu’il augmente même le prix minimum de soutien des récoltes des agriculteurs.
« En outre, le gouvernement de l’État
s’efforce de mettre en irrigation autant d’hectares de terres que possible et
de mettre en place des programmes d’aide sociale pour les agriculteurs. »
Champs de désespoir : pourquoi les agriculteurs du Maharashtra paient le prix suprême
Sudhir Suryawanshi, The New Indian Express, 12/7/2025
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
Entre le 1er janvier
et le 31 mars de cette année, toutes les trois heures, un agriculteur du
Maharashtra a mis fin à ses jours, avec 767 suicides enregistrés en seulement
90 jours, selon les données présentées à l’assemblée législative de l’État le 1er
juillet. Ce taux alarmant, qui représente en moyenne huit décès par jour, n’est
pas un cas isolé. L’année dernière, le gouvernement a admis devant l’assemblée
que le taux de suicide chez les agriculteurs était similaire depuis 56 mois.
Cela reflète une crise agraire qui s’aggrave et qui défie toute solution dans
le Maharashtra, en particulier dans les régions de Vidarbha et Marathwada,
depuis plus de deux décennies. Malgré les promesses politiques ambitieuses,
notamment celle du BJP [le parti suprémaciste hindou au pouvoir fédéral, NdT]
en 2014 d’éradiquer les suicides d’agriculteurs, la tendance persiste,
alimentée par un mélange toxique de difficultés économiques, de défis
environnementaux et d’échecs politiques.
Le cas de Kailash Arjun Nagare,
lauréat du prix Young Farmer Award 2020, qui s’est donné la mort en mars 2025,
invoquant l’inaction du gouvernement face aux demandes en matière d’irrigation,
est un indicateur du désespoir croissant qui règne dans la communauté agricole.
Pourquoi rien ne change-t-il alors que les suicides d’agriculteurs ne montrent
aucun signe de ralentissement dans le Vidarbha et le Marathwada ?
Ampleur de la crise
Au cours des 24 dernières années,
la division fiscale d’Amravati, dans le seul district de Vidarbha, a enregistré
21 219 suicides d’agriculteurs, dont 5 395 dans le district d’Amravati, 6 211
dans celui de Yavatmal, 4 442 dans celui de Buldhana, 3 123 dans celui d’Akola
et 2 048 dans celui de Washim. En janvier de cette année, 80 suicides ont été
signalés dans ces districts, Yavatmal enregistrant le nombre le plus élevé avec
34. Dans le district de Hingoli, dans le Marathwada, 24 suicides ont eu lieu au
cours de la même période de trois mois.
Vidarbha est représentée par des
poids lourds du BJP à l’Assemblée législative de l’État et au Parlement : le
ministre en chef Devendra Fadnavis et le ministre de l’Union Nitin Gadkari. Ils
ont obtenu des résultats remarquables dans divers domaines, mais n’ont
malheureusement pas réussi à faire avancer le dossier de la crise agraire.
Les données historiques du Bureau
national des statistiques criminelles (NCRB) et d’autres rapports font état de
37 142 suicides d’agriculteurs dans le Maharashtra entre 2015 et 2024 : 4 291
en 2015, 3 058 en 2016, 3 701 en 2017, 3 594 en 2018, 3 927 en 2019, 4 006 en
2020, 4 064 en 2021, 4 268 en 2022, 2 851 en 2023 et 2 635 en 2024.
Les données du NCRB pour 2022
montrent que 11 290 personnes dans le secteur agricole (5 207
agriculteurs/cultivateurs et 6 083 ouvriers agricoles) à travers le pays se
sont suicidées, ce qui représente 6,6 % du total des suicides (170 924) en
Inde. Les hommes ont été plus nombreux que les femmes à choisir cette solution
extrême. Sur les 5 207 suicides d’agriculteurs/cultivateurs, 4 999 étaient des
hommes et 208 des femmes. Et sur les 6 083 ouvriers agricoles qui se sont donné
la mort, 5 472 étaient des hommes et 611 des femmes. Les États et les
territoires de l’Union qui n’ont signalé aucun suicide dans le secteur agricole
sont le Bengale occidental, le Bihar, l’Odisha, l’Uttarakhand, Goa, le Mizoram,
le Tripura, Chandigarh, Delhi, Lakshadweep et Pondichéry.
Quant au Maharashtra, 2 708
agriculteurs/cultivateurs – 2 448 propriétaires fonciers et 260 cultivateurs de
terres louées – se sont suicidés en 2022. Cela représente plus de 50 % du
chiffre national de 5 207 dans la même catégorie. Et plus d’un quart du nombre
total de suicides d’ouvriers agricoles (1 560) provenait du Maharashtra. Ces
chiffres sont stupéfiants, quelle que soit la comparaison.
Comme l’a déclaré le leader du
Congrès Rahul Gandhi en commentant l’article de ce journal : «
Réfléchissez-y... en seulement trois mois, 767 agriculteurs se sont suicidés
dans le Maharashtra. S’agit-il seulement d’une statistique ? Non. Ce sont 767
foyers détruits. 767 familles qui ne pourront jamais s’en remettre. »
Il a ensuite marqué des points
politiques en affirmant que le gouvernement annulait facilement les prêts des
riches mais pas ceux des pauvres, ce qui lui a valu une réplique cinglante du
BJP, qui lui a rappelé les « péchés commis par le gouvernement NCP-Congrès
pendant son mandat dans le Maharashtra ».
Au milieu de toutes ces querelles
politiques, la question clé reste sans réponse : pourquoi la série de mesures
sociales prises par les gouvernements central et régional, y compris l’octroi d’aides
financières, n’ont-elles pas réussi à redonner aux agriculteurs la confiance
nécessaire pour faire face aux aléas de la vie ?
Les causes profondes : un
enchevêtrement complexe
La crise des suicides d’agriculteurs
résulte d’une combinaison de difficultés économiques, de défis environnementaux
et de pressions sociales, aggravées par des lacunes politiques.
Difficultés économiques et
endettement : le poids écrasant de la dette est le principal
facteur, alimenté par la hausse des coûts des intrants et l’insuffisance des
prix des récoltes. Vijay Jawandhia, leader paysan et expert, a déclaré à ce
journal que le coût des intrants (semences, engrais, pesticides et diesel) a
fortement augmenté, tandis que les récoltes sont vendues à un prix inférieur au
prix minimum de soutien (MSP). Par exemple, en 2024, le soja s’est vendu entre
3 800 et 4 000 roupies le quintal, contre un MSP de 4 892 roupies, le coton
entre 5 000 et 6 000 roupies, contre 7 550 roupies, et le tur dal [pois d’Angole] entre 6 000 et 6
500 roupies, contre 7 500 roupies. Un rapport estime que les producteurs de
soja du Maharashtra ont perdu 85 milliards de roupies [=850 millions €]
en 2024 en raison de ventes inférieures au MSP. La taxe sur les produits
agricoles (GST) de 18 % érode encore davantage les marges. Rahul Gandhi a
souligné dans une critique que, bien que les deux gouvernements accordent au
total 12 000 roupies par an (6 000 roupies provenant du gouvernement central et
6 000 roupies provenant du gouvernement de l’État dans le cadre du PM Kisan
Samman Nidhi) aux agriculteurs, les taxes sur les intrants agricoles absorbent
plus que ces aides.
Défis environnementaux :
Vidarbha et Marathwada, où le coton, le soja et les légumineuses dominent, ne
disposent que d’un taux d’irrigation de 10 à 12 %, contre 60 % dans la ceinture
sucrière de l’ouest du Maharashtra. Les agriculteurs dépendent de moussons
irrégulières, aggravées par des phénomènes climatiques extrêmes tels que
sécheresses, pluies hors saison et tempêtes de grêle. L’épuisement des nappes
phréatiques oblige les agriculteurs à forer des puits jusqu’à 300 mètres de
profondeur, ce qui fait grimper les coûts. En 2015, des réservoirs comme celui
de Manjara n’avaient plus aucune réserve d’eau. Des pénuries similaires
persistent ailleurs. Le suicide de Kailash Arjun Nagare en mars 2025, après une
grève de la faim de 10 jours pour obtenir de l’eau d’irrigation provenant du
réservoir de Khadakpurna, met en évidence le désespoir causé par la pénurie d’eau.
Baisse des rendements et
volatilité des marchés : les rendements agricoles ont chuté, en
particulier pour le coton. Sanjay Patil, un agriculteur de Dhule, a déclaré à
ce journal que les rendements du coton sont passés de 10-12 quintaux par acre à
2-3 quintaux, les prix chutant de 10 000-12 000 roupies à 5 000-6 000 roupies
par quintal.
Pressions sociales et
psychologiques : L’augmentation des coûts de l’éducation, des
soins de santé et des besoins quotidiens dépasse les revenus stagnants des
agriculteurs, créant un écart flagrant entre les revenus et les dépenses.
Jawandhia note que contrairement aux fonctionnaires, qui bénéficient d’indemnités
de cherté liées à l’inflation et d’augmentations de salaire, les agriculteurs
ne bénéficient d’aucune protection de ce type. Les difficultés financières,
associées à un accès limité aux services de santé mentale, alimentent la
dépression. Le suicide de Sachin et Jyoti Jadhav, un couple d’agriculteurs de
Parbhani, en avril 2025, qui a laissé deux filles orphelines, montre qu’il est
urgent de s’attaquer aux problèmes de santé mentale de toute urgence.
Réponse du gouvernement
Dans l’ordre constitutionnel, l’agriculture
relève de la compétence des États, mais de nombreuses décisions importantes
dans ce secteur sont prises par le gouvernement central, a déclaré Jawandhia. «
J’ai soulevé cette question devant M. Swaminathan lorsqu’il était président de
la Commission nationale des agriculteurs. Il a ri et a accepté de recommander
au gouvernement central d’inscrire l’agriculture sur la liste des compétences
concurrentes. Cependant, cette proposition n’a pas encore été acceptée au
niveau politique », a-t-il ajouté.
Quoi qu’il en soit, les
gouvernements ont une réponse toute faite aux questions troublantes sur les
suicides d’agriculteurs. En voici un exemple tiré du Rajya Sabha [Conseil des
États, chambre haute du parlement fédéral], en réponse à une question simple
posée le 4 mai dernier : « L’agriculture étant une compétence des États, ce
sont les gouvernements des États qui fournissent l’aide. Cependant, le
gouvernement indien soutient les efforts des États par des mesures politiques
appropriées, des allocations budgétaires et divers programmes. Les différents
programmes du gouvernement indien visent à améliorer le bien-être des agriculteurs
en augmentant la production, les revenus et le soutien au revenu des
agriculteurs. Le gouvernement a considérablement augmenté les crédits
budgétaires alloués au ministère de l’Agriculture et du Bien-être des
agriculteurs (DA&FW), qui sont passés de 219,335 milliards de roupies en
2013-2014 à 1 225,287 milliards de roupies en 2024-2025. » Le ministre énumère
ensuite 28 grands programmes visant à améliorer le revenu global des
agriculteurs. De leur côté, les États publient des données sur l’aide accordée
aux proches des victimes éligibles. Mais il est difficile de trouver des
preuves empiriques que ces mesures ont inversé la tendance au suicide.
Mesures sociales et problèmes
Indemnisation : 1 lakh
de roupies pour les familles des agriculteurs décédés, mais seuls 376 des 767
cas de suicide entre janvier et mars 2025 ont été approuvés, avec 295 lakhs de
roupies demandés par huit districts et seulement 18 lakhs versés.
MSP : les
achats limités effectués par 562 centres ne permettent pas d’empêcher les
ventes en dessous du MSP.
Aide financière : une
aide annuelle de 12 000 roupies (6 000 roupies provenant du gouvernement
central et 6 000 roupies provenant du gouvernement de l’État dans le cadre du
programme PM Kisan Samman Nidhi) compensée par la GST et la hausse des coûts
des intrants
Accompagnement psychologique : les
séances de soutien psychologique visent à dissuader les suicides, mais leur
ampleur est insuffisante
Priorité à la canne à sucre : le
vice-ministre en chef Ajit Pawar a proposé une loi pour protéger les
producteurs de canne à sucre. Les producteurs de coton, majoritaires dans le
Vidarbha, se sentent négligés en raison de l’influence politique des
coopératives de canne à sucre. Jawandhia critique l’accent mis sur la canne à
sucre, soulignant que les producteurs de coton sont traités comme des «
orphelins » dans le Vidarbha.
Voix sur le terrain
Les agriculteurs et les militants
soulignent la négligence systémique qui a conduit à la crise. Sanjay Patil est
passé du coton aux vergers de citronniers en raison de pertes insurmontables.
Ajit Nawale, de Kisan Sabha, a comparé les politiques indiennes aux subventions
usaméricaines et européennes, accusant le gouvernement de favoriser les
négociants. Il a déclaré que le gouvernement fédéral accordait 6 000 roupies
aux agriculteurs pauvres et dans le besoin dans le cadre du programme Kisan
Samman, mais que sous le couvert d’une taxe sur les produits chimiques, les
engrais et les pesticides de 18 %, il soutirait aux agriculteurs plus d’argent
que les subventions qu’il leur accordait. « J’appelle les agriculteurs à s’unir
et à lutter contre le gouvernement et ses politiques », a-t-il suggéré.
Quant à Jawandhia, il a déclaré :
« Les cousins Thackeray se sont unis sur la question de la langue marathi et se
sont opposés à l’imposition de l’hindi dans le Maharashtra, mais pourquoi aucun
politicien ne se mobilise pour la cause des agriculteurs de l’État ? »
Aller de l’avant
Pour faire face à la crise des
suicides dans le secteur agricole, des réformes structurelles sont nécessaires
:
Régime du prix minimum de soutien
(MSP) : selon Jawandia, l’application du MSP en tant que droit
légal pourrait garantir des prix équitables. En outre, aucune récolte ne
devrait être vendue en dessous du MSP.
Infrastructures d’irrigation : il est
essentiel de développer l’irrigation dans le Vidarbha et le Marathwada,
éventuellement grâce à des projets tels que le barrage de Khadakpurna. Le
manque d’installations d’irrigation a coûté la vie à de nombreux agriculteurs,
dont Nagare.
Soutien en santé mentale : le
renforcement des services de conseil pourrait aider à soulager la détresse
psychologique.
La lettre de suicide de Nagare
exigeait des mesures ; les décès des Jadhav ont laissé leurs filles orphelines.
Tant que les problèmes de dette, de pénurie d’eau et de volatilité des marchés
ne seront pas résolus, les fermes du Maharashtra resteront un cimetière pour
leurs agriculteurs.
Illustrations : Sourav Roy
Lire sur le même thème
➤La détresse des paysans indiens est une réalité, par Anil K Sood, février 2024
La détresse des paysans indiens est une réalité, par Anil K Sood, février 2024
➤Suicides en masse de fermiers indiens : ce qui se profile à l’horizon
Chronique d'une catastrophe planifiée
par Arun Shrivastava, 8/10/2006