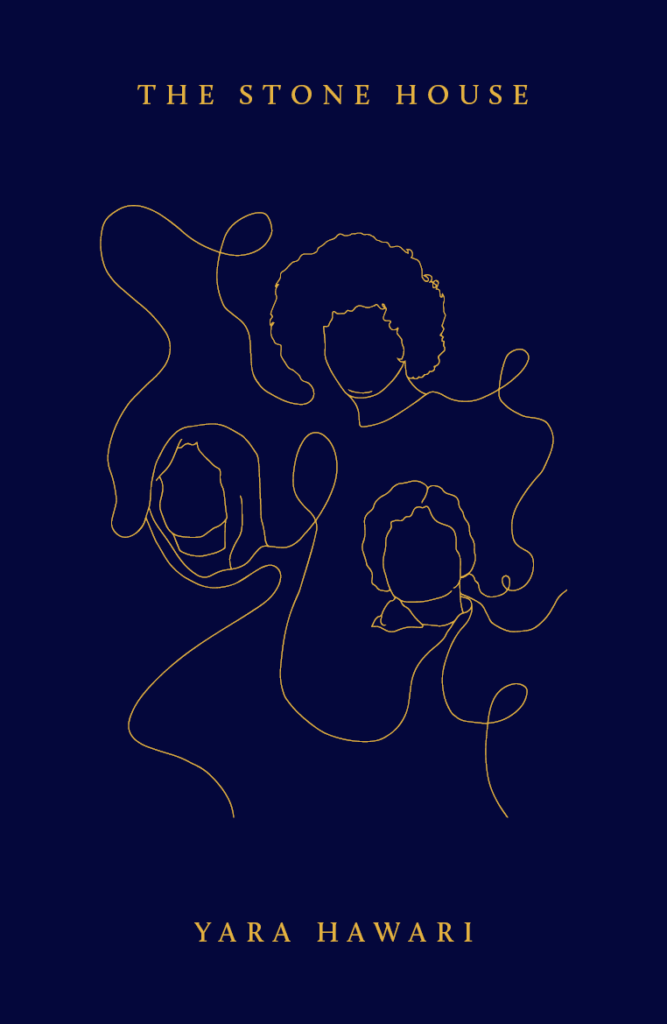Haidar
Eid, Mondoweiss,
16/6/2022
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
"The Stone House" de Yara Hawari est l'histoire d'un traumatisme palestinien sans fin, enraciné dans la Nakba. Mais c'est aussi un témoignage de fermeté, de résistance et, j'ose le dire, d'espoir.
THE STONE HOUSE
par Yara Hawari
96 pages. Hajar Press,
12,50 £.
Il se trouve que je donnais mes derniers cours de critique littéraire, où je discutais avec mes étudiants de termes littéraires tels que le réalisme et la question de savoir si la littérature peut le transcender et aller « au-delà du réalisme « , pour ainsi dire, lorsque j'ai commencé à lire la " novella "[roman court] de Yara Hawari, The Stone House. Mais s'agit-il d'une novella, c'est-à-dire d'un genre littéraire qui fictionnalise la réalité ? Il est rare que je finisse de lire une fiction d'une traite, mais ce livre était une exception.
Dans mon autre cours sur le genre, nous lisons des textes palestiniens et sud-africains, de Ghassan Kanafani et Njabulo Ndebele, où nous discutons de l'histoire du point de vue du colonisé et de la manière dont elle offre une alternative à l'histoire officielle, c'est-à-dire à la version plus dominante du colonisateur. Nous comparons ensuite l'histoire de la Palestine et de l'Afrique du Sud et concluons que l'apartheid et le sionisme ont tous deux créé un récit historique dominant qui cherche à éliminer tous les autres récits.
C'est pourquoi j'ai trouvé la (non-)fiction de Yara étonnante ! Écrit/narré du point de vue de trois "personnages" représentant trois générations de Palestiniens des années 1920 et 1930, puis de 1948 (la génération de la Nakba) et enfin de 1968, après la Naksa, lorsque toute la Palestine historique est tombée aux mains des troupes sionistes. Le centre de la nouvelle, étant une histoire palestinienne, est bien sûr la Nakba et son impact sur le père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de Yara, racontée sur un ton mélancolique. En fait, étant moi-même Palestinien, je dirais certainement que c'est l'histoire de ma propre famille qui m'a été racontée par ma mère et ma grand-mère sous la forme de hekaya, de contes, notre forme d'histoire orale qui a maintenu notre récit en vie malgré toutes les tentatives des puissances plus hégémoniques de l'effacer. Dans la nouvelle de Yara, elle est parfois racontée de manière directe, et parfois sous forme de flux de conscience, personnel et collectif.
Mahmoud, le père de Yara, se voit consacrer le premier chapitre pour nous faire part de l'impact direct de la Nakba sur sa vie, même s'il est né quelques années après. Mahmoud est un citoyen palestinien de seconde classe en Israël, vivant sous le coup des lois racistes d'Israël, un "absent présent", un rappel constant du péché originel d'Israël, à savoir le nettoyage ethnique de la Palestine, et il doit en payer le prix fort.
Le deuxième chapitre est raconté par sa mère, Dheeba, une femme bédouine courageuse et éloquente, mariée à un fellah (agriculteur/paysan) et qui doit faire face à ce fait en plus d'être Palestinienne. Bien que Dheeba soit analphabète, le social et le politique sont abordés de manière fascinante à travers sa conscience.
Le troisième chapitre est consacré à Hamda, l'arrière-grand-mère de Yara, qui nous ramène au début du siècle, lorsque la Palestine était d'abord sous occupation ottomane, puis sous le colonialisme britannique, naïvement bien accueilli par les Palestiniens sur la base d'une fausse promesse de liberté.
Ce qui relie les trois personnages, et le reste du peuple palestinien, c'est la Nakba. Edward Said l'a très bien exprimé dans After the Last Sky, où il voit une ligne entre la vie personnelle de chaque Palestinien et la Nakba. Le thème de presque tous les écrits de Ghassan Kanafani tourne autour de cet événement horrible. La plupart des poèmes de Mahmoud Darwish portent sur l'identité palestinienne après la Nakba. Et Handala de Naji Al Ali est le fils de la Nakba. Le livre de Yara ne fait pas exception.
... [Mahmoud] a découvert que les récits de la Catastrophe se posaient lourdement et douloureusement dans son esprit. Il pouvait les imaginer de manière très vive, avec angoisse, comme s'il s'agissait de ses propres souvenirs. Ils éclipsaient le présent et brouillaient les distinctions dans le temps et entre les générations.
Comme si Yara décrivait mes propres sentiments !
C'est l'histoire de hekayas personnelles, d'un traumatisme sans fin, dont le centre est la Nakba. Mais en même temps, c'est une exposition de Sumud/résistance, muqawama/résistance, Thaakera/mémoire, Hawiyya/identité et... j'ose dire, d'ESPOIR !
C'est pourquoi j'ai décidé de conclure cette note par une citation de Patrice Lumumba, le premier Premier ministre démocratiquement élu de la République démocratique du Congo. :
« Un jour, l’histoire aura son mot à dire, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à l’ONU, à Washington, Paris ou Bruxelles [ou Tel Aviv], mais l'histoire qu’on enseignera dans le pays libéré du colonialisme et de ses marionnettes.
L'Afrique [la Palestine] écrira sa propre histoire et ce sera une histoire de gloire et de dignité ».