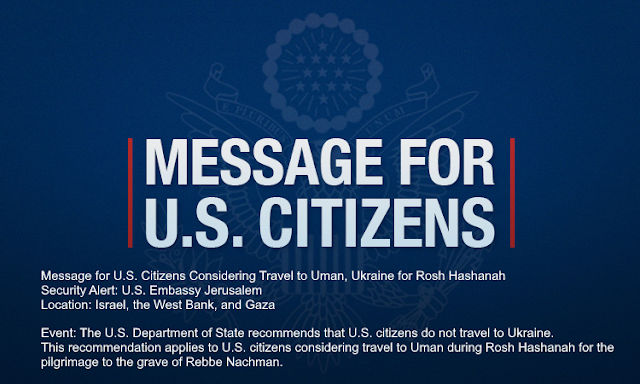Ofer Aderet, Haaretz, 20/2/2022
Traduit par Fausto
Giudice, Tlaxcala
Ofer Aderet est un historien
israélien, chargé de cours à l’Université Ouverte d’Israël et collaborateur du
quotidien Haaretz.
Bialik
pressait les Juifs de Palestine de parler hébreu, mais “péchait” lui-même en
utilisant le yiddish, et les fonctionnaires de Tel-Aviv voulaient que les
résidents mentent et disent qu’ils rêvaient en hébreu. Une chercheuse estime
que le développement de l’hébreu en tant que lingua franca s’est heurté à une
réalité complexe.
Cours d’hébreu
pour nouveaux immigrants à Dimona, 1955. Photo : Moshe Pridan/GPO
Il y a
environ 90 ans, juste avant un recensement général des habitants de la “Terre d’Israël”,
la municipalité de Tel-Aviv a adressé une demande inhabituelle aux habitants de
la ville : ils devaient répondre par l’affirmative à la question de savoir s’ils
parlaient hébreu, même s’ils rêvaient en yiddish, lisaient en allemand ou
cuisinaient en ladino.
« La
réponse définitive et claire concernant la langue hébraïque en tant que lingua
franca de la population centrale de notre ville a une grande valeur nationale
et politique », expliquait une publicité distribuée par la municipalité
aux résidents locaux, ajoutant : « Nous souhaitons attirer l’attention des
résidents sur l’importante nécessité de souligner la place de notre langue
nationale dans notre vie publique et culturelle ».
La chercheuse Zohar Shavit,
experte en sémiotique et en recherche culturelle à l’université de Tel-Aviv, a
trouvé cette publicité dans les archives municipales de Tel-Aviv alors qu’elle
réalisait une nouvelle étude visant à examiner le statut de la langue sacrée
aux yeux des habitants de la “Terre d’Israël” à la veille de la création de
l’État juif.

Tract en
quatre langues (hébreu, yiddish, anglais, allemand) des années 1930 encourageant
l’utilisation de la langue hébraïque.
Photo Collection de la bibliothèque nationale
« Plus
d’une description de la présence de l’hébreu dans le domaine public était
teintée de propagande », explique la professeure Shavit. « Parfois,
même des données statistiques apparemment objectives sur l’étendue de la
présence de l’hébreu dans la vie du Yichouv (la communauté juive d’avant l’État)
étaient biaisées et contaminées », ajoute-t-elle, faisant référence à l’ingérence
de la municipalité de Tel-Aviv dans le recensement de 1931. À l’époque, il
semble que tous les moyens étaient valables « pour tenter de présenter une
image de l’exclusivité de la langue hébraïque dans la vie du Yichouv »,
ajoute-t-elle. Mais en fait, a-t-elle découvert, « il y avait une tension
entre la réalité et la façon dont elle était dépeinte ».
Un
sondage réalisé en 1912 avait révélé que moins de la moitié des habitants de la
ville parlaient l’hébreu. Sur les 790 habitants de Tel Aviv de l’époque, 43 %
ont déclaré parler l’hébreu, 35 % le yiddish (dénoncé comme un “jargon"”par
certains), 11 % le russe et le reste le français, l’anglais, le ladino, l’arabe
et l’allemand. Le penseur et auteur sioniste Ahad Ha’am s’est inquiété à l’époque
du fait que ces données « serviraient d’arme dans les mains de ceux qui
haïssent l’hébreu » et s’est demandé « si à Tel-Aviv une majorité de
résidents parlent également d’autres langues et si le jargon (yiddish) est sur
un pied d’égalité avec l’hébreu - où est donc la renaissance de l’hébreu ? »

Le poète hébreu Haïm Nahman Bialik. Photo : Avraham Suskin/GPO
En même
temps, Ahad Ha’am a reproché à la presse, qui a publié les résultats du
sondage, de ne pas avoir présenté des données plus détaillées qui auraient
prouvé, comme il l’a dit, que « presque tous les enfants parlent hébreu ».
La professeure Shavit a découvert un autre cas où les
enfants étaient décrits comme annonçant la renaissance de la langue nationale
dans un article d’Itamar Ben-Avi, fils d’ Éliézer
Ben-Yehoudah, la force motrice de ce processus de renaissance. En 1902,
Ben-Avi décrivait ainsi la langue des enfants des jardins d’enfants de la ville
de Jaffa, voisine de Tel-Aviv : « Et avec un son mélodieux, en utilisant
un hébreu authentique, vivant et agréable, ils appellent chaque chose par son
nom. Ils parlent hébreu... ils jouent en hébreu... ils se disputent et s’interrogent
en hébreu ».
Pourtant, cette description ne
reflétait pas tout à fait la réalité complexe. En effet, c’est l’image inverse
qui a été présentée par le poète hébreu pionnier Haïm Nahman Bialik, en 1909. « La
première impression, à vrai dire, n’est pas celle d’un renouveau »,
écrit-il à sa femme Manya, après une visite à Jaffa. « À ma grande
consternation, j’ai entendu dans les quartiers juifs, à Neve Shalom et Neve
Tzedek, des jargons russes, espagnols et un jargon dans lequel de nombreux mots
arabes étaient mélangés. Je n’ai pas entendu le son mélodieux de la langue
hébraïque, sauf dans la bouche de quelques enfants ». De même, la visite
de Bialik à Petah Tikva, la « mère des moshavot [colonies]" du
Yichouv », n’était pas de bon augure : « Elle m’a fait mauvaise
impression, car c’est là que j’ai entendu parler hébreu encore moins que dans
les autres colonies. Même dans la bouche des enfants, je n’entendais parler
hébreu que très peu. Presque rien », écrit le futur poète national.

Cours d’hébreu
à Jérusalem. Photo : Cohen Fritz/GPO
“Jargons”
rivaux
Les
impressions sévères de Bialik étaient justes, pour l’époque. Une enquête menée
il y a exactement un siècle par l’Organisation sioniste mondiale a révélé que
le nombre de foyers où l’on parlait le yiddish était nettement supérieur à
celui des foyers où l’on parlait l’hébreu. Par exemple, dans les jardins d’enfants
de Jaffa, 232 enfants parlaient le yiddish à la maison, alors que l’hébreu
était la langue véhiculaire dans les foyers de seulement 115 jeunes. Les
données concernant l’ensemble des structures éducatives de Jaffa - jardins d’enfants,
écoles primaires, lycées et séminaires d’enseignants - n’étaient pas plus
encourageantes : Seuls 51 % des élèves de ces établissements parlaient l’hébreu
à la maison, soit comme seule langue, soit avec une autre langue.
La
situation à Jérusalem était bien pire. Sur les 906 enfants de maternelle
interrogés, seuls 67 parlaient hébreu à la maison ; les autres parlaient hébreu
et une autre langue, ou ne parlaient pas du tout hébreu. Shavit a constaté qu’au
milieu des années 1920, le système éducatif du Yichouv lui-même ne prenait pas
la peine de veiller à ce que l’enseignement soit dispensé exclusivement en
hébreu. Environ 20 % de tous les écoliers juifs, soit un cinquième de la jeune
génération, étaient éduqués dans différentes langues au cours de ces années.

La Rue
Allenby à Tel Aviv, 1938. Photo : Zoltan
Kluger/GPO
La
première école de langue hébraïque en Palestine, et dans le monde entier, a
ouvert ses portes en 1886 à Rishon Letzion - l’école Haviv, où le corps
enseignant comprenait Eliézer Ben-Yehoudah lui-même. C’est également à Rishon
LeTzion [“Le premier à Sion”] qu’a été créé le premier jardin d’enfants
en hébreu, sous la direction de l’éducatrice Esther Shapira. Néanmoins, David
Yudilevich, un enseignant affilié au mouvement de colonisation agricole Bilou, a
témoigné que la réalité était en fait multilingue et que l’utilisation de l’hébreu
parmi les enfants de ces années-là était encore assez limitée : « Les
tout-petits et les enfants plus âgés parlent tous un jargon [sic]
ashkénaze ou sépharade, ou le russe ou le roumain. Ils parlent toutes les
langues sauf l’hébreu. La langue que l’on veut faire revivre s’est avérée à l’époque
pauvre et maigre. Même les mots de tous les jours manquaient encore »,
a-t-il constaté.
Le plus
grand rival de l’hébreu était le yiddish, explique la chercheuse Shavit, qui
note qu’ « il était présenté comme une menace permanente pour le
projet hébraïque ». Dans ce contexte, le futur prix Nobel de littérature
S. Y. Agnon raconte une anecdote amusante : Il raconte que même une servante
arabe lui parlait en yiddish lorsqu’il cherchait la synagogue sépharade à
Jaffa.
« La
réalité linguistique était complexe », note Shavit, dont les conclusions
ont été publiées dans un article intitulé “Que parlaient les enfants hébreux ?”
dans le périodique Israel. Outre la fierté de promouvoir le projet
hébraïque, y compris le développement de la langue du peuple et de sa culture,
et les efforts parfois violents pour imposer l’utilisation de l’hébreu dans le
domaine public, « de nombreuses autres enclaves linguistiques ont été
préservées », écrit-elle. Il a donc fallu des décennies pour que l’hébreu
atteigne son statut de première langue parmi les natifs du pays.

L’universitaire Zohar Shavit. Photo :
Adi Mazan