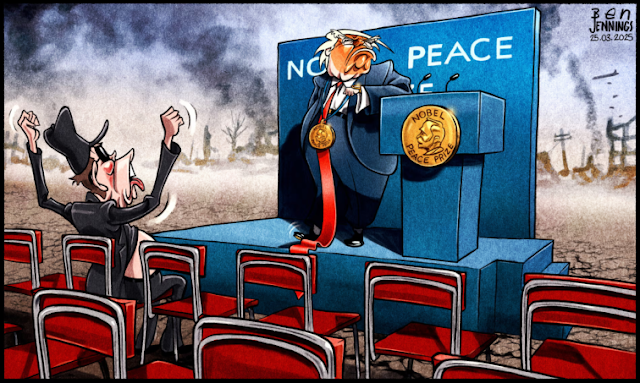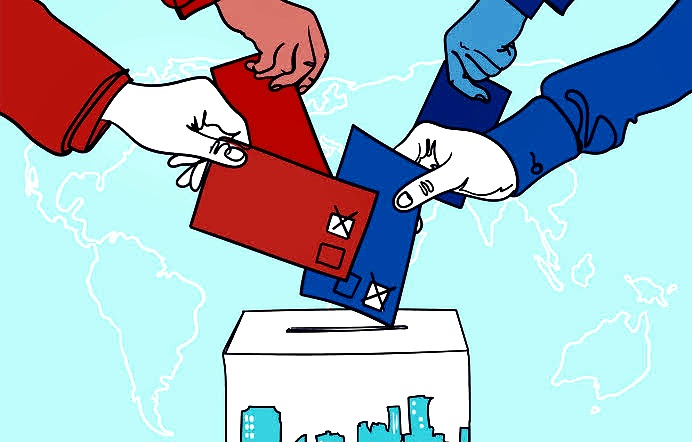Hagar Shezaf, Haaretz, 6/7/2025
Correspondante de Haaretz en Cisjordanie, Hagar Shezaf a reçu en mai 2024 le prix de l’Institut de presse israélien pour « avoir révélé les attaques systématiques perpétrées par les jeunes colons et les soldats dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que les conditions de détention des Palestiniens dans les prisons israéliennes ».
Ibrahim, un Palestinien de 16 ans, a été détenu à la prison de Megiddo pendant huit mois jusqu’à ce que la commission de libération conditionnelle déclare que son état s’était détérioré au point de mettre sa vie en danger. Il parle d’infections récurrentes par la gale, de maladies intestinales, de coups et de négligence - et une enquête de Haaretz révèle que c’est l’expérience de beaucoup d’autres, dont certains n’ont pas survécu.
Dans le salon d’un appartement parfaitement agréable de
Naplouse, un jeune homme mince est assis sur un canapé marron délavé et fume
une cigarette. Ses cheveux sont coupés court, ses mains sont minces et
osseuses, et sous ses grands yeux, des taches sombres laissent deviner ce qu’il
y a en dessous. Ses jambes sont couvertes de marques rouges-grises, denses et
de différentes tailles, qui témoignent d’infections récurrentes par la gale. Ces
dernières font partie de son quotidien depuis quelques mois, au même titre que
d’autres maladies.
Voici Ibrahim (nom non divulgué car il est mineur), 16 ans, récemment libéré de la prison de Megiddo. La commission de libération conditionnelle de la prison a noté que son apparence était « difficile à regarder et source de grande inquiétude ». Pour compléter le tableau, il faut écouter ce que lui et sa mère disent. « Lorsqu’il a été libéré, il ressemblait à une momie, comme si ce n’était pas vraiment lui », raconte-t-elle. « Nous ne l’avons pas reconnu ». Elle est assise à ses côtés et ne le quitte pas des yeux.
Sur une photo prise lors de sa libération, il y a environ un mois, montrée par sa mère, Ibrahim avait l’air bien plus mal en point. Aujourd’hui encore, ses mains trahissent sa maigreur, à peine plus que de la peau et des os. Outre la gale, il a souffert de violences et de symptômes aigus de maladies intestinales, y compris des évanouissements.
Ses documents médicaux et juridiques, ainsi que son témoignage, ne constituent qu’une petite partie d’un ensemble bien plus important de preuves émanant de prisonniers - adultes et mineurs - qui ont souffert de la même manière à Megiddo. L’un d’entre eux, Waleed Ahmad, 17 ans, y est décédé en mars. D’après les multiples témoignages recueillis par Haaretz, la négligence médicale et la mauvaise alimentation ne sont que deux des nombreux problèmes liés aux conditions de détention.
Un adolescent en bonne santé, autrefois
Ibrahim a été arrêté en octobre 2024. Dans le cadre d’un
accord de plaidoyer, il a été reconnu coupable d’avoir jeté des pierres (qui
n’ont causé aucun dommage) et condamné à huit mois de détention à Megiddo, un
établissement géré par l’administration pénitentiaire israélienne. À son entrée
dans la prison, il pesait 65 kilos, comme l’a montré un examen médical. En
quelques mois, son poids est tombé à 46 kilos. Mais Ibrahim affirme que son dossier médical ne reflétait pas entièrement la gravité de son état. Parfois, il pesait même moins
que ça, dit-il. Selon la commission des libérations conditionnelles, un avis
médical rédigé par un pédiatre (au nom de Physicians for Human Rights) faisait
état d’une « situation médicale grave, caractérisée par la malnutrition et
une insuffisance pondérale
mettant en jeu le pronostic vital ». Son indice de masse corporelle (IMC)
était de 15,2 (la norme minimale commence à 18,5). Des tests de laboratoire ont
également montré qu’il souffrait d’anémie.
L’avocate Mona Abo Alyounes Khatib, qui représentait
Ibrahim au nom du Bureau du défenseur
public, a présenté l’avis médical à la commission de libération conditionnelle.
La commission a estimé que l’état de santé d’Ibrahim était “inhabituel et grave”
et a noté que l’agent de l’administration pénitentiaire responsable du
bien-être des prisonniers n’avait pas détaillé son état de santé dans les
lettres qu’elle avait adressées à Abo Alyounes. L’agent a seulement entionné que les autorités pénitentiaires
étaient au courant de son état de santé et qu’il était traité. La commission,
après avoir réduit sa peine de 11 jours, a noté que « les conditions d’emprisonnement
difficiles que le prisonnier a endurées ne peuvent être ignorées ». Mais
Ibrahim n’est pas “inhabituel”. Haaretz a obtenu des déclarations sous
serment de quatre autres détenus de Megiddo qui ont signalé des problèmes
médicaux similaires au cours des derniers mois. Physicians for Human Rights a
traité cinq autres cas de prisonniers ayant des problèmes similaires. D’autres
déclarations sous serment obtenues par Haaretz font état des quantités
dérisoires de nourriture servies aux prisonniers et de la gale endémique, une
maladie de peau difficile à éviter pour quiconque purge une peine à Megiddo. Il
y a aussi l’histoire de Waleed Ahmad. En mars, il s’est effondré dans la cour de
la prison et est décédé. Un médecin qui a assisté à l’autopsie pour le compte
de la famille a rapporté qu’Ahmad n’avait presque plus de tissu adipeux, qu’il
souffrait d’une inflammation du côlon et qu’il était infecté par la gale.
Haaretz a demandé au ministère de la santé, qui supervise l’Institut national de médecine légale, si l’autopsie avait donné lieu à des mesures. Le ministère a refusé de fournir des détails, notant seulement que « comme l’exige la loi, les résultats inhabituels sont transmis aux autorités compétentes ». L’unité nationale d’enquête sur les gardiens de prison de la police continue d’enquêter sur le décès.
La prison de Megiddo, située sur la route 65 entre Umm
al-Fahm et Afula, est peut-être un cas extrême, mais au moins certains des
problèmes qui y existent touchent d’autres établissements pénitentiaires
accueillant des détenus et des prisonniers palestiniens.
Selon Physicians for
Human Rights [Médecins pour les droits humains], depuis le mois
dernier, la gale sévit dans les prisons de Ketziot, Ganot et Ayalon. En outre,
une pétition concernant la réduction des rations alimentaires pour les
prisonniers de sécurité (terme israélien désignant la plupart des prisonniers
palestiniens) comprend des déclarations sous serment de détenus témoignant
d’une grave perte de poids dans plusieurs établissements. Les avocats affirment que Megiddo est
le “pire des pires"” dans presque toutes les catégories.
En ce qui concerne les décès derrière les barreaux,
Megiddo se classe deuxième après Ketziot. Cinq personnes sont mortes à Megiddo
- Waleed Ahmad et quatre adultes -contre sept à Ketziot. Mais tous ces chiffres font partie d’une
statistique plus large : selon le Club des prisonniers palestiniens, au cours
des 20 derniers mois, 73 prisonniers et détenus identifiables sont morts dans
les prisons de l’armée et de l’administration pénitentiaire. En ce qui concerne
Megiddo, dans deux cas, les autopsies ont révélé des signes de violence
possible.
Le premier cas est celui d’Abd al-Rahman Mar’i, un
habitant de Qarawat Bani Hassan, dans le centre de la Cisjordanie, décédé en
novembre 2023. Son corps portait des traces de traumatisme, notamment des côtes
cassées et un sternum brisé. Un prisonnier qui était avec lui à l’époque et qui
a été libéré depuis, a déclaré à Physicians for Human Rights que Mar’i avait
été sévèrement battu à la tête avant sa mort.
Le deuxième cas est celui d’Abd al-Rahman Bassem
al-Bahsh, un habitant de Naplouse décédé à Megiddo en janvier de l’année
dernière. Son corps portait des ecchymoses sur la poitrine et l’abdomen, ainsi
que des côtes cassées, une rate endommagée et une grave inflammation des deux
poumons. Les enquêtes sur ces deux décès sont en cours et restent sous le sceau
du secret. Ce que l’on sait, c’est que ces deux affaires ne font pas
l’objet d’une enquête de la part de l’Unité nationale d’enquête sur les
gardiens de prison, ce qui signifie que les gardiens de prison ne
sont pas suspectés.
Les allégations de violence de la part des gardiens de
prison ne surprennent pas Ibrahim, qui affirme qu’il s’agit d’une
pratique courante à l’intérieur des murs de la prison. « Ils nous
faisaient nous agenouiller au fond de la pièce, nous disaient de mettre nos mains
sur la tête, puis entraient, nous aspergeaient de gaz au visage et nous
frappaient avec des matraques sur tout le corps », raconte-t-il. « Une
fois, ils sont entrés et m’ont frappé à la tête et à la bouche avec un
pistolet, me disloquant la mâchoire. Une autre fois, raconte-t-il, l’une des
unités de l’administration pénitentiaire est entrée et a battu les prisonniers,
les a aspergés de gaz, puis les a traînés dans la cour de la prison, où ils sont
restés allongés pendant près d’une heure sous la pluie.
« Ils nous ont menottés et leurs chiens marchaient
devant nous en aboyant pendant qu’ils nous donnaient des coups de pied »,
se souvient-il. Il y a eu d’autres cas, dit-il. Lors d’un incident, il a été
battu si violemment avec un gourdin que celui-ci s’est brisé sur son corps.
D’autres exemples ont été cités dans un rapport de Josh Breiner publié par Haaretz
en septembre dernier.
D’autres preuves d’abus apparaissent dans une plainte déposée en septembre par le Centre Hamoked pour la défense de l’individu, au nom d’un autre prisonnier mineur de Megiddo, auprès de l’unité d’enquête de la police sur les gardiens de prison. « La violence est telle que les prisonniers de la cellule ont constamment peur de ce qui va se passer », indique la plainte. Les gardiens pénètrent dans les cellules pendant l’appel et agressent les détenus à coups de poing ou de bâton. Le prisonnier mineur a indiqué qu’il avait été frappé une fois dans l’estomac - où il avait subi une intervention chirurgicale - jusqu’à ce qu’il perde connaissance.
Les prisonniers parlent peu, voire pas du tout, de la violence, de peur que les gardiens ne l’entendent - directement ou par l’intermédiaire d’autres détenus - et ne se vengent. « Un jour, quelqu’un a parlé des gardiens au tribunal et ils l’ont battu », raconte Ibrahim. Après la mort d’Ahmad, ajoute-t-il, la violence a diminué mais n’a pas cessé.
Ces récits ne se limitent pas à une période spécifique ; ils se sont
produits à la fois au cours des premiers mois de la guerre de Gaza, lorsque le
commissaire adjoint Muweed Sbeiti dirigeait la prison, et au cours des mois
suivants, sous le commandement du commissaire adjoint Yaakov Oshri.
Le commissaire adjoint Yaakov Oshri. Photo NWS News/YouTube
Un plat, 10 personnes
L’entretien avec Ibrahim a eu lieu le jour de son retour
à l’école après sa sortie de prison. Cet élève de 11e année, qui a
passé la majeure partie de l’année écoulée à apprendre principalement comment
rester en vie, résume son expérience en prison en un mot : “torture”. Ce mot ne
rend que partiellement compte de son apparence maladive et des souvenirs qu’il
aimerait pouvoir effacer. Il s’agit peut-être d’un cas extrême, mais tout au
long de l’entretien, il répète que d’autres prisonniers ont enduré les mêmes
choses - certains plus, d’autres moins.
« Personne n’avait l’estomac plein en prison, et pas
seulement moi », dit-il. « Ils apportaient une assiette de riz pour
dix personnes. C’était suffisant pour une personne, mais nous
le partagions tous ».
Il s’agissait d’un plat typique du repas de midi,
explique-t-il. Les autres repas n’étaient guère meilleurs. Les
petits-déjeuners, par exemple, se composaient d’une seule assiette de labneh
(fromage crémeux), de confiture, de pain et d’un légume - non
pas pour une personne, mais pour 10. « Et il n’y avait pas assez de labneh
pour couvrir le pain », raconte-t-il. En raison de la pénurie constante de
nourriture, les prisonniers combinaient tout, mélangeaient et partageaient. Il
y en avait un peu pour tout le monde et il n’y avait pas de restes. « Je
demandais aux gardiens plus de nourriture, mais ça ne servait à rien »,
ajoute-t-il, précisant qu’il s’endormait tous les soirs le ventre vide.
La seule chose qui rivalisait avec la maigreur des
portions était leur mauvaise qualité : parfois, les légumes de la salade
étaient pourris, le riz à moitié cru. Des descriptions similaires sont apparues
dans les témoignages de deux autres mineurs détenus à Megiddo. Ils ont déclaré
à leur avocat que chaque plat des repas représentait environ deux à trois
cuillères à soupe.
Dans une certaine mesure, ces témoignages étaient prévisibles : ils résultent de la politique du ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui, après le 7 octobre, a introduit des changements radicaux dans les conditions de vie des prisonniers palestiniens en Israël. Entre autres mesures, l'accès aux cantines des prisons leur a été interdit, la vaisselle et le matériel de cuisine ont été retirés de leurs cellules et une directive visant à réduire leurs portions alimentaires au minimum légal a été émise.
En août dernier, après que l'Association pour les droits civils en Israël a déposé une pétition contre les changements de politique, l'administration pénitentiaire a affirmé qu'elle avait augmenté la taille des portions. La réponse était accompagnée d'un menu actualisé comparant la nourriture fournie aux prisonniers de sécurité à celle des détenus de droit commun. L'examen des deux montre que les prisonniers palestiniens reçoivent deux fois moins de viande, pas de fruits et pas de sucreries à l'exception de la confiture, contrairement à leurs homologues criminels. La différence entre les deux menus soumis à la Cour par l'administration pénitentiaire s'élève à 1 300 calories par semaine et par personne.
Dans leur réponse, les pétitionnaires ont fait valoir que la loi n'autorisait pas une telle différence entre les deux groupes. (L'affaire est actuellement examinée par la Haute Cour.) Cependant, le témoignage de deux mineurs de la prison de Megiddo indique qu'au début de cette année, même le maigre menu présenté par l'administration pénitentiaire n'était pas fourni. Plus important encore - comme le montrent clairement les témoignages des prisonniers - ils avaient toujours faim.
Et il y a un autre problème. Jusqu'à ce que la guerre éclate, chaque aile de jeunes dans les prisons de sécurité avait un prisonnier adulte chargé de distribuer la nourriture. Mais un autre changement de politique de Ben-Gvir a éliminé cet arrangement, transférant la responsabilité de la distribution de la nourriture aux mineurs. Selon Ibrahim, ces jeunes prisonniers avaient tendance à voler une partie de la nourriture pour eux-mêmes, ce qui réduisait d'autant le peu qui restait pour les autres.
Mais les maigres portions et la mauvaise qualité de la nourriture ne sont pas le plus important de l'histoire. Les maladies dont souffrait Ibrahim n'étaient pas moins graves, c'est le moins que l'on puisse dire. Outre la gale qu'il a contractée à plusieurs reprises, il souffrait d'une maladie intestinale contractée en prison. « Je suis resté allongé sur le lit, incapable de me lever », raconte-t-il en décrivant son état en mars dernier, environ deux semaines après le début du ramadan. « J'ai mangé du pain et, une heure plus tard, je n'ai pas pu me retenir - je me suis souillé. Je voulais me lever pour aller aux toilettes, mais je n’avais pas la force. J'ai dormi tout le temps et je n'ai rien mangé ».
Cinq de ses neuf compagnons de cellule souffraient des mêmes symptômes. « Les médecins venaient dans notre aile, regardaient par la fenêtre, nous donnaient de l'Acamol [paracétamol] et nous disaient : mangez du pain et du riz ordinaire », raconte-t-il pour décrire les “soins médicaux” prodigués les premiers jours. D'autres prisonniers ont fait des descriptions similaires dans leurs témoignages. Au cours des mois de guerre, l'Acamol est devenu la réponse par défaut à la plupart des plaintes, tandis que les transferts à l'hôpital étaient rarement pris en considération.
Une exception apparente est le cas de Zaher Shushtari, 61 ans, qui a été placé en détention administrative - détention sans procès - en raison de son appartenance au Front populaire de libération de la Palestine. Shushtari, qui est atteint de sclérose en plaques et de diabète, a souffert d'une grave insuffisance pondérale au cours de sa détention et a finalement été transféré au centre médical de l'administrationpénitentiaire. Mais ça ne s'est pas produit uniquement en raison de ses problèmes de santé chroniques. Ce n'est qu'après que Haaretz a révélé en mai qu'il n'avait pas reçu le traitement nécessaire - et qu'il n'avait pas été emmené à l’infirmerie alors qu'il souffrait de la gale - que l'administration pénitentiaire a changé de cap.
L'avis médical soumis dans le cas de Shushtari indiquait qu'il souffrait également des symptômes d'une maladie digestive - comme ceux décrits par Ibrahim - dont la diarrhée et la perte de poids (d'autres personnes présentaient également des symptômes tels que des vertiges et des évanouissements). Derrière les barreaux, dit Ibrahim, ils l'appelaient “l'amibe”. Le professeur Amos Adler, médecin spécialisé en microbiologie clinique, n'a pas cité de maladie spécifique, mais, sur la base des informations dont il disposait, il a conclu qu'il y avait une forte probabilité d'apparition d'une maladie intestinale contagieuse. Dans un appel adressé à l'administration pénitentiaire par Médecins pour les droits humains - Israël, il a écrit que les documents indiquaient que la promiscuité, une alimentation inadéquate et une mauvaise hygiène avaient pu contribuer au problème.
Le témoignage d'Ibrahim confirme cela. Selon lui, avant même la maladie intestinale et la perte de poids drastique, il y avait la gale. La propagation de cette maladie cutanée contagieuse dans les prisons israéliennes n'est pas un secret ; fin 2024, l'administration pénitentiaire a reconnu, en réponse à une pétition, qu'environ 2 800 prisonniers palestiniens avaient contracté la maladie. Les prisonniers constituent une population à haut risque pour la gale en raison de la promiscuité dans les cellules. La plupart des gens contractent la maladie par contact avec une personne infectée ou en partageant des objets avec une personne infectée dans des conditions d'hygiène insuffisantes.
L'administration pénitentiaire a estimé que de nombreux détenus avaient déjà contracté la maladie en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Quoi qu'il en soit, les conditions dans lesquelles ils ont été détenus en Israël, comme l'attestent de nombreux témoignages et documents, n'ont rien arrangé.
Ibrahim raconte qu'il a contracté la gale presque immédiatement après son entrée dans la prison de Megiddo. « Les démangeaisons ont commencé dès la première semaine. D'abord sur mes mains, puis sur le reste de mon corps. Ça gratte et ça fait mal comme la mort. Un prisonnier avait la gale sur les mains et cela lui faisait tellement mal qu'il ne pouvait même pas tenir un mouchoir en papier ».

Prison de Megiddo. Un détenu de 17 ans raconte qu'il n'a été examiné par un médecin qu'après la mort d'un autre jeune prisonnier. Photo Alon Ron
Il raconte que la plupart du temps, il y avait 10 prisonniers dans la cellule, mais seulement huit couchettes - donc à tout moment, deux devaient dormir sur un matelas à même le sol. Ceux qui parvenaient à obtenir un lit n'avaient généralement pas de drap et devaient dormir sur le matelas nu. Ibrahim, lui, avait un drap, mais ce n'était pas beaucoup plus hygiénique. « Ils ne lavaient jamais le drap », dit-il. « Jamais ».
Il a bien reçu un traitement - des pilules et des bandages avec une pommade, et une fois une crème dans un gobelet en plastique - mais l'efficacité a été de courte durée. Les mauvaises conditions sanitaires et la propagation rampante de la maladie parmi les prisonniers ont fait qu'il a été infecté, dit-il, une deuxième et une troisième fois.
Les descriptions d'Ibrahim, ainsi que celles d'autres prisonniers, suggèrent que la gale et les maladies intestinales se sont propagées simultanément dans la prison, de nombreux prisonniers souffrant des deux à la fois. « Waleed [Ahmad] avait aussi l'amibe.
C'est de ça qu'il est mort », suppose Ibrahim. « Je l'ai vu. Il est sorti par la porte de la cellule et il était très, très maigre. Nous nous sommes salués. Il marchait dans la cour, il est tombé sur le visage et du sang a commencé à couler de sa bouche. Les médecins sont arrivés et l'ont emmené sur une civière et il n'est pas revenu ».
Selon Ibrahim, avant d'être atteint de cette maladie intestinale, Ahmad était en bonne santé, hormis la gale. Sa mort a provoqué une onde de choc dans la prison. Soudain, dit Ibrahim, on s'est intéressé à ceux qui avaient “l'amibe”. Deux prisonniers ont été emmenés au centre médical Emek d'Afula (« Nous pensions qu'ils étaient morts », dit Ibrahim, « mais finalement ils sont revenus »). Lui-même a d'abord été vu par un médecin, puis envoyé à plusieurs reprises à l'infirmerie de la prison, où il a subi des analyses de sang et des transfusions de liquides. À aucun moment, il n'a été conduit à l'hôpital.
Il a toutefois été transféré dans une cellule spécialement conçue pour les personnes ayant perdu beaucoup de poids. Ils étaient dix dans cette cellule également, dit-il, mais ils devaient manger sous la surveillance des gardiens, chacun dans une assiette individuelle. Pourtant, dit-il, la quantité de nourriture est restée la même, de même que sa qualité.

Une épidémie non traitée
Les noms des intervenants changent, les dates diffèrent, mais les descriptions restent étonnamment similaires. L'avocate Riham Nassra, qui représente régulièrement des Palestiniens devant les tribunaux militaires, a visité la prison de Megiddo tout au long de cette période. L'une de ses dernières visites a eu lieu en avril, lorsqu'elle a rencontré Nidal Hamayel, un détenu administratif de 55 ans qui y était incarcéré depuis septembre dernier.
Son apparence en disait long. « J'ai été choquée lorsque je l'ai vu entrer dans la salle de visite », raconte Nassra. Deux mois auparavant, raconte-t-elle, il s'était plaint des maigres portions et d'avoir constamment faim, mais son état de santé semblait globalement correct. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
« Il avait perdu beaucoup de poids et était pâle, émacié, faible et maigre, d'une manière maladive », décrit-elle. « Il pouvait à peine marcher et portait des vêtements sales ».
Hamayel lui a dit que depuis le mois de mars, lui et d'autres détenus avaient commencé à souffrir de graves douleurs abdominales, de diarrhée, de perte d'appétit et d'évanouissements. « Je suis effrayé par l'aspect de mon corps lorsque je me douche », lui a-t-il dit, selon la déclaration qu'elle a rédigée à la fin de la visite.
Bien que Hamayel ait été examiné par un médecin à plusieurs reprises, il n'a pas été orienté vers des examens complémentaires et s'est vu prescrire uniquement une transfusion de liquides et des analgésiques. Comme Ibrahim, il a subi une perte de poids considérable. Au moment de son arrestation, il pesait 86 kg, comme l'indique son dossier médical, mais en février, il n'en pesait plus que 60. L'administration pénitentiaire affirme que son poids n'a pratiquement pas changé entre février et avril, mais Nassra pense qu'il a nettement maigri pendant cette période.
Dans une requête qu'elle a déposée auprès du tribunal de district de Nazareth concernant le cas de Hamayel, Nassra a indiqué qu'elle avait également rendu visite à deux autres prisonniers à Megiddo qui souffraient de symptômes similaires, n'avaient pas reçu de traitement et s'étaient vu dire de boire de l'eau par l'infirmier. La pétition a également relevé d'autres aspects des conditions de détention de Hamayel. Par exemple, selon lui, il n'avait qu'une seule paire de sous-vêtements, qu'il portait continuellement depuis septembre, et un seul ensemble de vêtements d'hiver. En outre, il n'avait ni brosse à dents, ni dentifrice, ni serviette.
Aucune décision n'a encore été rendue dans cette affaire, mais le tribunal a ordonné à l'administration pénitentiaire de faire examiner Hamayel par un médecin. En mai, Nassra a appris que son client s'était remis de la maladie intestinale, bien qu'il n'ait reçu aucun traitement. « Il dit toujours qu'il est épuisé et qu'il a des vertiges », dit-elle, « et qu'il est tout le temps fatigué ».

« Tous les soins médicaux sont fournis sur la base d'un avis médical professionnel », déclare l'administration pénitentiaire israélienne. Photo Nidal Shtayyeh
Une autre visite de Nassra à Megiddo est décrite dans une déclaration récemment soumise au tribunal dans le cadre d'une pétition de l'Association pour les droits civils, qui demande que des quantités suffisantes de nourriture soient fournies aux prisonniers. « Le détenu est resté assis pendant toute la durée de la visite, grelottant de froid. Il avait l'air extrêmement maigre et malade, et il a dit qu'il avait très faim », a écrit Nassra à propos d'un détenu administratif qu'elle a rencontré en février. Elle n'a pas été surprise lorsqu'il lui a dit qu'il pesait 48 kg.
Un an plus tôt, il avait déjà déposé une plainte par l'intermédiaire de Hamoked - au sujet de l'insuffisance de la nourriture et de sa mauvaise qualité, parfois même insuffisamment cuisinée. Dans sa réponse à l'époque, l'administration pénitentiaire avait indiqué qu'il recevait trois repas par jour, mais n'avait donné aucune précision sur le contenu des repas ni sur l'identité du diététicien chargé de les superviser.
En mai, le nombre croissant de cas de maladies intestinales et la perte de poids drastique à la prison de Megiddo ont incité Physicians for Human Rights à envoyer une lettre virulente. Celle-ci a été envoyée au conseiller juridique de l'administration pénitentiaire, Eran Nahon, et à son médecin-chef, le Dr Liav Goldstein. Dans cette lettre, l'avocat Tamir Blank demande à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures pour empêcher la propagation de la maladie, dont les symptômes « sont communs à des dizaines de détenus ». Dans sa réponse, le Dr Goldstein a écrit que les allégations étaient connues, décrivant "un certain nombre d'incidents concentrés dans un établissement pénitentiaire il y a plusieurs mois ». Il a déclaré que l'administration pénitentiaire avait mis en œuvre toutes les mesures nécessaires, que le nombre d'incidents avait diminué de manière significative et qu'il n'y avait pas de nouveaux cas à l'heure actuelle.
Cependant, deux semaines auparavant, lorsque l'avocate Nadia Dacca a rendu visite à deux mineurs à la prison de Megiddo, leurs récits indiquaient que peu de choses avaient changé. Tous deux ont déclaré qu'ils étaient tombés malades, qu'ils n'avaient pas été soignés et qu'ils s'étaient rétablis d'eux-mêmes. « Je n'ai reçu aucun médicament de la part des autorités pénitentiaires. Certains prisonniers avaient de l'Acamol [un analgésique] dans leur cellule, alors j'en ai pris », a déclaré l'un d'eux à l'avocate. « Je me suis rétabli après avoir souffert pendant longtemps et sans avoir reçu de soins médicaux, tout en sachant qu'un prisonnier de mon quartier en était mort », a-t-il ajouté, faisant référence à Waleed Ahmad.
Le prisonnier a estimé qu'il pesait 62 kilogrammes au moment de son arrestation et qu'au moment où il s'est entretenu avec l'avocate, son poids était tombé à 53 kilos. Il a indiqué qu'il avait deux pantalons, deux caleçons et une chemise à manches courtes à porter. « J'ai un matelas sans housse, ce qui aggrave ma maladie, car je touche le matelas directement et je ne peux pas le laver », a-t-il déclaré.
Le deuxième jeune à qui Dacca a rendu visite, un détenu administratif de 17 ans, a décrit les mêmes symptômes trop familiers. Il a également indiqué qu'il n'avait été examiné par un médecin qu'après la mort d'Ahmad, environ un mois après avoir contracté la maladie. « Mon corps était très faible et je ne pouvais pas marcher », a-t-il déclaré. Lors de l'audience visant à approuver sa détention administrative, il a déclaré qu'il souffrait de la gale et qu'il avait perdu 30 kilos. Le juge a ordonné aux autorités de soumettre son cas au personnel médical de la prison pour s'assurer de son état. Il a ensuite décrit des conditions similaires : un matelas sans drap, un manque de vêtements et des pilules qui ne l'ont pas aidé. « Ils ne prennent toujours pas la gale au sérieux », a expliqué le jeune homme. « Le médecin se moque de moi ».
L'administration pénitentiaire a répondu en déclarant qu'elle « agit conformément aux lois et aux procédures, tout en préservant le bien-être, la sécurité et les droits de tous les détenus de l'établissement - y compris les mineurs. Tous les soins médicaux sont fournis sur la base d'un avis médical professionnel, conformément aux règlements du ministère de la santé et sous la supervision de médecins et de professionnels agissant au sein des établissements et à l'extérieur de ceux-ci. Dans la mesure où une plainte pour traitement défectueux est déposée, elle est examinée par le personnel habilité à le faire ».
Le rapport précise également que « dans tous les cas de décès d'un détenu, l'administration pénitentiaire le signale immédiatement aux autorités d'enquête compétentes - en fonction des circonstances de l'événement. Parallèlement, une enquête interne est lancée pour déterminer les circonstances de l'affaire, conformément aux procédures. L'administration pénitentiaire continuera à agir de manière responsable et conformément à la loi, tout en préservant la dignité humaine, la sécurité publique et l'application de la loi ».
Bref, ils prennent les enfants du bon Dieu pour moins que des canards sauvages [NdT]