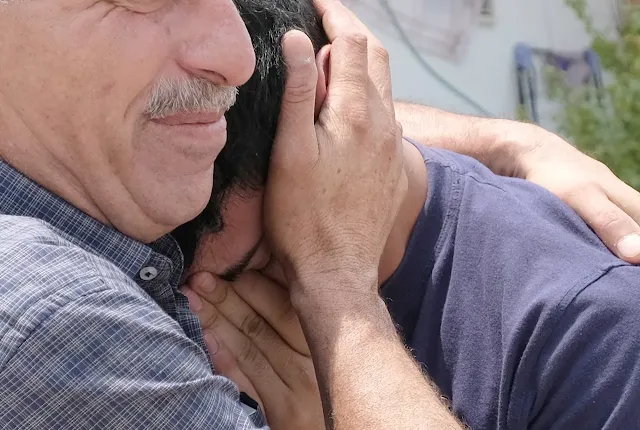The
Mossadegh Project, 3/10/2013
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
“Je mets ma confiance dans le soutien du peuple
iranien. C’est tout.”
Mossadegh
Mohammad Mossadegh est né le 16 juin 1882 à
Téhéran. Son père, Mirza Hedayat Ashtiani, était ministre des Finances de l’Iran
et sa mère, Najm al-Saltaneh, était étroitement liée à la dynastie régnante Kadjar (1789-1925). Quand
il avait 10 ans, son père est décédé, le laissant avec sa seule sœur, plus
jeune, à la charge de sa mère.
En reconnaissance des services rendus par son
défunt père à la couronne, le monarque Nasir al-Din Shah lui a donné le titre
de “Mossadegh al-Saltaneh”. Des années plus tard, lorsqu’un système de carte d’identité
nationale a été introduit en Iran, il a choisi le nom de famille de Mossadegh,
qui signifie “vrai et authentique”.
La carrière de Mossadegh commence à l’âge
exceptionnellement jeune de 15 ans, lorsqu’il est nommé, toujours en l’honneur
de son père, Mostofi (chef des finances) de la province du Khorasan. Tout en s’intéressant
à la science moderne, il pratique divers sports et apprend à jouer du Tar, un
instrument à cordes traditionnel persan.
À 19 ans, il épouse Zia al-Saltaneh, une princesse
kadjar, qu’il considère comme “la personne que je chéris le plus après ma mère”.
Le couple aura trois filles - Zia Ashraf, Mansoureh et Khadijeh - et deux fils,
Ahmad et Gholam-Hossein.
Mossadegh n’avait que 21 ans lorsque les habitants
d’Ispahan l’ont élu au Majlis (Parlement iranien) pour les représenter.
Cependant, comme il n’avait pas l’âge légal requis, il a retiré son nom de la
liste des candidats. Au cours du mouvement constitutionnaliste de 1905-1911,
Mossadegh a participé activement aux événements qui ont conduit à l’établissement
d’une monarchie constitutionnelle en lieu et place du régime monarchique
arbitraire.
Mossadegh a étudié les sciences politiques à
Téhéran et, en 1909, il a poursuivi ses études à Paris. Pendant son séjour à
Paris, il a commencé à ressentir une faiblesse et une fatigue extrêmes et a été
contraint d’abandonner ses études et de rentrer en Iran. Tout au long de sa
vie, il a été accablé par ce problème persistant, mieux connu aujourd’hui sous
le nom de “syndrome de fatigue chronique”. Plus tard, il retourne en Europe et
étudie le droit à l’université de Neuchâtel, en Suisse. En juin 1913, il devient
le premier Iranien à obtenir un doctorat en droit et rentre en Iran un jour
seulement avant le début de la Première Guerre mondiale.

En 1912
Peu après son retour en Iran, Mossadegh fait l’objet
d’une accusation malveillante de la part d’un rival politique. Cette accusation
infondée l’a tellement bouleversé qu’il est tombé malade et a eu de la fièvre.
Sa mère, connue pour avoir fondé l’hôpital de bienfaisance Najmieh à Téhéran, a
remarqué qu’il était malheureux et lui a dit qu’elle aurait préféré qu’il étudie
la médecine plutôt que le droit. Quiconque étudie le droit et se lance dans la
politique doit être prêt à subir toutes sortes de calomnies et d’insultes, lui
dit-elle, mais “la valeur d’une personne dans la société dépend de ce qu’elle
endure pour le bien du peuple”. Dans ses mémoires, Mossadegh a écrit que ces
paroles de sagesse l’avaient préparé à la vie qu’il avait choisie et qu’à
partir de ce moment-là, plus il était confronté à des épreuves et à des
insultes, plus il était prêt à servir le pays.
Mossadegh accepte un poste au sein du gouvernement
en tant que secrétaire adjoint du ministère des Finances, où il tente de lutter
contre la corruption et fait condamner plusieurs personnes. En 1919, il choisit
de s’exiler en Suisse pour protester contre un accord entre le gouvernement et
la Grande-Bretagne qu’il jugeait très inquiétant. La principale disposition de
cet accord consistait à confier à des conseillers britanniques la supervision
de l’armée et des systèmes financiers iraniens. Craignant le pire pour l’Iran,
il a mené une campagne fébrile contre cet accord en Europe et a écrit à la
Société des Nations pour demander de l’aide dans cette affaire. Mossadegh est
rentré en Iran après le rejet de l’accord par le Majlis.
La réputation de Mossadegh en tant qu’homme
politique honnête, juste et concerné l’avait précédé lors de son retour en
Iran. Lors de ses déplacements dans la province du Fars, il est accueilli
chaleureusement par les habitants et se voit proposer de devenir leur
gouverneur, ce qu’il accepte. Après quelques mois, il démissionne de ce poste
pour protester contre le coup d’État de 1920 à Téhéran, inspiré par les
Britanniques, qui aboutira à l’établissement de la dynastie Pahlavi en 1925. Il
occupe cependant le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement du
Premier ministre Ghavam, puis devient ministre des Affaires étrangères. En
1923, Mossadegh a été élu au 5e Majlis et a commencé son opposition historique
à l’établissement de la dynastie Pahlavi par Reza Khan, soutenu par les
Britanniques et alors Premier ministre de l’Iran. Il prévoyait le retour de la
dictature en Iran, “lorsqu’un seul homme sera à la fois roi, Premier ministre
et magistrat !”
Comme Mossadegh l’avait prédit, la vie sous le
règne tyrannique de Reza Shah était dure et oppressive ; en fait, le climat
politique était devenu si insupportable qu’il avait de bonnes raisons de
craindre pour sa vie. En 1928, il se retire volontairement de l’activisme
social et politique et se retire dans son village d’Ahmad-Abad, situé à une
centaine de kilomètres de Téhéran. Pendant cette période, qui a duré plus d’une
décennie, il a passé son temps à lire et à cultiver la terre, menant des
expériences pour améliorer la production agricole et partageant les
connaissances acquises avec les autres agriculteurs du village.
Le 26 juillet 1940, la police de Reza Shah
débarque à l’improviste au domicile de Mossadegh, fouillant et saccageant sa
maison. Bien qu’aucune preuve incriminante n’ait été trouvée contre lui, il est
emmené à la prison centrale de Téhéran. Mossadegh est interrogé et, sans être
informé des charges qui pèsent sur lui, transféré dans la forteresse de Birjand
(ville du nord-est de l’Iran). Conscient du sort réservé à de nombreux autres
qui ont osé s’opposer à l’arbitraire de Reza Shah, il s’attend à être tué.
Le coup le plus dur porté à Mossadegh par son
emprisonnement a été l’effet qu’il a eu sur sa fille de 13 ans, Khadijeh, qui
avait été témoin de l’arrestation brutale de son père et de son transfert forcé
à la prison de Birjand. La très sensible Khadijeh a été profondément
traumatisée et a passé le reste de sa vie dans des hôpitaux psychiatriques.
Mossadegh a déclaré plus tard que cette tragédie était la punition la plus
cruelle qui pouvait lui être infligée.
Reza Shah libère Mossadegh de la prison de Birjand
en novembre 1940 et le transfère à Ahmad-Abad, “pour y vivre jusqu’à sa mort”.
Un an plus tard, son assignation à résidence prend fin lorsque les Britanniques
forcent l’abdication de Reza Shah et que son fils de 22 ans, Mohammad Reza,
monte sur le trône.
Ayant repris ses activités politiques, Mossadegh est
élu avec un soutien écrasant pour représenter Téhéran au 14e Majlis en 1944. Pendant son mandat au Majlis,
Mossadegh s’est battu avec passion pour l’indépendance politique et économique
de l’Iran vis-à-vis des étrangers, notamment en s’attaquant à l’accord
pétrolier très injuste conclu avec l’Anglo-Iranian Oil Company, un objectif
pour lequel il a reçu un soutien populaire écrasant.
L’histoire contemporaine de l’Iran est liée au
pétrole, une source d’énergie très recherchée par l’Occident, depuis 1901, date
à laquelle des droits exclusifs de 60 ans ont été accordés à William Knox D’Arcy,
un sujet britannique, pour la prospection et l’exploitation du pétrole dans les
provinces méridionales de l’Iran. En 1908, le pétrole a été découvert et l’Anglo-Persian
Oil Company a été créée. Juste avant le début de la Première Guerre mondiale en
1914, le gouvernement britannique a acheté 51 % des actions de la compagnie.
Les Britanniques ont ainsi créé une tête de pont et pratiquement colonisé le
sud-ouest de l’Iran, s’immisçant directement et indirectement dans les affaires
politiques du pays tout entier. L’APOC a triché sur les maigres 16 % versés à l’Iran
et a traité les travailleurs pétroliers iraniens avec mépris et racisme dans
leur propre pays. La situation a atteint son paroxysme en juillet 1946, lorsque
quelque 6 000 travailleurs pétroliers iraniens se sont mis en grève à Agajari.
Leur affrontement avec les troupes gouvernementales a fait plus de 200 morts et
blessés.
Mossadegh envisageait un Iran indépendant, libre
et démocratique. Il pensait qu’aucun pays ne pouvait être politiquement
indépendant et libre s’il ne parvenait pas d’abord à l’indépendance économique.
Selon lui, “l’aspect moral de la nationalisation du pétrole est plus important
que son aspect économique”. Il a cherché à renégocier et à parvenir à une
restitution équitable et juste des droits de l’Iran, mais s’est heurté à l’intransigeance
de la compagnie. Pour mettre fin à 150 ans d’ingérence politique britannique, d’exploitation
économique et de pillage des ressources nationales de l’Iran, Mossadegh a
organisé la nationalisation de l’industrie pétrolière.
Mossadegh a présenté pour la première fois l’idée
de la nationalisation à la Commission du pétrole mandatée par le Majlis le 8
mars 1951. Le lendemain, le Front national, une coalition de plusieurs partis,
a organisé un grand rassemblement sur la place Baharestan devant le Majlis pour
soutenir la nationalisation du pétrole. À la veille du Nouvel An iranien, le 20
mars 1951 [29 Esfand 1329], le projet de loi du Front national pour la nationalisation
du pétrole reçoit l’approbation finale du Sénat, quelques jours seulement après
avoir été approuvé à l’unanimité par les députés du Majlis. Un mois plus tard,
le Dr Mohammad Mossadegh a été nommé au poste de Premier ministre, qu’il a
remporté avec les voix de près de 90 % des représentants présents.
Mossadegh porté en triomphe par la foule après la nationalisation de l'Anglo-Iranian
Le différend entre l’Iran et l’Anglo-Iranian Oil Company
(AIOC), qui a été démantelée, se poursuit sans qu’aucune solution ne se profile
à l’horizon, ce qui accroît les tensions entre l’Iran et la Grande-Bretagne. Le
gouvernement britannique impose des sanctions économiques à l’Iran et le menace
d’une attaque militaire. En juin 1951, le gouvernement iranien découvre un
réseau d’espionnage britannique qui révèle les activités subversives d’un grand
nombre de politiciens et de journalistes iraniens, y compris des communistes
qui reçoivent des pots-de-vin du gouvernement britannique et de l’AIOC.
Le gouvernement iranien réagit en fermant le
consulat britannique. Le gouvernement britannique réagit en rappelant son
ambassadeur, Francis Shepherd, à Londres. En octobre 1951, le Premier ministre
Mohammad Mossadegh se rend à New York pour défendre personnellement le droit de
l’Iran à nationaliser son industrie pétrolière devant le Conseil de sécurité
des Nations unies. Le gouvernement britannique, en quête de soutien, avait
porté sa cause devant les Nations unies pour qu’elle soit entendue. Mossadegh a
fait une présentation spectaculaire et réussie, démontrant que les bénéfices
pétroliers de la Grande-Bretagne pour la seule année 1950 étaient supérieurs à
ce qu’elle avait versé à l’Iran au cours du demi-siècle précédent.
Mossadegh s’est ensuite rendu à Washington, où il a rencontré
le président Harry S. Truman. Sa visite a été largement couverte par les
journaux, les magazines, la télévision et les films d’actualités. À son retour
en Iran, en novembre 1951, il s’est arrêté à l’aéroport Farouk du Caire, en
Égypte, où il a été accueilli par des milliers d’admirateurs qui ont scandé “VIVE
MOSSADEGH” et “VIVE L’IRAN”. Au cours de sa visite de quatre jours, le roi d’Égypte,
le premier ministre, le cabinet et d’autres dignitaires ont honoré Mossadegh
personnellement, et un dîner de gala a été organisé en son honneur par la
municipalité du Caire. En janvier 1952, Mossadegh est nommé homme de l’année
par le magazine Time, sa deuxième couverture par Time en l’espace
de 7 mois.

L’HOMME DE L’ANNÉE
"Il a huilé les rouages du chaos" [sic]
TIME Magazine, 7 janvier 1952
En juin 1952, Mossadegh se rend à La Haye, aux
Pays-Bas, et présente près de 200 documents à la Cour internationale concernant
la nature hautement exploiteuse de l’AIOC et l’étendue de son intervention
politique dans le système politique iranien. « Il n’y a pas de critère
politique ou moral à l’aune duquel la Cour puisse mesurer son jugement dans le
cas de la nationalisation de l’industrie pétrolière en Iran », a-t-il
affirmé, et « nous n’accepterons en aucun cas la juridiction de la Cour
sur ce sujet. Nous ne pouvons pas nous placer dans la situation dangereuse qui
pourrait résulter de la décision de la Cour ». Le verdict sera annoncé
plus tard et Mossadegh retournera à Téhéran après avoir gagné le respect des
juges.
De retour en Iran, les conditions économiques et
de sécurité se détériorent rapidement, aggravées par les activités de plus en
plus subversives des puissances étrangères et de leurs agents. Lors d’une
réunion en juillet 1952 avec le jeune monarque Mohammad Reza Shah, qui
dirigeait l’armée, Mossadegh a demandé le contrôle des forces armées, ce qui
lui a été refusé. En réponse, Mossadegh a immédiatement présenté sa démission
en tant que Premier ministre.
Le lendemain, le Shah, à la demande des
gouvernements britannique et usaméricain, nomme Ghavam Saltaneh au poste de
Premier ministre. Ghavam Saltaneh adopte une ligne dure, ce qui ne fait qu’attiser
la colère de la population qui était descendue dans la rue pour soutenir
Mossadegh. Lors de la plus grande manifestation de rue, le 20 juillet 1952 (30
Tir 1331), les forces de sécurité affrontent violemment les manifestants,
faisant des centaines de victimes. Le Shah, constatant l’ampleur du soutien de
la population à Mossadegh, s’est alarmé et a changé de cap. Il nomme Mossadegh
à la double fonction de Premier ministre et de ministre de la Défense, comme le
permet la Constitution. Le même jour, la Cour internationale de La Haye se
prononce en faveur de l’Iran, estimant qu’elle n’est pas compétente dans l’affaire
du différend pétrolier. Le Conseil de sécurité des Nations unies rejette
ensuite la plainte britannique contre l’Iran. Mossadegh est alors au sommet de
son pouvoir et de sa popularité, salué comme un héros non seulement en Iran,
mais aussi dans l’ensemble du Moyen-Orient.
En tant que dirigeant de l’Iran, Mossadegh a
parrainé des lois pour un “gouvernement propre” et des systèmes judiciaires
indépendants, a défendu la liberté de religion et d’affiliation politique, et a
promu des élections libres. Il a mis en œuvre de nombreuses réformes sociales
et s’est battu pour les droits des femmes, des travailleurs et des paysans. Un
fonds a été créé pour financer des projets de développement rural et aider les
agriculteurs. Conformément à sa politique d’“équilibre négatif”, une idée qui a
contribué à la formation du mouvement des non-alignés, Mossadegh a également
refusé d’accorder une concession pétrolière à l’Union soviétique. Plus
important encore, Mossadegh a contribué à favoriser une autosuffisance
nationale qui n’a jamais été égalée en Iran depuis son mandat : il a équilibré
le budget, augmenté les productions non pétrolières et créé une balance
commerciale. Sa politique s’est souvent heurtée à l’opposition du Shah, des
généraux de l’armée, des principaux religieux, des propriétaires terriens, du
parti Toudeh (communiste) et des gouvernements britannique et usaméricain.
Néanmoins, Mossadegh a toujours pu compter sur le soutien du peuple.
Entretemps, les Britanniques ont continué à saper
l’autorité de Mossadegh en incitant à la division dans le pays, en renforçant l’embargo
mondial sur l’achat de pétrole iranien, en gelant les avoirs iraniens et en
menaçant l’Iran d’une invasion par la constitution d’une force navale dans le
golfe Persique. Toutes ces tentatives ayant échoué, la Grande-Bretagne a conclu
que “Mossadegh doit partir” par tous les moyens nécessaires. En collaboration
avec la CIA, ils ont fomenté un coup d’État pour renverser le gouvernement
démocratiquement élu.
Le 15 août 1953, avec la participation du Shah et
de ses collaborateurs iraniens, un plan élaboré par la CIA sous le nom de code “Opération
Ajax”, dirigé par Kermit Roosevelt, a été mis en œuvre, mais il n’a pas réussi
à déloger Mossadegh du pouvoir. Lors de la deuxième tentative, le 19 août 1953,
[28 Mordad 1332] le gouvernement a été violemment renversé. Mossadegh échappe à
la capture, mais sa maison est envahie, pillée et incendiée. Le lendemain,
Mossadegh se rend aux autorités et est emprisonné. Au cours de cet épisode
sanglant, plusieurs centaines de personnes ont été tuées ou blessées. Les
partisans de Mossadegh ont été arrêtés, emprisonnés, torturés ou même
assassinés. Le ministre des Affaires étrangères de Mossadegh, le Dr Hossein
Fatemi, est entré dans la clandestinité mais a été capturé quelques mois plus
tard. Il a été battu, poignardé 5 fois par Shaban Jafari, un ancien catcheur
surnommé “Sans cervelle” et, après un simulacre de procès, exécuté par un
peloton d’exécution. Le règne de la terreur avait commencé.

Jugé comme traître par un tribunal militaire, le
19 décembre 1953, Mossadegh déclare :
« Oui, mon péché - mon grand péché... et même
mon plus grand péché - est d’avoir nationalisé l’industrie pétrolière iranienne
et d’avoir mis fin au système d’exploitation politique et économique du plus
grand empire du monde. ...Au prix de ma vie et de celle de ma famille, au
risque de perdre ma vie, mon honneur et mes biens. ...Avec la bénédiction de
Dieu et la volonté du peuple, j’ai combattu ce système sauvage et épouvantable
d’espionnage international et de colonialisme.
« […] Je suis bien conscient que mon destin
doit servir d’exemple à l’avenir dans tout le Moyen-Orient pour briser les
chaînes de l’esclavage et de la servitude aux intérêts coloniaux ».

Mossadegh est déclaré coupable de trahison. Il est
placé à l’isolement pendant trois ans, puis assigné à résidence jusqu’à la fin
de sa vie dans son village ancestral d’Ahmad-Abad. Le 5 mars 1967, Mohammad
Mossadegh meurt à l’âge de 85 ans, un an et dix mois après le décès de celle qui fut son
épouse bien-aimée pendant 64 ans.